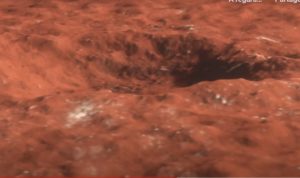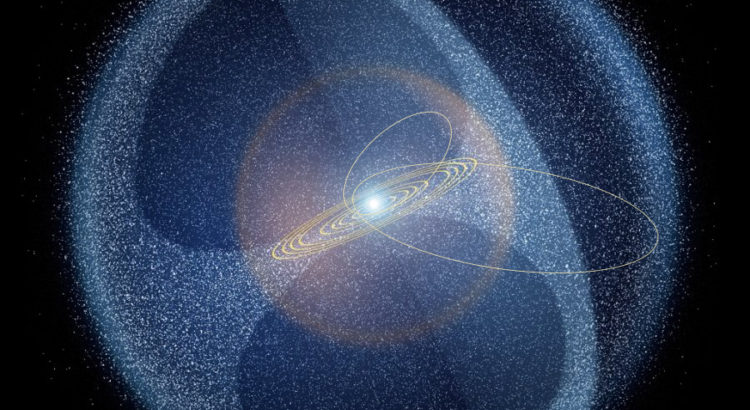On connait bien les dangers auxquels les hommes seront physiquement confrontés sur Mars. Ils résulteront d’abord de l’isolement et de la gravité. L’isolement, parce qu’aucun transport depuis la Terre ou depuis Mars ne sera possible en dehors des fenêtres ouvertes par l’évolution respective des planètes autour du Soleil (cycles synodiques différents, de 26 mois pour Mars et de 12 mois pour la Terre). La gravité, plus faible (0,38g), parce qu’on ne sait pas comment lutter contre, en dehors de l’exercice physique (ou le port de vêtements pesants ou sollicitant les muscles) et parce que ce qui se passe à l’intérieur du corps restera toujours soumis à cette gravité différente (moins d’effort nécessaire à la pompe cardiaque pour pulser le sang vers le haut du corps et notamment le cerveau). On ne pourra en évaluer les conséquences que sur la durée, après les premières missions habitées. Au-delà, il faudra « faire-avec » toutes sortes de risques dont on pourra relativement bien se protéger à l’intérieur de la base habitée mais auxquels on restera exposé et vulnérable lors des « sorties », les mieux-nommées « EVA » (« extra-vehicular activities »).
Le remède à cette situation de danger présentée par « l’extérieur » mais en même temps d’impérieuse nécessité de pouvoir y exercer une activité, sera la robotique. Dans cette perspective les travaux de la Société Boston Dynamics* nous ouvrent des possibilités extraordinaires qui « tombent à pic » pour nous préparer à nous installer puis à vivre sur Mars.
*La société Boston Dynamics qui a commencé comme spin-off du MIT en 1992, est installée aux Etats-Unis. Après être « passée dans les mains » de Google, elle appartient aujourd’hui au chaebol Hyundai, via Hyundai Motor Group, pour 80%, et au financier Softbank (Japon) pour 20%. Ces vicissitudes s’expliquent par des “perspectives de rentabilité incertaines”.
Il faut dire en préambule que sur Mars toutes sortes de robots seront utiles sinon indispensables, et utilisables, dotés d’une programmation plus ou moins sophistiquée et d’une possibilité de recours à toutes sortes de données, ce qui permettra une intelligence artificielle plus ou moins développée selon les besoins.
Après l’incontournabilité de la nécessité de satisfaire le besoin d’activité à l’extérieur, la deuxième contrainte dimensionnante sera le besoin de mobilité car l’utilité principale des robots sera l’observation, l’exploration et la construction d’infrastructure sur une terre vierge. Enfin la troisième sera la robustesse car toute réparation sera coûteuse en disponibilité, en temps et en énergie.
Pour faire face à ces besoins, le robot que je pense le plus adapté (en dehors des véhicules robotiques « classiques ») sera l’humanoïde « ATLAS » (Agile Anthropomorphic Robot) de Boston Dynamics* assisté d’« animats » (« animal » + « material », robots conçus pour se comporter comme des animaux). On en voit de temps en temps des vidéos et les plus récentes montrent qu’ils peuvent atteindre des performances extraordinaires (voir lien ci-dessous). Pour parler d’abord d’Atlas, l’intérêt n’est pas tant qu’il ressemble visuellement à l’homme mais qu’il peut effectuer à la place de l’homme toutes les taches physiques que l’homme devrait autrement effectuer lui-même : marcher sur un terrain inégal, sauter, escalader, porter, saisir, manœuvrer, manipuler, voir enfin via des caméras équipant sa tête avec retransmission de la chose vue sur écran à distance. On peut aussi sans doute envisager de renforcer son squelette ou de lui adapter un exosquelette pour porter des charges particulièrement lourdes. Quoique le transport puisse être effectué par des animats (voir ci-dessous), les manipulations de charges lourdes (déchargement d’un starship par exemple) peuvent nécessiter cette adaptation.
* Boston Dynamics n’est pas la seule société qui produit des robots humanoïdes. Tesla a décidé de suivre cette voie avec “Optimus”, ou la société Figure avec “Figure-1”. Cependant Boston Dynamics a beaucoup d’avance sur ses compétiteurs.
L’intérêt de cette intermédiation robotique sera de permettre à l’homme d’éviter de sortir de la Base habitée, donc de devoir enfiler, difficilement, une combinaison qui devra être pressurisée (et au travers de laquelle la main ne pourra pas intervenir, pour s’essuyer le front par exemple), d’être exposé dans cette combinaison au risque d’accrocs qui entraineraient une dépressurisation, d’être exposé aux radiations solaires et galactiques beaucoup plus sévèrement que dans la Base puisqu’il ne saurait être question de se déplacer avec la masse de matériaux protecteurs qui procureraient une sécurité totale. L’intérêt ce sera aussi d’éviter la nécessité et la complication d’équiper l’ouvrier d’un système support-vie (pour l’homme, gaz respirables, eau et stockage avec soi d’inévitables déchets corporels le temps de toute mission un peu longue). Ce sera encore d’être exposé à des températures très basses, qui nécessiteront un système de chauffage délicat incorporé au scaphandre (les robots devront pouvoir être chauffés pour maintenir leurs fluides fonctionnels liquides mais les marges de tolérance seront plus ouvertes). Ce sera encore d’éviter le risque de blessure grave pouvant provenir de micrométéorites, rares mais non exceptionnelles puisque l’atmosphère martienne n’est pas suffisante pour y faire barrière comme en surface de la Terre. Ce sera encore de limiter la fatigue physique des astronautes compte tenu de l’importance des gestes, manipulations, efforts qui seront nécessaires pour l’installation, l’entretien puis le développement des infrastructures de la Base, de son relai de communication, du site d’extraction des ressources locales, des véhicules, des équipements divers, de l’astroport. Ce sera encore de libérer les hommes de travaux répétitifs, consommateurs de temps et à faible valeur intellectuelle ajoutée. Ce sera encore de pouvoir apporter depuis la Terre dans un espace réduit, un maximum de « travailleurs » ne nécessitant pas les mêmes conditions de confort que les hommes (et donc bien davantage de force de travail sur Mars). Ce sera enfin de limiter les besoins en traitements médicaux en les remplaçant par des traitements mécaniques (avec évidemment modularité et redondance des pièces détachées) ou informatiques.
Alors, à ce stade, certains se demanderont pourquoi l’homme devrait-il aller physiquement sur Mars et pourquoi ne pas se contenter d’y envoyer des robots à sa place ? La réponse est que du fait de la finitude de la vitesse de la lumière, il y a un décalage temporel incontournable entre Mars et la Terre, qui va de 3 à 22 minutes dans un seul sens. On ne peut pas échapper à cette contrainte et on ne peut donc mener aucune action robotisée en direct sur Mars depuis la Terre. On doit programmer, constater le résultat, reprogrammer, sans cesse. Des hommes vivant dans une base martienne, donc au plus près de leurs robots, pourront agir sur le terrain constamment en direct via leur humanoïde (éventuellement évidemment assisté d’animats ou d’autres robots) qu’ils pourront considérer comme leur avatar. A cet égard, il faut bien voir que la situation sera totalement différente sur la Lune puisque la Terre n’en est qu’à 380.000 km et que, s’il y a bien un décalage temporel d’un tout petit peu plus d’une seconde entre les deux astres, cela n’empêche absolument pas une action directe depuis la Terre. La présence de l’homme sur Mars est donc indispensable pour l’explorer et l’exploiter ; elle ne l’est pas sur la Lune.
Je vois donc la population martienne future comme structurée en cellules de personnes humaines spécialisées, assistées de robots humanoïdes et autres pour la plupart de leurs actions extérieures. Leurs EVA ne seraient qu’exceptionnelles, pour contrôler ces machines, leur simple plaisir, le besoin physique de mener une action délicate (pour laquelle la programmation serait trop difficile ou trop complexe) seul ou avec d’autres humains (récupérer un homme blessé dans des conditions particulièrement délicates) ou d’autres nécessités (par exemple non-fonctionnement du parc robotique suite à une tempête solaire particulièrement forte qui aurait endommagé un centre informatique ne disposant pas de suffisamment de résilience ou de redondance).
Bien entendu ces humanoïdes seraient personnalisés pour chacun des humains qui les utiliseraient. On imagine bien que, puisqu’on le fait pour son ordinateur personnel (on a ses programmes, ses fichiers classés et on sait où ils se trouvent), on le ferait aussi pour son humanoïde personnel. Par ailleurs comme, vu à distance, un robot humanoïde ressemblera beaucoup à un autre, on aura intérêt à le distinguer visuellement des autres pour mieux le contrôler et le faire interagir à distance par écran interposé. Ça tombe bien car, étant donné le problème de poussière sur Mars et la vulnérabilité des articulations, il faudra les « habiller » aussi hermétiquement que possible.
A beaucoup d’égards, on pourra traiter l’humanoïde comme un homme, le faire monter sur un rover (l’avantage étant que le véhicule ne sera ni pressurisé, ni alourdi par une protection contre les radiations), télécommandé et il se rechargera en énergie en étant assis ; lui faire inspecter des parois raides et dangereuses (par exemple la partie haute de la coque d’un Starship avec un système de filins ou un échafaudage, ou bien l’aplomb d’une falaise sur laquelle on aurait aperçu une anfractuosité grâce à un hélicoptère ou un dirigeable) ; l’envoyer sur un hopper de Gruyere Space Program mener une mission lointaine avec une source d’énergie dédiée. Si un atlas se casse le poignet on pourra le lui remplacer car la plupart des pièces du robot sont imprimables en 3D, et ce sera évidemment préférable à une intervention chirurgicale sur un homme. Il faudra nettoyer le robot mais on n’aura pas besoin de lui faire prendre une douche (économie d’eau !) ; sans doute un bon coup de souffleur (ou sèche-cheveux !) pour lui enlever la poussière martienne ultrafine (d’abord à l’extérieur du sas) et quelques interventions plus méticuleuses en cas de problème (petit caillou coincé dans la chaussure !).
Il faudra également « nourrir » les robots. J’imagine que leur fonctionnement requerra beaucoup d’énergie (surtout qu’on leur demandera beaucoup !) et des rechargements fréquents puisque leur autonomie (batterie transportable) sera probablement limitée compte tenu du volume et de la masse*. J’imagine bien que des atlas se rendent sur le site d’une intervention avec un rover non pressurisé sur lequel seront embarqués quelques animats, des outils et un ou deux kilopowers (réacteur à fission nucléaire portable). Après une durée de fonctionnement correspondant à leur capacité énergétique, ils viendraient se recharger à l’ombre de leur radiateur-parasol…comme on le fait nous-mêmes après l’effort sur la plage, sous des parasols également radiateurs (réflexion de la lumière solaire).
*mais on peut être créatif : les atlas-explorateurs qui par définition s’éloigneront beaucoup de la Base, pourront porter fixées à leurs épaules, de grandes ailes d’ange (ou de démon, selon votre point de vue) revêtues de panneaux solaires, qu’ils déploieront à l’envie.
Mais allons voir un peu plus à l’intérieur de « la bête » :
Comme le dit Boston Dynamics, ATLAS est une plateforme R&D, donc toujours un projet, fortement évolutif. Les recherches continuent à progresser dans les deux domaines de la physique et de la programmation (nous ne sommes pas au bout de notre émerveillement).
Dans le domaine physique les trois cadres sont :
1) La mobilité : le robot possède l’un des systèmes hydrauliques mobiles les plus compacts et réactifs au monde. Une batterie parfaitement adaptée, des vannes et une unité d’alimentation hydraulique lui permettent de fournir une puissance élevée immédiate mais dosable, à n’importe laquelle de ses 28 articulations.
2) La dynamique : Le système de contrôle avancé du robot permet une locomotion très diversifiée et agile tandis que les algorithmes raisonnent au travers d’interactions dynamiques complexes impliquant l’ensemble du corps et l’environnement pour planifier les mouvements. Sa vitesse maximum est de 2,5 m/s.
3) La légèreté et la modularité : le robot utilise des pièces imprimées en 3D qui lui donnent le rapport résistance/poids adéquat pour ses sauts. Pour une hauteur de 1,5 kg, son poids est de 89 kg (34 kg sur Mars).
Dans le domaine de la programmation, la recherche se situe dans la coordination de tout le corps et dans le mouvement dynamique :
4) Bibliothèque de comportements : les modèles de mouvements sont créés à l’aide de l’optimisation des trajectoires et intégration dans des routines complexes.
5) Perception en temps réel : ATLAS utilise des capteurs de profondeur pour générer des nuages de points et détecter son environnement.
6) Contrôle prédictif modélisé : ATLAS utilise des modèles de dynamique pour prédire comment son mouvement évoluera dans le temps et il s’ajuste en conséquence.
ATLAS devrait être la pièce essentielle du dispositif robotique martien mais on peut également considérer deux animats comme ses assistants…et ceux de l’homme :
Bigdog (2004) est un robot porteur quadrupède utilisable pour les déplacements sur terrain accidenté. Il a été le premier à sortir du laboratoire de Boston Dynamics. Image: crédit Boston Dynamics) :
LS3 (2010) est l’équivalent de Bigdog pour transporter des équipements lourds et encombrants (crédit Boston Dynamics) :
Que fera donc l’« homme-aux-commandes », physiquement sur Mars ? Il sera le plus souvent assis à son bureau derrière son écran à surveiller son avatar, à voir au travers de lui et à lui donner des instructions pour lui-même et ses assistants robotiques. Mais il devra aussi, avec ses compagnons humains, entretenir sa « flotte » de robots, en construire et en programmer d’autres ; se concerter avec la Terre et au sein de la Base pour diriger le développement de cette dernière. Le ratio optimum êtres humains / robots sera facilement établi, c’est une question d’espace de stockage d’équipements et de ressources, d’énergie et de capacité d’attention de l’homme donc aussi des avancées possibles en autonomie des robots.
Au-delà, comme sur Terre, les hommes sur Mars auront besoin de se détendre, et encore plus que sur Terre, de faire du sport pour maintenir leur masse osseuse et musculaire. Nul doute que la Base sera bien équipée à cet effet (moins bien au début et mieux après). J’imagine aussi qu’ils liront sur leur tablette, qu’ils mèneront des études et des recherches, qu’ils écriront des lettres, écouteront de la musique, regarderont des films, nourriront leur corps et entretiendront leur santé. Tous ensemble, ils formeront une communauté pour faire avancer le développement de l’implantation humaine ou diverses recherches in situ…et aussi, en convivialité, pour lutter contre la solitude tout en permettant à chacun d’entre eux de s’épanouir et le moment venu de procréer d’autres hommes. Mais cela est une autre histoire !
Illustration de titre : ATLAS en train de travailler avec l’homme. Crédit Boston Dynamics
Liens (avec mes remerciements à mon ami Patrick) :
https://www.bostondynamics.com/atlas
https://www.bostondynamics.com/
Pour (re)trouver dans ce blog un autre article sur un sujet qui vous intéresse, cliquez sur :
Index L’appel de Mars 23 04 20
et pour continuer à lire mes nouveaux articles sur l’exploration spatiale après le 30 juin:
ou dans les pages du Temps dans la rubrique “Opinions/débats” quand la Direction du Journal le jugera utile pour son lectorat général.