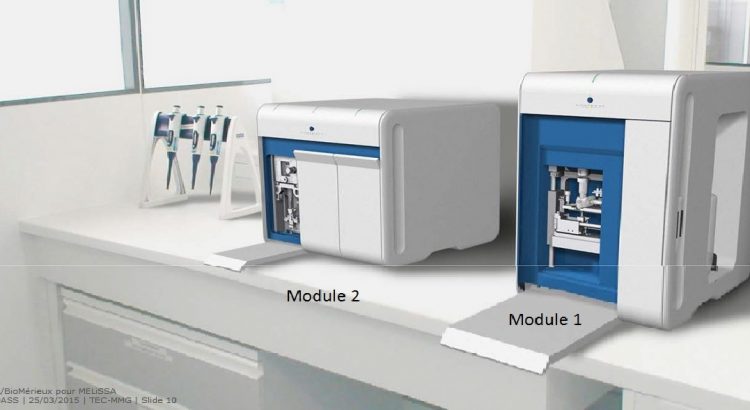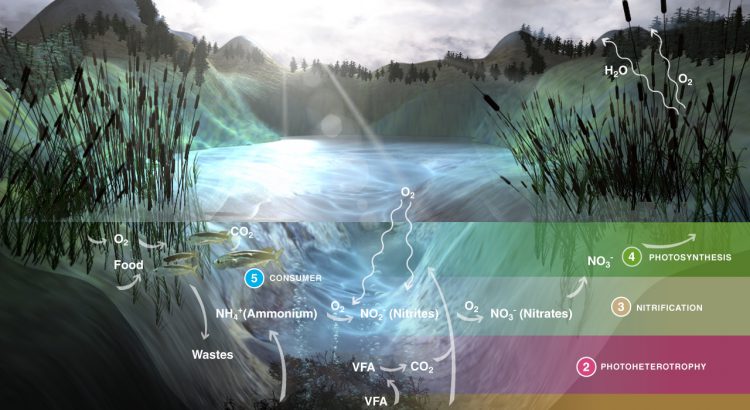Il ne faut pas qualifier trop vite de « Nouvelle Terre » l’exoplanète « Proxima-b » dont la découverte a été confirmée dans Le Temps du 25 août ! La comparaison avec notre Terre ne peut se faire qu’en prenant en compte d’une part la masse de son étoile, Proxima Centauri, par rapport à celle du Soleil, et d’autre part la distance de Proxima-b à Proxima Centauri par rapport à la distance de la Terre au Soleil, ainsi que la masse et la densité de Proxima-b par rapport à celles de la Terre. Cela donne des résultats dont l’intérêt est certain mais qu’il ne faut pas exagérer.
Selon ces critères, sa masse de 1,30 fois celle de la Terre et sa densité (roche et non gaz) font bien de Proxima-b une sœur de notre planète. Un homme sur son sol aurait à peu près la même sensation de pesanteur que sur Terre. Notons que la détection d’une planète rocheuse de la taille de la Terre est d’autant plus difficile que l’on en est éloigné et que c’est bien parce que Proxima Centauri est l’astre le plus proche du Soleil (4,23 années lumières soit 45.000 millards de km) que l’on a pu déceler la présence de Proxima-b malgré sa petite taille (on ne la « voit » pas, on la « perçoit » indirectement par des oscillations infimes de son étoile résultant de son jeu gravitationnel avec elle).
La température moyenne au sol (estimée à -30°C/+30°C) de Proxima-b est un autre critère de ressemblance. Combiné à la masse et à la densité il permet effectivement d’envisager de l’eau liquide en surface…pourvu que la planète ait une atmosphère et que la pression de cette atmosphère au sol se situe sensiblement au-dessus du point triple de l’eau (611 pascals, soit 0,61 % de notre pression atmosphérique au sol).
C’est tout ce qu’on peut dire de positif sur cette planète ; les autres données que l’on a recueillies ne font pas d’elle un endroit très hospitalier. En effet, si la température en surface est relativement « douce » c’est bien sûr que la distance à l’étoile est adéquate mais le résultat est obtenu grâce à une combinaison qui est loin d’être « plaisante ». Proxima-b doit être très proche de son étoile, et elle l’est effectivement (7 millions de km seulement alors que Mercure se trouve à 36 millions de km et la Terre à 150 millions), parce que cette étoile est une naine rouge, dix fois moins massive que le soleil et mille fois moins lumineuse (et moins chaude). Plus éloignée, elle serait glacée. Cette proximité n’est cependant pas sans conséquences négatives. D’abord la force de gravité de l’étoile a bloqué la planète dans sa rotation sur elle-même (« tidal locking »). Comme la Lune par rapport à la Terre, Proxima-b présente toujours la même face à Proxima Centauri. Il faut donc imaginer d’une part une face sans nuit et chaude, et d’autre part une face sans jour* et froide. Par ailleurs Proxima Centauri est une sorte d’étoile avortée et instable du fait de sa faible masse. Elle n’expulse pas l’énergie résultant de la combustion de son hydrogène par radiations mais par mouvements physiques de plasma. Aussi les mouvements de convection internes génèrent un champ magnétique permanent mais irrégulier et l’énergie magnétique est libérée par des éruptions violentes qui peuvent comporter énormément d’ultraviolets durs (« C ») et de rayons X. Ces émanations et radiations balayent très fréquemment la surface de Proxima-b.
* la lumière parvenant des deux autres étoiles (Alpha Centauri A & B) du système triple dont fait partie Proxima Centauri ne peut pas éclairer fortement Proxima-b et ceci bien qu’Alpha Centauri A soit une étoile de la classe du Soleil, car Proxima Centauri est séparée de ses deux compagnes par quelques 13.000 UA (1 UA = distance Terre / Soleil) soit 2.000 milliards de km (rappelons pour comparaison que la distance moyenne de Pluton à la Terre est de 6 milliards de km).
La configuration de Proxima-b n’incite donc pas à une quelconque mission habitée…d’autant que, avec les moyens d’aujourd’hui, il faudrait 19.000 ans pour l’atteindre dans le meilleur des cas (vitesse de 240.000 km/h acquise par la sonde Hélios 2 de la NASA grâce à la très forte gravité solaire). Pour aller plus vite, la presse a parlé récemment du projet « Breakthrough Starshot » du Russe Youri Milner, cautionné par Stephen Hawking. Il s’agirait de propulser des voiles dans l’espace avec de la lumière provenant de très puissants rayons lasers (lumière cohérente sur de très longues distances), vieux concept imaginé au début des années 1980 par Robert Forward dans son magnifique roman « Flight of the Dragonfly ». On pourrait ainsi atteindre 20% de la vitesse de la lumière et donc faire le voyage en vingt ans. « Petit » problème : il faudrait énormément d’énergie pour générer ces rayons lasers et aussi pour freiner le vaisseau lorsqu’on serait arrivé à destination (et il n’y a personne de l’autre côté !). On est là dans le domaine de la science-fiction même si la science « dure » n’est pas loin.
On sera donc encore longtemps condamnés à simplement observer la planète, faire de l’astronomie et non de l’astronautique…mais ce n’est déjà pas si mal. On le fera certainement de mieux en mieux, ne serait-ce qu’avec les grands télescopes de l’ESO dans le désert chilien, dans l’espace avec le JWST, successeur de Hubble, ou autres (voir ci-dessous*). C’est d’ailleurs cela qui intéresse les astronomes du groupe « Pale Red Dot » qui se sont regroupés pour l’identification et l’approfondissement de nos connaissances concernant Proxima-b. C’est une aubaine pour eux que l’étoile la plus proche gouverne une planète rocheuse à peu près de la taille de la Terre. Cela va leur permettre de tester et d’améliorer leurs moyens d’observation des exoplanètes, indirects et un jour directs.
Autre intérêt : avoir trouvé Proxima-b si près de nous implique que les exoplanètes de ce type ne sont pas rares et que l’on en trouvera bien d’autres dans notre environnement proche (c’est-à-dire juste un peu plus lointain) au fur et à mesure de l’amélioration de la précision de nos instruments d’observation et des théories de nos astronomes. Ce qui serait “formidable” ce serait de découvrir une planète semblable à la Terre juste à côté, dans le monde d’Alpha Centauri A qui est, elle, un vrai “soleil”. Rappelons que Pandora la “planète” du film Avatar de James Cameron, est une lune (pour le moment totalement hypothétique) qui orbite autour de Polyphème, une géante gazeuse (également aujourd’hui hypothétique) située dans la zone habitable d’Alpha Centauri A. Selon James Cameron l’action se déroule en 2154! Si les astronomes débusquent un jour Pandora ou sa sœur, nul doute que ce serait un aiguillon très efficace pour développer les moyens astronautiques nécessaires pour l’atteindre.
Image à la Une : localisation et composition de notre système stellaire voisin, Alpha Centauri. Crédit organisation Pale Red Dot.
Autre image (ci-dessous) : vue d’artiste de Proxima Centauri à partir du sol de Proxima-b. Crédit : ESO.
liens :
vers le projet « Pale Red Dot » :
vers l’initiative « Breakthrough Starshot » :
https://breakthroughinitiatives.org/Initiative/3
*NB: Les astronomes du projet « Pale Red Dot » qui, pour le nom, se sont inspirés du « Pale Blue Dot » de Carl Sagan ont utilisé l’instrument « HARPS » (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) annexe du télescope de l’ESO de 3,6 mètres de diamètre de l’Observatoire de La Silla au Chili. Ils continuent avec les réseaux d’observatoires de « LCOGT » (Las Cumbres Observatory Global Telescope Network) et de « BOOTES » (Optical Observer and Transient Exploring System).