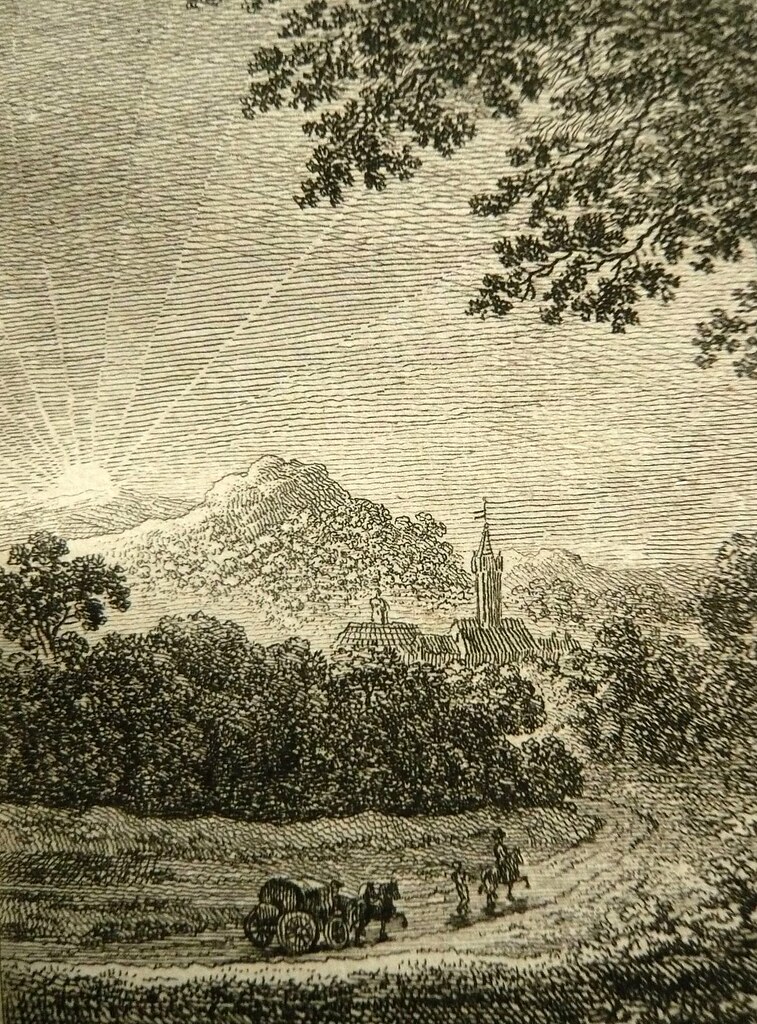Michel Porret: “Effroi urbain” (Saint-Julien en Genevois, samedi 5 septembre 2021).
Michel Porret: “Effroi urbain” (Saint-Julien en Genevois, samedi 5 septembre 2021).
Comme l’écrit en 1978 l’historien du sentiment religieux Jean Delumeau dans La Peur en Occident, dès la fin du Moyen âge, la «cité est assiégée». S’y réitèrent «à intervalles plus ou moins rapprochés, des épisodes de panique collective, notamment lorsqu’une épidémie s’abattait sur une ville ou une région» (p.98). Après les mesures sanitaires étatiques du premier «confinement» (quarantaine domiciliaire) imposé un peu partout en Europe entre mars 2019 et mai 2020 contre la pandémie de la Covid-19, nous vivons méfiants, inquiets, apeurés et alarmés. La cité est assiégée, comme le rappellent les nouvelles mesures sanitaires édictées vendredi 8 septembre 2021 par le Conseil fédéral, pour application dès le 13 septembre.
| https://www.academie-francaise.fr/le-covid-19-ou-la-covid-19: «l’emploi du féminin serait préférable; il n’est peut-être pas trop tard pour redonner à cet acronyme le genre qui devrait être le sien». |
Anthropologie de l’effroi
Masques, gestes barrières, désinfection quotidienne, écart corporel, dépistage manuel et automatisé par température: la nouvelle culture sanitaire augmente l’intolérance sensible au morbide, pour paraphraser Alain Corbin. Elle nous transforme en acteurs improvisés d’une histoire sociale et planétaire de la peur qu’accélère la médiatisation continuelle et irréfléchie de la forte mortalité due à la Covid-19, dont la courbe saisonnière oscille entre embellie et rechute. Cette anthropologie de l’effroi culmine avec les rituels du deuil escamoté qui marque le temps des catastrophes humaines, des épidémies aux guerres selon Alessandro Pastore. Peut-on oublier l’étreinte de la mort collective, les convois militaires funéraires et les inhumations solitaires en vrac à Bergame, épicentre pandémique en Italie?
La démocratie pandémique
Le régime d’«exception ordinaire», mis aux libertés individuelles et collectives, mène-t-il à la «démocratie en pandémie»? Peut-on associer ces deux termes? Le «Lock down» sanitaire, selon Xavier Tabet, est un moment politique inédit par son ampleur où le droit à la vie est ancré dans la biopolitique au profit de la majorité mais avec des risques liberticides. Comment l’État de droit va-t-il ajuster durablement le paramètre politique de la démocratie pandémique? À moyen terme, dans le pire des mondes possibles, entre macro-économie et discipline sociale, la «gouvernance de la peur» peut certainement rapprocher les États libéraux et autoritaires, comme parfois les guerres l’ont fait. Est-elle probable cette nouvelle alliance sanitaire du régime d’exception pour miner l’offensive pathologique de Covid-19? En Chine comme aux U.S.A., les lieux publics réservés aux personnes doublement vaccinées se multiplient. À New York, de nombreux commerces affichent «No mask. No Entry».
Mal pandémique, mal moral
Au risque contagieux, que depuis 6 mois endiguent les campagnes vaccinales sur fond de rivalités scientifiques et d’enjeux économiques colossaux entre trusts pharmaceutiques, suit la crainte anti-vaccin. L’auto-défense des «antivax» et des «anti-passes» dérive en refus «libertaire». Une minorité politiquement hétéroclite conteste l’État providence sanitaire. Le vaccin et le «passe sanitaire» symbolisent la tyrannie hygiénique. «Ma liberté » — dit-on— est «incompatible avec votre politique préventive». À bas la dictature sanitaire!
Dans ce contexte de délabrement moral et social, un problème crucial noircit l’horizon : le mal pandémique réveille le mal moral. Le libertarisme anti-sanitaire devient antisémite. En «retournant les stigmates» du mal, il brouille sciemment la mémoire collective du mal. «Non au passe nazitaire; Prochaine étape: rafle des non vaccinés» : sous de tels slogans, en France, mais aussi en Suisse et ailleurs, la mobilisation graduelle «anti-passes et anti-vaccins» a des relents nauséabonds. Numéros tatoués sur les avant-bras de manifestants qui arborent une étoile jaune, étoile de David peinte sur la façade d’un centre de vaccination (Neuillé-Pont-Pierre, Indre-et-Loire), huée contre les «empoisonneurs juifs» : l’hostilité anti-sanitaire emprunte le symbolisme concentrationnaire de l’antisémitisme nazi entre 1939 et 1945.
Résurgence de la haine
Ce «phénomène viral» canalise et attise la résurgence de la «haine antijuifs» (rancune confuse contre les «institutions de l’ordre établi»; haine trouble des élites, haine jalouse du cosmopolitisme). Selon Tal Bruttmann, remarquable historien de la Shoah, nous assistons sous la pandémie à l’inquiétante et décomplexée «jonction entre l’antisémitisme primaire de ceux qui pensent que le vaccin a été inventé par les juifs pour détruire les autres, et l’antisémitisme plus politique de ceux qui disent que les juifs contrôlent les médias, le pouvoir» (Le Monde, 19 août 2021). Dès l’aube de la pandémie, toujours complotistes, toujours marquées par les rumeurs invraisemblables, les démesurées «accusations à relents antisémites» sur les réseaux sociaux (Europe, Russie, États-Unis) renouent avec l’imaginaire criminel des «allégations d’empoisonnement» qui ont culminé au Moyen âge.
Cette constante de l’antisémitisme chrétien et politique né avec peste noire (mi-XIVe siècle), comme l’a montré le grand historien italien de la chasse aux sorcières Carlo Ginzburg, peut se banaliser dans le durcissement de la démocratie sanitaire. Or, il y a pire.
En comparant la politique sanitaire de l’État providence aux rafles antijuives et le président Macron ou le Conseil fédéral à Hitler et à l’État totalitaire, la mouvance antisémite des antivax et des anti-passes relativise la «barbarie nazie». Les droites nationalistes et extrêmes hostiles à l’État libéral et à la culture de l’État providence trouvent leur compte dans la chimère pseudo libertaire.
La pandémie de la Covid-19 pose ainsi un double défi démocratique, complexe à résoudre, impératif pour l’avenir de nos enfants: sortir de la gouvernance de la peur en plaçant sans concessions autoritaires le droit à la vie sous le régime de l’État de droit; combattre le renversement des stigmates qui relativise et réactive le mal moral toujours assoupi. Un gros chantier pour abattre la populisme sanitaire et ses démons pestilentiels, spectres hideux d’un autre temps!
Lectures utiles:
Gastone Breccia, Andrea Frediani, Epidemie e Guerre che hanno cambiato il corso della storia, Newton Compon, 2020; Cécile Chambraud, Louise Couvelaire, « Mobilisations anti-passe sanitaire : l’antisémitisme d’extrême droite resurgit », Le Monde 19.08. 2021 (p. 8-9); Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social 18e-19e siècles, Aubier, 1982; Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégée, Paris, Fayard, 1978; Carlo Ginzburg, Le Sabbat des sorcières, Paris, Gallimard, 1992; Marino Niola, « Perché oggi è cosi eguale a ieri », La Republica, Robinson, 243, 31.07.2021 (p. 4-5); Alessandro Pastore, Crimine e giustizia in tempo di peste nell’Europa moderna, Roma-Bari, Laterza, 1991; Corey Robin, La Peur, histoire d’une idée politique, Armand Colin, 2006; Barbara Stiegler, De la Démocratie en pandémie. Santé, recherche, éducation, Tracts Gallimard (23), janvier 2021; Xavier Tabet, Lockdown. Diritto alla vita e biopolitica, s.l., Ronziani numeri, 2021.
Rappel : quelques offensives pandémiques
Peste d’Athènes : 430-426 av. J.C.
Peste antonine : 65-180
Peste justinienne : 542
Peste noire : 1347-1350
Peste d’Arles : 1579-1581
Peste de Londres : 1592-1593
Peste espagnole : 1596-1602
Peste italienne : 1629-1631
Grande peste de Naples. 1656
Grande peste de Séville : 1647-1652
Grande peste de Londres : 1665-1666
Grande peste de Vienne : 1679
Grande épidémie de variole en Islande : 1707-1709
Épidémie de peste de la Grande guerre du nord (Danemark, Suède) : 1710-1712
Peste de Marseille : 1720-1722
Grande peste des Balkans : 1738
Peste de Russie : 1770-1772
Peste de Perse : 1772-1773
Variole des Indiens des plaines : 1780-1782
Fièvre jaune des États-Unis : 1793-1798
Épidémie ottomane : 1812-1819
Première pandémie de choléra :1817-1824 (Afrique orientale, Asie mineure, Extrême-Orient)
Deuxième pandémie de choléra : 1829-1851 (Asie, Europe, U.S.A.)
Variole des grandes plaines (USA) : 1837-1838
Troisième pandémie de choléra : 1846-1860 (Monde)
Peste de Chine : 1855-1945 (Monde)
Quatrième pandémie de choléra : 1863-1875 (Europe, Afrique du Nord, Amérique du Sud)
Cinquième pandémie de choléra : 1881-1896 (Inde, Europe, Afrique)
Grippe russe : 1889-1990 (Monde)
Sixième pandémie de choléra : 1899-1923 (Europe, Asie, Afrique)
Grippe espagnole : 1918-1920 (Monde) : 50 à 100 millions de †
Grippe asiatique : 1957-1958 (Monde) : 1 à 4 millions de †
Septième pandémie de choléra : 1961-présent (Monde)
Grippe de Hong-Kong : 1968-1969 (Monde) : 1 à 4 millions de †
Grippe russe : 1977 (Monde)
SIDA (1920) : 1980-présent (Monde) : 32 millions de †
Grippe A (H1N1) : 2009-2010 (Monde)
Ebola : 2013, 2018 (Afrique de l’Ouest ;République/Congo)
LDM 76