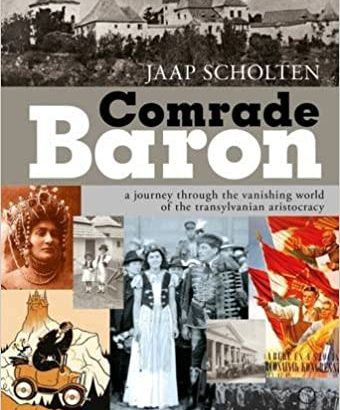La Ligne Claire sollicite l’indulgence de ses lecteurs en raison de la longueur inhabituelle de ce blog. Cet essai sur la monarchie entend souligner les mérites de cette institution tout en répondant aux arguments de ses détracteurs.
–0–
Le départ en exil du roi Juan Carlos a amené certains, le parti Unidas Podemos par exemple, à réclamer non seulement la poursuite du cours de la justice à l’encontre du citoyen Juan-Carlos de Borbón y Borbón mais l’abolition de la monarchie même. Il est toujours malaisé de distinguer les critiques envers la personne de l’ex-souverain de celles envers l’institution du fait même que la personne n’est le souverain qu’en vertu de l’institution. En revanche, il est plus aisé de passer en revue les arguments avancés par les détracteurs de l’institution, et qu’on peut regrouper en trois catégories :
– le caractère héréditaire, supposé contraire aux principes démocratiques,
– le souverain est à l’abri d’une sanction électorale, de sorte qu’il ouvre la porte à de possibles abus de pouvoir,
– le coût réputé élevé de l’institution monarchique.
Dynastie et hérédité
La Ligne Claire avance la théorie selon laquelle l’institution monarchique n’est que l’application à l’organisation de l’État d’un phénomène universel et de tous temps, la dynastie. Ainsi, en dépit d’une république en guise de cache-sexe, la Corée des Kim et la Syrie des Assad, de même qu’en son temps le Cuba des frères Castro, fonctionnent en réalité sur le mode dynastique. Plus encore, des pays qui dans un passé pas trop lointain se sont affranchis de la Couronne britannique se sont empressés de reproduire en leur sein ces mêmes mécanismes : en Inde la dynastie Nehru-Gandhi a longtemps dominé la vie politique, sans rien céder à la famille Bhutto au Pakistan voisin, tandis qu’aux États-Unis, dès leur constitution, des dynasties politiques voient le jour, les Adams d’abord suivis des Roosevelt et des Bush à notre époque. Bien plus, nombre d’usurpateurs, au rang desquels Bonaparte figure en première place, s’empressent, une fois le pouvoir assuré, d’établir une dynastie nouvelle. Dans d’autres domaines de l’activité humaine se sont fait jour des dynasties d’artistes (Breughel, Bach), d’industriels (Ford, Rockefeller, Peugeot), de banquiers (Rothschild, Pictet) et de scientifiques (Bernoulli), manifestations d’un phénomène de tous lieux et de tous temps, et qui n’est pas propre à l’institution monarchique.
Monarchie héréditaire et monarchie élective
A côté de la monarchie héréditaire cohabite la monarchie élective. L’Europe en a connu plusieurs parmi lesquelles on peut citer le Saint-Siège, qui subsiste, la République de Venise, qui était en réalité une oligarchie et le Royaume de Pologne, où l’élection du souverain en a fait le jouet de ses puissants voisins, la Russie et la Prusse et a conduit à la disparition de l’État vers la fin du XVIIIe siècle. Quant à elle, si la dignité impériale était en principe élective en Occident, dans la pratique elle était devenue héréditaire dans la maison de Habsbourg à partir de 1452, qui par le fait même en a assuré la pérennité.
Pourquoi donc le système de la monarchie élective n’a-t-il pas fait ses preuves, à savoir un État stable, voire puissant ? On pourrait penser pourtant que le système n’offre que des avantages : à chaque élection, le corps électoral, quel qu’il soit, élit le candidat le plus apte ; celui-ci, élu à vie, n’a pas à se soucier de sa propre réélection et peut donc se vouer tout entier à la promotion du bien commun. Or, c’est précisément le contraire qu’on observe, à savoir que la monarchie élective devient aussitôt l’enjeu de factions, de partis, dirions-nous de nos jours, si bien que le souverain se comporte de fait comme un chef de bande, envers qui il devient redevable.
En vue de mettre fin à la pratique héritée des Francs de partager l’héritage d’un chef parmi tous ses fils, qui s’était avérée une source de division perpétuelle et surtout d’instabilité politique, les Capétiens adoptent à partir du Xe siècle le modèle de la monarchie héréditaire, auquel ils ajoutent une règle certes arbitraire mais simple et efficace, la primogéniture masculine. Quarante rois se succéderont en application de cette règle au fil de huit cents ans. Ce faisant, les Capétiens assurent non seulement leur propre survie mais celle de l’Etat, par-delà les menaces graves, la guerre de Cent Ans par exemple. Un système qui à chaque génération fait l’impasse sur les compétences de son successeur, a donné des saints et des fols, des longs et des gros, ma foi à l’image de l’humanité tout entière, tout en assurant une gestion efficace de l’Etat. On ne saurait donc trop insister sur ce constat qui surprendra certains: l’institution monarchique, combinée au principe héréditaire, constitue un facteur essentiel de la stabilité, de la pérennité et même de la grandeur de l’Etat.
Pour durer, tout système politique doit être perçu comme légitime et assurer une certaine efficacité. Illégitime, il sera renversé et inefficace, il le sera aussi. De ce point de vue la monarchie héréditaire se révèle redoutablement efficace : pour assurer sa succession, il suffit que le roi couche avec la reine, c’est-à-dire avec son épouse légitime, car le fruit de cette union, le futur chef de l’Etat, ne saurait être illégitime. Une nuit d’amour et voilà assurée la continuité de l’État, on ne saurait faire mieux.
Monarchie absolue et tyrannie
Si de nos jours on ne formule pas l’objection de l’absolutisme à l’encontre de l’institution monarchique, il ne paraît pas inutile dans le cadre de cet article de rappeler ce qu’il y a lieu d’entendre par monarchie absolue, dont la manifestation la plus éclatante demeure bien entendu Louis XIV. Pouvoir absolu signifie pouvoir parfait, c’est-à-dire complet ou encore achevé, mais ne signifie en aucun cas que le roi règne sans entrave ou de façon arbitraire. Le roi est lié tout d’abord par les lois fondamentales du royaume, sorte de constitution non-écrite, qui gouvernent notamment les règles en matière successorale. « Je suis dans l’heureuse impossibilité de n’y pouvoir rien changer » dira plus tard Louis XV à ce propos, indiquant tout-à-fait clairement qu’être bénéficiaire de la loi successorale ne signifie pas en être le maître ; même l’abdication n’est pas laissée au seul bon plaisir du roi : ainsi en 1936, c’est en vertu d’une loi votée par le Parlement que le roi Edouard VIII est autorisé à abdiquer. En outre, le roi est lié par le droit coutumier si bien que dans la réalité des faits il est confronté à un maquis de règles, de lois et d’ordonnances qui sont invoquées par des pouvoirs locaux, parlements de province par exemple, précisément pour contrer son autorité ; enfin le roi est lié par les traités qu’il conclut lui-même avec les puissances étrangères. Les limites à l’exercice du pouvoir royal sont donc à la fois réelles, nombreuses et efficaces. Retenons donc que le monarque absolu n’est en aucun cas un tyran, pas même un souverain qui règne de manière arbitraire, mais au contraire une personne que sa charge oblige.
Absence de sanctions
Dans ce contexte, l’impossibilité de sanctionner le souverain s’explique et se justifie donc très clairement. Autant le tyran se met à l’abri des sanctions par le fait même de son pouvoir tyrannique, c’est-à-dire l’oppression de ses opposants, autant l’absence de sanction du roi légitime doit être entendue comme un mécanisme qui assure la stabilité de l’institution et son inviolabilité. En effet, la possibilité de sanctionner le roi, que ce soit de manière formelle ou non, ouvre bien entendu la porte à une élection plus ou moins déguisée de son successeur.
Ce sont donc les textes de loi qui gouvernent le pouvoir royal qui font office de sanction. Au Royaume-Uni, où le souverain ne jouit plus d’un pouvoir effectif, la notion même de sanction perd de son sens. En Belgique, la Constitution en son article 106 stipule expressément qu’aucun acte du Roi n’est valable en l’absence du contreseing d’un ministre qui par le fait même de ce contreseing se rend responsable de cet acte. Si donc c’est le ministre qui est responsable et non pas le Roi, la question de la sanction de la personne du Roi est vide de sens.
Coûts
Il n’entre pas dans le cadre de cet article d’effectuer un audit des coûts liés à la monarchie en Espagne ou ailleurs. On se bornera donc à formuler à ce propos quelques remarques de portée générale.
Tout d’abord, la question des coûts est une question accessoire en ce sens qu’elle ne touche pas en tant que telle à l’essence de l’institution monarchique. C’est d’autant plus vrai qu’il revient au Parlement de fixer le montant de la liste civile.
Si la monarchie est susceptible de s’entourer d’un certain faste, plus ou moins coûteux, très variable selon les pays et les époques, elle n’en a aucunement le monopole : qu’on songe aux défilés du 14-Juillet, aux cérémonies d’investiture du Président des Etats-Unis ou encore aux parades grandioses qui se déroulent en Chine ou en Corée du Nord. De plus, certains coûts fixes liés à certaines monarchies sont amortis depuis des siècles tandis que les frais d’exploitation variables sont à mettre en rapport avec les avantages très réels qui découlent de la pérennité de l’institution, une qualité particulièrement appréciée à l’étranger. Même la République française n’hésite pas à tirer parti de Versailles ou de Chambord, où les visiteurs affluent par milliers. Enfin, notons que certaines fonctions présidentielles, à nouveau celle des Etats-Unis par exemple, peuvent s’avérer très coûteuses.
Conclusion et Épilogue
La monarchie se révèle l’application de phénomène dynastique, une réalité observable de l’activité humaine, à l’organisation de l’État tant et si bien que, même lorsque l’État revêt la forme extérieure de la république, l’attachement et le prestige de la dynastie persistent, que ce soit en Bavière, en Afrique auprès des chefs coutumiers ou des maharadjahs en Inde.
De l’avis de La Ligne Claire, Juan Carlos a sans aucun doute attenté au prestige de l’institution qu’il a incarnée pendant près de 40 ans. Que ceux qui songent à la museler gardent à l’esprit le sort de Stanislas Poniatowski. Élu roi de Pologne en 1764, l’ancien amant de Catherine la Grande deviendra vite le jouet des Russes. Il présidera au dépècement de son royaume et mourra en exil. Avec lui disparaissait non seulement la royauté mais pour 130 ans l’État polonais.
WordPress:
J’aime chargement…