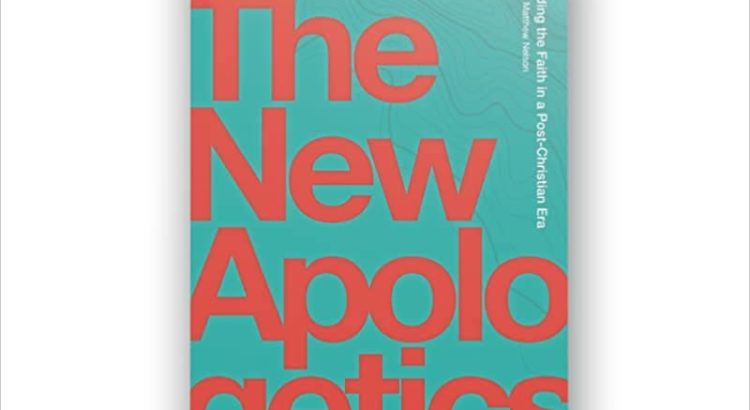Le Saint-Suaire de Turin fait partie des objets les plus étudiés au monde si bien qu’on ne compte plus les ouvrages qui lui ont été consacrés, parmi lesquels celui de Jean-Christian Petitfils, « L’enquête définitive » figure en dernière date. L’auteur a pour objectif de démontrer l’authenticité du suaire de Turin à travers une triple analyse historique, scientifique et artistique et entend notamment réfuter les conclusions d’une datation au Carbone 14 en 1988 et qui datait le linceul du XIVe et en faisant donc un faux. En réalité, plutôt que d’un suaire, à savoir un voile qui recouvre la tête d’un défunt, il s’agit d’un linceul, un linge qui enveloppe le corps tout entier. Dans ce contexte le caractère authentique du linceul signifie que c’est celui qui a enveloppé Jésus-Christ lors de la mise au tombeau.
Petitfils, ancien banquier à la retraite, auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés en particulier au Grand Siècle, incarne une tendance où le narrateur raconte l’histoire académique en adoptant le style d’un ouvrage de vulgarisation. Auteur en 2013 d’une biographie de Jésus, Petitfils aborde ici l’histoire du linceul conservé de nos jours dans une chapelle de la cathédrale Saint Jean à Turin et qui laisse apparaître les marques des supplices, flagellation, crucifixion, couronne d’épines, infligés à Jésus de Nazareth, tels que les rapportent les Évangiles. D’emblée il avertit son lecteur que son livre n’aborde pas une question de foi mais constitue une enquête à propos d’une énigme qui touche à la foi.
Histoire du linceul
Les plus anciennes preuves indiscutables du suaire que nous connaissons aujourd’hui à Turin remontent à la deuxième moitié du XIVe siècle en Champagne. Or, on peut dater la mort de Jésus au 3 avril de l’an 33 de notre ère. Que s’est-il passé entretemps ? En 387 à Édesse, alors une ville byzantine, aujourd’hui la ville turque d’Urfa, est documentée la première apparition d’un linge dont Petitfils pense qu’il est l’actuel Saint-Suaire de Turin. Face à ce trou de près de quatre siècles, on ne peut affirmer de certitudes si bien que l’auteur est contraint de formuler de nombreuses suppositions ou d’en rendre compte. En 944 ce linceul supposé est exposé à Constantinople à l’occasion de la fête de l’Assomption ; à la suite du sac de Constantinople par les croisés latins en 1204, le linceul aurait été vendu au Roi de France qui l’aurait cédé à un fidèle, Geoffroy de Chancy, qui fera construire au XIVe siècle une collégiale destinée à l’abriter à Lirey, dans le diocèse de Troyes en Champagne. Le linceul deviendra ensuite propriété de la Maison de Savoie qui en cèdera la propriété au Saint-Siège en 1983.
Le linceul et la science
En 1898, un photographe turinois appelé Secondo Pia prend la toute première photo du linceul. Il découvre stupéfait que le linceul est en réalité un négatif de sorte que le négatif argenté de Pia révèle en positif le visage de l’homme que le linceul a enveloppé.
Depuis lors le linceul fera l’objet de nombreuses études scientifiques dont la datation au Carbone 4 de 1988 que Petitfils qualifie de fiasco en raison de la violation des protocoles et du choix des échantillons qui ont pu être contaminés par les ravages d’un incendie de 1532 et le raccommodage qu’il avait subi à sa suite.
Toute cette partie peut s’avérer ardue pour le lecteur dont les connaissances en matière de sciences de la nature, comme celles de La Ligne Claire, se sont arrêtées au Bac C. Petitfils passe en revue les travaux de physiciens, de chimistes, de statisticiens, de spécialistes des textiles anciens, de photographes, de médecins légistes, de botanistes, d’archéologues, de numismates et d’historiens dans le but de démontrer le caractère authentique du linceul. Si on peut saluer ce travail, il demeurera difficile au lecteur novice de forger sa propre opinion d’autant qu’il trouvera sans peine une argumentation contraire sur internet. De ce point de vue, La Ligne Claire déplore le choix du sous-titre « l’enquête définitive » non seulement en raison de sa tonalité quelque peu sensationnelle mais parce qu’après Petitfils viendront d’autres chercheurs, qui disposeront de nouveaux outils inconnus aujourd’hui et qui permettront justement de faire avancer la science. Tout récemment par exemple, au printemps de cette année, une étude aux rayons X a suggéré que le linceul avait 2000 ans d’ancienneté, une condition nécessaire à son caractère authentique.
La représentation de Jésus dans les arts
Enfin, dans la troisième partie l’auteur fait observer qu’au tout début du christianisme, il n’existait pas de représentation de Jésus car la loi juive interdisait l’art figuratif. Plus tard les premières représentations s’inspireront de l’art païen et on verra Jésus représenté comme un berger par exemple. Mais ce n’est qu’au Ve siècle, c’est-à-dire peu après l’apparition du linceul à Édesse, qu’on voit apparaître la représentation de Jésus qui nous est désormais familière et qui s’en inspire directement : cheveux partagés par une raie, barbe bifide etc. Petitfils y voit une marque du caractère authentique, tel qu’il était perçu alors.
Argumentation
En définitive Petitfils avance quantité d’arguments en faveur du caractère authentique du linceul : tissu issu du Proche-Orient au 1er siècle, pollens de plantes propres à la Judée, fleurs fleurissant au printemps, détection de piécettes de monnaie frappées sous Ponce Pilate, marques de la flagellation par un fouet romain, la plaie infligée par une lance romaine, marques du supplice romain de la crucifixion. Les piécettes par exemple ne sont pas décelables à l’œil nu si bien que même les partisans de l’authenticité hésiteront à suivre Petitfils sur ce terrain-là. Les lecteurs soucieux d’examiner les détails du linceul pourront le faire ici ou encore ici ; ils y apprendront par exemple que l’image de l’homme au linceul est non seulement un négatif mais qu’elle est tri-dimensionnelle.
Dans tout ce débat l’Église, désormais propriétaire du linceul, favorable en principe aux études scientifiques, se tient prudemment à l’écart des débats au sujet de leur interprétation. La foi en la Résurrection constitue le cœur du christianisme mais que le linceul soit une véritable relique ou une simple icône n’apporte pas de démonstration de cet article de foi. Lors de la dernière ostension du Saint-Suaire à Turin en 2020, La Ligne Claire et son épouse avaient contemplé émus l’homme du linceul revêtu des marques du supplice atroce de la flagellation puis de la crucifixion. Cela leur a suffi. Pour cette raison, La Ligne Claire juge que le livre de Petitfils ne convaincra que les convaincus.
Jean-Christian Petitfils, Le Saint Suaire de Turin – l’enquête définitive, Taillandier, 2022, 464 pages
WordPress:
J’aime chargement…