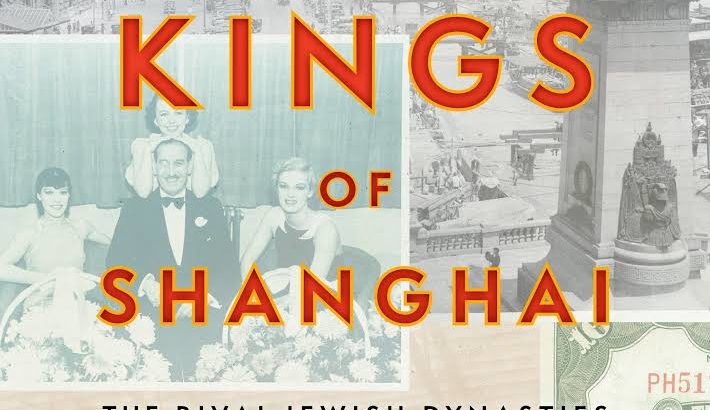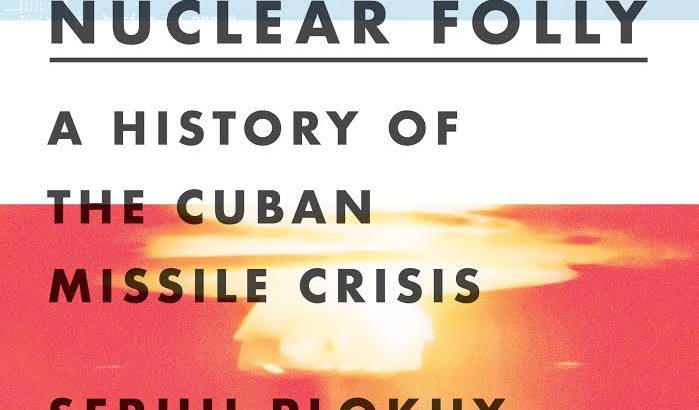En 597 avant notre ère, Nabuchodonosor emmenait les Hébreux en déportation à Babylone, la future Bagdad, où jusqu’à une époque récente allait fleurir une des plus importantes communautés juives du Proche-Orient. Quelques vingt-cinq siècles plus tard, vers la fin du XIXe siècle, David Sassoon, issu de la plus éminente des familles marchandes juives mizrahim, allait quitter la ville, alors sous domination turque, pour gagner Bombay (aujourd’hui Mumbai), capitale économique de l’empire britannique des Indes ; ses descendants allaient poursuivre cette course et fonder des entreprises commerciales à Shanghai et à Hong Kong. Elly Kadoorie, quant à lui, appartient lui aussi à une famille, certes moins prestigieuse que les Sassoon, de financiers et de marchands juifs de Bagdad. Jeune homme, il quittera la ville et trouvera de l’emploi chez les Sassoon à Bombay, d’où il gagnera Hong Kong en 1880.
Jonathan Kaufman, journaliste et professeur d’université américain titulaire du prestigieux prix Pulitzer, raconte ici l’histoire croisée de ces deux dynasties de juifs babyloniens qui se sont constitué des fortunes immenses en Chine, au départ en y exportant de l’opium cultivé aux Indes. C’est l’époque où Shanghai figure parmi les villes les plus cosmopolites au monde, gérée de manière autonome au sein des concessions internationales alors que tout autour l’Empire de Chine se délite puis sombre dans la guerre civile et enfin tombe proie aux appétits japonais ; c’est le Shanghai tel que le dépeint Hergé dans Le Lotus Bleu. Les Chinois voient les choses d’un autre œil et décrivent la période qui s’étend de 1842 lors de la Première Guerre de l’Opium à 1949, la date de la proclamation de la République populaire, comme le siècle d’humiliation.
Les Sassoon figureront parmi les actionnaires fondateurs de la Hong Kong and Shanghai Bank, connue aujourd’hui sous son sigle d’HSBC, tandis que les Kadoorie qui s’étaient repliés à Hong Kong après 1949 y ont refait une seconde fortune dont les principaux actifs sont la chaîne d’hôtels Peninsula et leur participation dans China Light & Power, le principal fournisseur d’électricité de l’ancienne colonie.
Kaufman décrit tout cela de manière fluide et agréable à lire, passant d’une famille à l’autre, d’où émergent de temps à autre des femmes d’exception. Cependant son récit, où l’histoire familiale se mêle à la Grande Histoire, aurait mérité d’être davantage approfondi. Par exemple, en 1938 et 1939 Shanghai avait accueilli dix-huit mille juifs en provenance d’Allemagne et d’Autriche, auxquels tant les Sassoon que les Kadoorie avaient prodigué de nombreux secours. Tout à coup en 1942, survient un colonel de la SS qui nourrit de toute évidence des intentions sinistres. Le lecteur devra imaginer par lui-même par quelle voie on peut se rendre de Berlin en Chine en pleine guerre, alors que l’Allemagne a pris d’assaut l’URSS, que le Japon vient d’essuyer une défaite de grande ampleur à Midway et que les Britanniques verrouillent le canal de Suez.
On retrouve chez Kaufman le style propre aux journalistes américains : des sources abondantes, des entretiens avec des membres des familles concernées, une bonne maîtrise du sujet qu’accompagne un art de la mise en contexte et qu’illustrent des dialogues qui, pour être vraisemblables, sont sans doute fictifs. De nombreuses vignettes contribuent du charme à ce livre agréable mais un peu léger, qui laissera quelque peu sur leur faim les lecteurs désireux d’une étude plus approfondie de près d’un siècle et demi d’histoire chinoise.
Jonathan Kaufman, The Last Kings of Shanghai, Viking, 2020, 384 pages