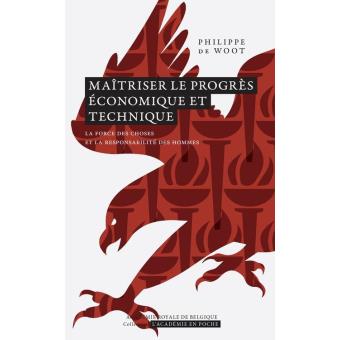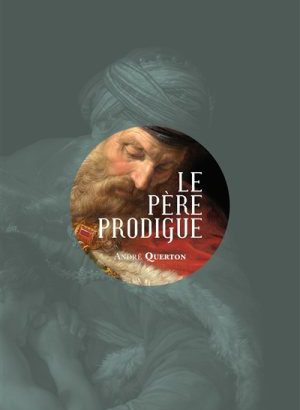Une première
Le 26 septembre dernier s’est ouverte à Paris une exposition dédiée à Hergé, la première que le Grand Palais ait jamais consacrée à un auteur de bande dessinée. D’emblée l’affiche qui illustre l’exposition, une combinaison d’une photo d’Hergé et d’un détail d’une planche figurant Tintin, en indique le vrai sujet, la quête intime que les aventures de Tintin ont constitué dans la vie d’Hergé
Car si Hergé est également l’auteur d’autres bandes dessinées, Quick et Flupke d’une part et Jo et Zette de l’autre, et qui ont chacun leur charme, s’il s’est rêvé illustrateur d’affiches publicitaires, s’il a tâté de la peinture, c’est dans les aventures de Tintin, son œuvre intime, qu’il se révèle tout autant qu’il se trouve. « Tintin, c’est moi » déclarait Hergé. Et puis, de même que Pierre Assouline [1] avait rédigé une magnifique biographie d’Hergé, cette exposition est bien vouée à Hergé et non pas à Georges Remi, son nom à l’état civil car, avec Tintin c’est aussi Georges Remi qui devient Hergé.
La Ligne Claire
Dessinateur autodidacte, Hergé se consacre avant guerre à dessiner des affiches et à raconter des histoires de BD, alors naissante, en une page seulement ; toute sa vie il excellera dans l’art du gag qui fonde les aventures de Quick et Flupke. Mais surtout il développera son propre style de dessin, très épuré mais où tout est dit, et auquel on donnera plus tard le nom « La Ligne Claire ». Proche notamment de la peinture de de Chirico, Hergé s’applique à dessiner d’abord et ce n’est qu’en un deuxième temps qu’il remplit les volumes ainsi créés de couleurs étales, sans dégradé, si bien que son œuvre en acquière cette lisibilité qui demeure la marque de son art. Plus tard, après la guerre, ce style donnera naissance à l’école belge de bande dessinée où s’illustreront les collaborateurs dont Hergé s’était entouré, Jacques Martin et Edgar P Jacobs notamment.
Le Lotus Bleu, un tournant
Chemin faisant, cette exigence du dessin se fera le reflet d’une exigence éthique si bien que les temps où Tintin abat des antilopes au Congo belge le cèdent à ceux où il découvre d’autres cultures et s’en fait en quelque sorte l’avocat. Le Lotus Bleu marque un tournant essentiel à cet égard, où Hergé met en scène Tchang Tchong Jen [2], un artiste chinois rencontré à Bruxelles, sous le nom de Tchang tout simplement. Il s’agira d’une nouvelle naissance pour Tintin, qui, nouveau Moïse, tire Tchang des eaux d’un fleuve en crue au péril de sa vie. De même que Tintin et Tchang forgeront une profonde amitié que le départ de Tintin vient attrister mais non amoindrir, Hergé et Tchang Tchong Jen noueront une relation presque spirituelle malgré une séparation d’un demi-siècle. Avec le Lotus Bleu Tintin, mais aussi Hergé, auront acquis un esprit nouveau où la générosité du cœur s’allie à la rigueur du trait.
La quête du père
Il faudra attendre l’arrivée du Capitaine Haddock pour donner à l’œuvre d’Hergé son orientation définitive. Il y a une trentaine d’années, Serge Tisseron, un psychanalyste français, proposait une lecture de l’ensemble des albums Tintin, pris non comme une collection d’ouvrages individuels mais comme un opus, une sorte de Comédie Humaine en bandes dessinées, où il mettait à jour le secret d’Hergé, la quête du père. [3]
Si Hergé en effet est bien le fils d’Alexis Remi et d’Elisabeth Dufour, il est en revanche de grand-père inconnu car un doute subsiste quant à la paternité d’Alexis et de son frère jumeau Léon, nés en 1882. Fils de Léonie Dewigne, sont-ils les enfants de Philippe Remi qui reconnaîtra les deux garçons après avoir épousé leur mère en 1883 ou au contraire d’un certain Alexis Coismans qui s’était chargé d’effectuer la déclaration de naissance ? Léonie Dewigne était employée de maison chez le comte Errembault de Dudzeele; le comte lui aurait-il prodigué des faveurs ? C’est possible. Ou encore le roi Léopold II qui venait, dit-on, rendre visite à la comtesse en son château? Cela relève de la spéculation. De tout ceci, une seule certitude demeure : la paternité d’Alexis et Léon demeure incertaine.
Cette certitude de l’incertitude imprègnera toute l’œuvre d’Hergé qui s’attachera, au travers de son œuvre, à trouver une réponse quant à l’identité de son grand-père. Très tôt, dès le quatrième album, les Cigares du Pharaon en 1932, Hergé introduit les personnages des Dupond et Dupont. Jumeaux – mais comment peuvent-ils être jumeaux puisqu’ils ne portent pas le même nom en dépit d’une ressemblance physique quasi à l’identique ? – ils renvoient bien entendu aux vrais jumeaux que sont Alexis et Léon et qui eux aussi ont connu deux noms légaux différents, Dewigne puis Remi. Sans doute Hergé s’est-il égaré sur un chemin sans issue car l’apparition de deux personnages à la fois ne permet pas de répondre à la question « Qui est mon grand-père ? » de sorte qu’il faudra attendre 1940 pour voir émerger le Capitaine Haddock dans l’épisode du Crabe aux Pinces d’Or. Il est facile d’observer que le Capitaine Haddock est tout ce que Tintin n’est pas: il est hirsute, il boit, il fume, il jure, il s’emporte, en un mot il représente une figure masculine trempée face à un visage lisse et même asexué. En créant le Capitaine Haddock, Hergé donne un père à Tintin, lui qui n’a pas de famille, premier pas indispensable vers l’identification du grand-père, c’est-à-dire vers la constitution d’une généalogie.
Il ne faudra pas attendre longtemps pour que le Capitaine Haddock lui-même se mette en quête. Dans le Secret de la Licorne, il découvre qu’il a un ancêtre, le chevalier de Hadoque, que cet ancêtre est noble, qu’il est dépositaire d’un secret transmis à ses descendants et, plus tard, à l’aide de Tintin, que ce secret révèle un trésor. Dans l’épisode suivant, le Trésor de Rackham le Rouge, non seulement Haddock et Tintin découvrent-ils le trésor mais ils découvrent que le trésor réside en fait en l’acquisition par le Capitaine Haddock du château de son ancêtre, le château de Moulinsart, qu’on imagine proche de celui du comte Dudzeele. Car le roi avait voulu honorer en son temps le chevalier de Hadoque en lui conférant la seigneurie de Moulinsart de la même manière que, peut-être, Léopold II avait honoré la comtesse. Ainsi, en procédant à l’achat de Moulinsart, le Capitaine Haddock répare-t-il la négligence des fils du chevalier et rétablit cette filiation interrompue ou plutôt occultée pendant trois siècles.
On pourrait s’arrêter là et conclure avec Serge Tisseron que le secret d’Hergé, le secret de ses origines, a été percé et mis à jour, ce dont tous les tintinophiles sont informés depuis trente ans.
Cependant, la quête d’Hergé, car c’est bien de cela qu’il s’agit, d’une quête et pas seulement d’une enquête, relève d’une portée universelle. Tout homme qui ne connaît pas ses origines éprouve la soif de les découvrir et c’est du reste au travers de l’épreuve du Pays de la Soif que Tintin et le Capitaine Haddock forgent leur relation de manière définitive.
Cette question des origines est si profondément ancrée au cœur de l’homme que le Nouveau Testament s’ouvre sur ce mot clé, généalogie. Saint Matthieu, qui s’adresse aux Hébreux, a à cœur de montrer que Jésus est le Messie attendu selon les écritures, c’est-à-dire le descendant de David et même d’Abraham. Cette généalogie s’achève avec Joseph, l’époux de Marie, et à qui l’ange apparaît en lui donnant cette instruction « Tu donneras à son fils le nom de Jésus ». Tout comme saint Matthieu au sujet de Jésus, Hergé a le souci de savoir comment il s’appelle : Remi, Coismans, Dudzeele, Saxe-Cobourg ? Freud dit justement que « changer une lettre d’un nom, c’est commettre l’équivalent du meurtre du père ». L’œuvre d’Hergé constitue le processus par lequel il structure sa propre identité et c’est pour cette raison qu’il convient de l’apprécier comme opus, non seulement sur le plan artistique mais dans la dimension même de la quête qu’elle représente. Le véritable terme de cette œuvre est formé par les Bijoux de la Castafiore, l’album où Tintin et Haddock n’éprouvent plus le besoin de courir le monde mais au contraire restent à demeure à Moulinsart, le lieu qui permet à Haddock de renouer avec ses ancêtres et qui matérialise en quelque sorte la généalogie qu’il s’est découverte au fil des épisodes précédents. Que cet album constitue la véritable fin de l’œuvre d’Hergé est écrit en toutes lettres à la dernière case : « C’est fini, mille sabords ».
Hergé redevient Georges Remi
Désormais, Hergé a dit tout ce qu’il avait à dire. Georges Remi, qui fait alors la connaissance de Fanny Vlaminck qu’il épousera plus tard, prend le pas sur Hergé et marque sa distance à l’égard de Tintin. C’est pourquoi, de l’avis de La Ligne Claire, les deux derniers albums, Vol 714 pour Sydney et Tintin et les Picaros, dus à la pression commerciale engendrée par Astérix et davantage fruits des studios Hergé que de Hergé lui-même, apparaissent si déstructurés au lecteur.
L’exposition, le parcours d’une vie
Le Grand Palais met en avant les différents aspects du talent d’Hergé, connus et moins connus; à côté du dessinateur hors pair qui contribue de manière essentielle à faire de la bande dessinée l’art qu’elle est aujourd’hui et dans laquelle il met tout son cœur, le visiteur découvre l’affichiste de ses débuts, le peintre abstrait de l’âge mûr et le grand collectionneur d’art moderne. Planches originales de Tintin, affiches vantant les sports d’hiver ou les jouets, expression de cet art nouveau que fut La Ligne Claire, elles demeurent si belles parce que lisibles par tous, de sept à septante-sept ans.
[1] Pierre Assouline, Hergé, Gallimard, 1998
[2] Plus tard, à l’initiative de Jack Lang, Tchang Tchong Jen réalisera le buste du président François Mitterrand, sans qu’on sache tout-à-fait si M. Lang fait appel au sculpteur ou au personnage du Lotus Bleu.
[3] Serge Tisseron, Tintin et le Secret d’Hergé, Presses de la Cité, 1993
WordPress:
J’aime chargement…