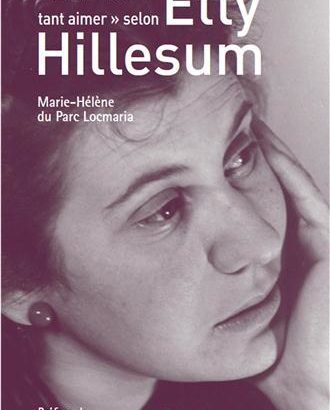Le confinement a fourni à La Ligne Claire l’occasion de regarder 1917, réalisé et produit par Sam Mendes, un film qui a remporté trois Oscars il y a deux mois. L’intrigue est toute simple : deux soldats anglais, Blake et Schofield sont chargés par le général Erinmore de porter un ordre destiné au colonel Mackenzie, commandant le régiment Devonshire où est affecté le frère de Blake, de ne pas procéder à l’attaque prévue pour le lendemain car les Allemands leur ont tendu un piège en feignant de se retirer.
Les deux soldats quittent donc Erinmore pour gagner le stationnement du régiment Devonshire. En chemin, ils doivent surmonter une série d’épreuves, franchir les barbelés, se faufiler dans les tranchées allemandes abandonnées, faire face à l’un ou l’autre tireur solitaire. De ce point de vue 1917 s’apparente à première vue aux road movies américains, à Oh Brother des frère Coen et bien entendu au récit de l’Odyssée. Il s’en distingue pourtant de manière fondamentale car dans 1917 ces péripéties ne sont que cela, une bombe qui explose, un avion ennemi qui s’écrase, une rivière à franchir mais elles ne sont porteuses d’aucune signification.
Plusieurs commentateurs ont souligné le caractère invraisemblable de l’histoire, que Mendes dit tenir de son grand-père, car jamais un régiment isolé n’aurait été amené à conduire seul une attaque. De plus la présence dans le film de militaires indiens et africains au milieu de soldats anglais est invraisemblable et relève d’un hommage indû à la pensée du jour ; en effet, l’armée britannique était organisée sur une base territoriale de sorte que les nombreuses troupes indiennes et issues des colonies africaines opéraient au sein de leurs propres unités. Enfin, si 1917 dépeint les Allemands comme l’ennemi bien sûr, il les dépeint inutilement comme les méchants de cette histoire.
En définitive, 1917 est le récit d’une anecdote, sans autre sens qu’anecdotique. Le film s’est vu attribuer trois Oscars « techniques », meilleure photographie, meilleur mixage de son et meilleurs effets visuels. C’est bien car le film ne méritait pas davantage.