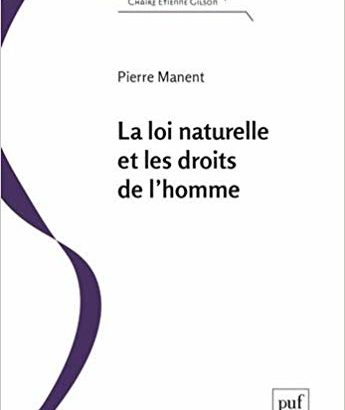Au fond, recruter un agent du camp adverse tient de la séduction amoureuse; approchez votre partenaire trop vite et il s’effarouchera, faites-le trainer et il risque de manquer les signes que vous tentez de lui adresser.
Ben McIntyre, auteur spécialiste des affaires d’espionnage, relate l’histoire véritable de la manière dont les services de renseignements britanniques, connus sous le sigle de MI6, ont retourné, c’est-à-dire recruté Oleg Gordievski, un colonel du KGB qui deviendra donc un agent double.
Macintyre s’était déjà distingué en faisant le récit de l’opération Mincemeat qui s’était déroulée en Espagne pendant la dernière guerre. Il s’agissait alors pour les Anglais de faire semblant d’avoir perdu de fausses informations mais de s’agiter suffisamment pour faire croire aux Allemands qu’elles étaient vraies.
On retrouve dans The Spy and the Traitor tous les éléments qui marquent désormais le style de Macintyre : une recherche minutieuse des faits, appuyée si possible sur des entretiens avec les protagonistes, une évaluation équilibrée, l’absence de spéculation et une rédaction sobre et factuelle. On butte aussi cependant sur les limites du genre, à savoir la nécessité d’une histoire vraie mais suffisamment intrigante pour qu’elle puisse se prêter à une rédaction selon les canons anglais du roman d’espionnage.
L’histoire se déroule dans les années 70 et 80, au temps de la guerre froide. Gordievski, comme son frère et son père avant lui, appartient au KGB, une sorte d’aristocratie soviétique. Cependant, la révélation des crimes de Staline et plus proche de lui l’érection du mur de Berlin et la répression du Printemps de Prague fairont naître en lui un dégoût du système communiste et le conduiront à franchir le pas. Un des intérêts de ce livre réside dans l’examen des motivations qui animent un transfuge: un esprit romantique, un snob intellectuel, un sentiment de frustration, voire de solitude, le sentiment d’être méconnu. Si au sortir de la guerre, certains – on songe à Kilby et Maclean – agissent par conviction idéologique, vers 1980, tout le monde à l’Ouest se rend compte que le système soviétique est pourri si bien que l’argent deviendra le mobile principal. En sens inverse, Gordievski agira quant à lui par conviction et franchira le dernier pas, toujours mystérieux, celui qui mène de la dissidence intérieure à la trahison.
Tout n’est que jeu de miroirs au cours duquel les acteurs érigent des cloisons entre leur vie publique et privée et entre leur fonction officielle, mettons secrétaire d’ambassade et leur véritable fonction, l’espionnage; alors que le retournement d’une cible ne peut s’opérer que dans la confiance, la méfiance règne en maître dans ce monde, y compris entre alliés. A la suite de John le Carré, Macintyre maîtrise parfaitement le langage de ce monde où des transfuges prennent garde de se faire filer, déposent des messages codés dans des cachettes, esquivent tant leur contrôleur que leur supérieur et parfois passent à l’Ouest, ou à l’Est.
Comme dans les romans d’espionnage, l’histoire de Gordievski s’achève par une pirouette que La Ligne Claire laisse à ses lecteurs le soin de découvrir.
The Spy and the Traitor fournira une bonne idée de cadeau de Noël à toutes les lectrices de La Ligne Claire dont les maris ont déjà suffisamment de cravates. Quant à La Ligne Claire, si elle a dégusté avec plaisir The Spy and the Traitor,elle avait dévoré Mincemeat.
Ben Macintyre, The Spy and the Traitor, Penguin, 366 pages.