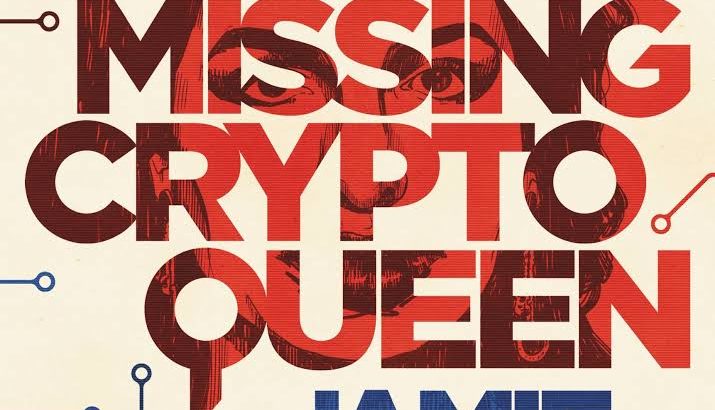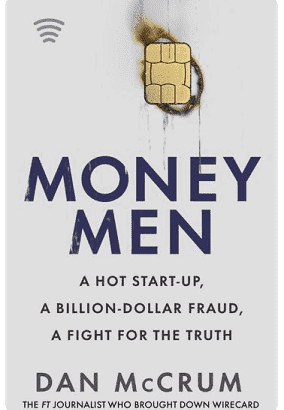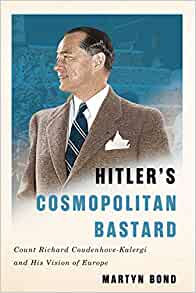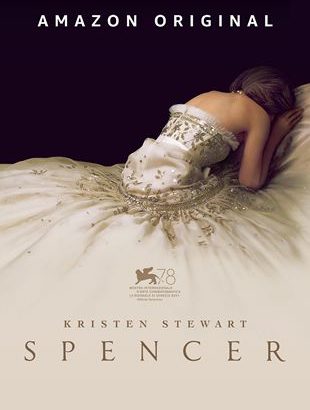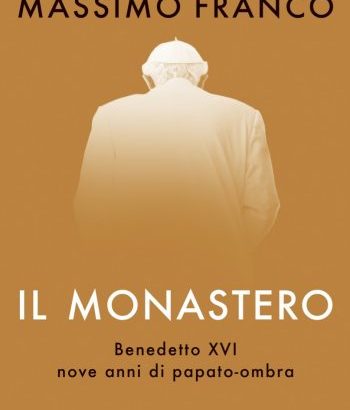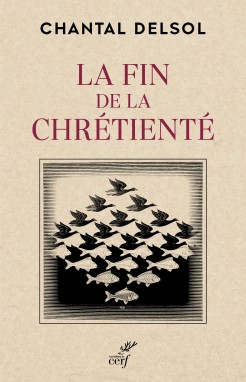Les lecteurs de La Ligne Claire qui suivent l’actualité financière sauront que la monnaie cryptographique Bitcoin aura perdu plus de 50% de sa valeur au cours du premier semestre 2022. Néanmoins, à environ 20 mille dollars, c’est beaucoup plus que celle de son éphémère rivale OneCoin, qui est cotée à €0.0008313.
Bitcoin, la première et la plus connue des monnaies cryptographiques nait en 2009 dans un milieu libertarien qui veut s’affranchir de la tutelle de l’État sur la monnaie dont il contrôle à la fois le prix (le taux d’intérêt) et le volume (l’assouplissement quantitatif) et qu’il taxe de surcroit.
C’en est trop pour Ruja Ignatova, une bulgare qui a grandi en Allemagne. Brillante, elle accumule les diplômes y compris un doctorat en droit qui lui vaudra d’être connue sous le sobriquet de Dr Ruja. Un recrutement par le cabinet de conseil McKinsey lui vaudra non seulement d’acquérir une expérience professionnelle de premier plan et de nouer un réseau de contacts mais de conférer à son CV la considération qu’elle recherche.
En 2014, elle crée OneCoin, qu’elle présente comme un cryptomonnaie à destination du grand public, qui aura vocation non seulement à détrôner BitCoin mais la monnaie fiduciaire elle-même. A cette création, elle associe d’une part le marketing multi-niveau, ou Multi Level Marketing (MLM), la technique de vente pour vendre la ligne de cosmétique Avon ou les produits de cuisine Tupperware, et d’autre part une pyramide de Ponzi, un montage financier frauduleux. Mais alors que les Tupperware ne prennent pas de valeur, Dr Ruja promet à ses investisseurs la future envolée du prix de OneCoin. Le talent de Dr Ruja, son CV, la combinaison de ces trois facteurs (crypto, MLM, Ponzi) lui permettra de créer une clientèle à l’échelle du monde qui se comptera en milliers puis en centaines de milliers. Mais OneCoin est un produit financier dont la commercialisation est soumise à des règles strictes ; pour les contourner, Dr Ruja vend des manuels de finance, à des prix allant de mille à cent mille euros, assortis de jetons qui permettent d’acheter des OneCoin. Le monde entier en achète, des veuves, des employés municipaux en Angleterre, des fermiers en Ouganda vendent leurs chèvres pour souscrire à OneCoin dans l’espoir que leur vie en sera transformée.
En réalité toutefois, OneCoin n’est en qu’une gigantesque fraude qui a permis à Dr Ruja et à quelques acolytes de s’enrichir rapidement aux dépens du grand public justement. En décembre 2017, Dr Ruja disparaît et demeure toujours en fuite à ce jour tandis que son système s’écroule peu après.
Fruit de la transcription par écrit d’un podcast publié par la BBC en 2019, The Missing Crypto Queen raconte cette histoire extraordinaire sous la plume claire et agréable de Jamie Bartlett. Bartlett fait preuve de talent ; non seulement il permet au grand public, toujours lui, de comprendre une histoire complexe sur le plan technologique, financier et juridique, mais il décortique les ressorts émotionnels de cette affaire. Certes, Dr Ruja est l’auteur d’une fraude jusqu’en sa propre disparition, mais le public crédule se révèle disposé à la croire, à rêver d’un enrichissement instantané et à la suivre comme le joueur de flûte de Hameln.
Et puis, si Dr Ruja a disparu, ce n’est pas en raison de son escroquerie, non, cela ne se peut, nous sommes dans l’ère de la grande occultation et elle reviendra lors de son deuxième avènement pour défaire tous ceux qui l’ont contrainte à se cacher, les banques, le FBI, ceux-là de Bitcoin, et Jamie Bartlett qui nous révèle la vérité.
Jamie Bartlett, The Missing Crypto Queen, WH Allen, 2022