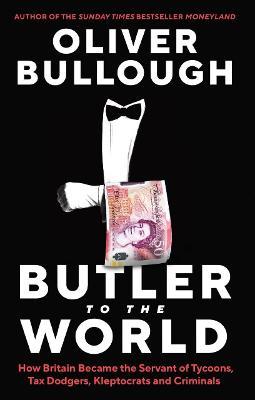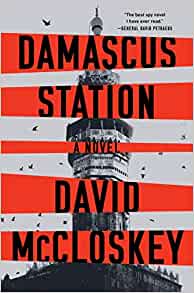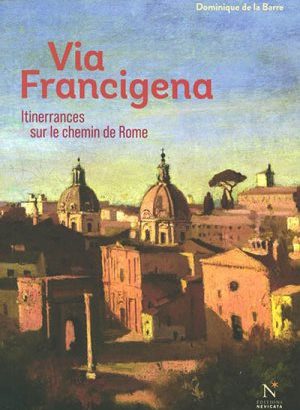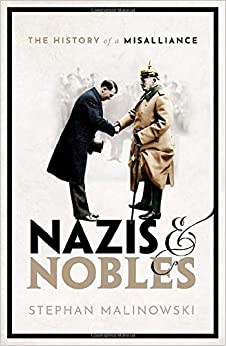La clé de lecture de ce livre réside sans doute dans le sous-titre, Histoire d’une Mésalliance. Au départ, tout oppose les national-socialistes, non seulement vulgaires et violents mais qui se réclament justement d’une forme de socialisme, à la noblesse conservatrice qui se conçoit elle-même comme une élite investie d’une mission. Pourtant ces deux groupes finiront par opérer un rapprochement, que l’auteur, Stefan Malinowski, qualifie de mésalliance. Qu’est-ce donc une mésalliance ? Une union qui brise les règles qui gouvernent leurs groupes respectifs, en l’occurrence un accord passé entre le peuple et la noblesse, mû par un mélange de passion et d’intérêts économiques et où les deux parties trouvent leur compte. Ici cette conjonction d’intérêt prend plusieurs formes : détestation du communisme et même de la démocratie, hostilité envers le capitalisme incarné par une bourgeoisie cosmopolite, etc.
La noblesse allemande en 1918
En 1918, la noblesse allemande compte quatre-vingt mille personnes sur une population de soixante-cinq millions environ, soit un taux de 0,12% [1]. Elle exerce son activité dans trois domaines principaux : l’armée, la fonction publique et l’exploitation agricole et forestière. Prise dans son ensemble, elle possède 13% du foncier dans le Reich. La guerre qui vient de s’achever lui a porté de rudes coups. Tout d’abord, elle a perdu plus de 4,500 de ses membres au combat. Ensuite l’établissement de la République de Weimar et donc la disparition des principautés constitutives de l’empire bismarckien conduit à la suppression des nombreux emplois dans les cours princières, dont la tenue était traditionnellement assurée par la noblesse. Enfin, le Traité de Versailles limitera la Reichswehr, l’armée allemande, à cent mille hommes, pour lesquels neuf cents officiers à peine suffiront, privant de ce fait les cadets de familles nobles d’un débouché qui était le leur depuis des siècles. Dans l’ensemble, ce premier après-guerre constitue une catastrophe économique et sociale pour la noblesse, et plus particulièrement pour la petite noblesse terrienne protestante, qui possède des exploitations agricoles situées à l’est de l’Elbe.
Au sein de la noblesse allemande, l’auteur distingue trois groupes : la haute noblesse, la moyenne et petite noblesse et enfin ce qu’il appelle le nouveau prolétariat nobiliaire, qui regroupe les veuves de guerre, les anciens officiers et anciens fonctionnaires des cours princières défuntes, les uns et les autres désormais privés d’emploi. Des familles entières basculent dans la précarité.
En dépit de ces différences très sensibles, des points communs se dégagent au sein de ce groupe : la noblesse se nourrit tout d’abord de ses réseaux, les associations de famille, le cousinage ; elle professe ensuite un profond attachement à la terre dont témoigne une vie à la campagne car, contrairement à l’aristocratie française ou italienne mettons, la noblesse allemande ne possède ni hôtel particulier ni palais en ville : la noblesse vit dans un château établi au centre d’un domaine agricole ou forestier ; enfin elle se méfie de l’intellectualisme et mène un style de vie frugal animé par le sens du service (dienen) qu’elle oppose à celui du gain (verdienen).
Un vide politique et symbolique
Le 9 novembre 1918, le Kaiser Guillaume II quitte son état-major de Spa et se réfugie aux Pays-Bas où il mourra en 1942. Ce que certains perçoivent comme un exil, les Allemands le voient comme une fuite et même une désertion. Peu avant son départ en Hollande, alors que la cause des armes est désormais perdue, des officiers allemands étaient venus trouver l’empereur pour lui faire comprendre qu’il fallait qu’il trouve la mort au combat aux côtés de ses soldats ou, qu’à défaut, il se suicide [2]. Toujours est-il que le départ de l’empereur, exil ou fuite, crée d’une part un vide symbolique et d’autre part une rupture d’allégeance et de légitimité.
L’auteur saura nuancer ce jugement à propos de la noblesse bavaroise qui possède des terres importantes qui la préservent de la ruine, se sont méfies des Prussiens de tous temps et conservent une allégeance alternative envers le pape et la dynastie des Wittelsbach. [3]
Ce vide symbolique en Allemagne aura vocation à être comblé par un Führer, qui réunira autour de lui une élite appelée à établir et diriger un Troisième Reich, qui doit durer mille ans, selon ce qui est écrit dans le livre de l’Apocalypse de Saint Jean. Führer et Troisième Reich sont au départ des expressions aux connotations messianiques et apocalyptiques qui précèdent l’avènement du nazisme et non pas avec lui un lien ontologique [4].
Une nouvelle élite
C’est dans ce contexte que naissent d’intenses discussions quant à l’identité que doit revêtir cette nouvelle élite. S’agit-il de la noblesse, appelée à recouvrer ses fonctions d’avant-guerre ou bien d’un nouveau groupe issu de la communauté nationale (Volksgenossenschaft) ou encore d’un mélange des deux, une combinaison tenue jusque-là pour incompatible ? Ce qui est certain, c’est qu’elle exclut les Juifs, qui incarnent tant le bolchévisme désormais établi en Union Soviétique que le capitalisme international. Aussi, dès 1920, la Deutsche Adelsgesellschaft (DAG), l’association faîtière des associations nobiliaires, introduit dans ses statuts une clause d’aryanisme, qui sera cependant rejetée par les associations catholiques. Il s’agit là d’une innovation radicale qui, en introduisant une notion de race jusqu’alors inexistante, conduit à une redéfinition fondamentale de la qualité nobiliaire. Dix-huit ans avant les lois raciales de Nuremberg, la DAG anticipe les vœux des nazis et établit un nouveau registre de la noblesse réputée au sang pur, appelé EDDA, et qui conduira à l’exclusion de certains membres, y compris d’anciens combattants, qui ne satisfont pas à ces nouvelles exigences.
A côté de la DAG, le Deutscher Herrenklub (DHK) réunit des membres de la haute aristocratie et de la bourgeoisie. Il maintient une distance prudente envers les nazis et œuvre envers un gouvernement élitiste, incarnation du concept du Führertum et dont l’illustration est l’éphémère gouvernement de Franz von Papen, un noble catholique conservateur, en 1932, à la tête du cabinet dit des barons. Avec sa chute en novembre 1932 s’écroule aussi l’illusion de pouvoir contenir les nazis.
Cette combinaison, qu’on pourrait appeler de la capitulation de la DAG et de l’échec du DHK rompt les digues et amène des membres de la haute noblesse à adhérer au parti nazi, parfois au sein des SA et des SS. L’auteur en établit le compte et accorde la palme à la famille des comtes von Wedel, dont septante-huit membres adhéreront au parti, dont trente-cinq avant 1933, rejoints par d’autres noms illustres, les Schulenburg (41/17), les Bismarck (34/4), les Bülow (40/13), les Dohna (23/7) et bien d’autres encore.
Résistance
L’auteur ne saurait passer sous silence l’attentat du 20 juillet 1944. S’il ne s’agit pas d’un complot fomenté par la noblesse en tant que telle, un grand nombre des conjurés, dont Malinowski souligne le caractère héroïque, en sont issus. S’ils sont bien entendus animés par des considérations morales, sept semaines après le débarquement de Normandie, le froid réalisme prévaut tout autant car ils savent la guerre désormais perdue. Ce ne sont pas non plus des convertis de la première heure à la cause de la résistance : Stauffenberg est colonel dans la Wehrmacht, Schulenberg et von Hassel sont des diplomates, respectivement membres du parti nazi depuis 1931 et 1933. Tous ont en vue l’établissement d’un gouvernement national-conservateur dirigé par des élites dans une Allemagne future où les distinctions sociales sont ouvertement revendiquées. Malinowski se montre extrêmement critique envers ce qu’il estime être la capacité inégalée de la noblesse à ériger sa propre histoire sous forme de mythologie aristocratique, dont l’attentat du 20 Juillet ne constitue selon lui que le dernier épisode.
Conclusion
En 2003, Stephan Malinowski, professeur d’histoire moderne à l’université d’Édimbourg, publiait « Vom König zum Führer », une étude de la noblesse allemande de l’empire bismarckien au Troisième Reich. Ce livre- ci, Nazis and Nobles, en est à la fois une traduction en langue anglaise et une mise à jour qui met l’accent plus précisément sur la contribution de la noblesse à la montée du nazisme. Pour être au départ un ouvrage académique, il est néanmoins d’une lecture certes exigeante mais agréable et qui se veut à la portée d’un public généraliste.
En définitive, Malinowski porte un regard sévère sur son sujet et conclut que la noblesse allemande, comme d’autres groupes sociaux, a contribué à la montée du nazisme, bercé par l’illusion de pouvoir le contenir et lui conférer un cachet de respectabilité. Il identifie la force principale qui préside à ce rapprochement, le brutal déclassement social de la petite noblesse protestante après 1918.
Cela n’a pas l’heur de plaire à tout le monde tant et si bien que le prince Georges-Frédéric de Prusse, chef de Maison depuis 2015 et descendant du Kaiser à la quatrième génération, a intenté un procès à l’auteur.
Nazis and Nobles – History of a Misalliance, Stefan Malinowski, Oxford University Press 2020, 471 pages.
[1] Un pourcentage comparable à celui qui prévaut actuellement en Belgique.
[2] Hitler s’en souviendra en 1945.
[3] En Bavière, le roi Louis III abdique en 1918 et meurt en Hongrie en 1921 ; la légitimité de son fils, le Prince héritier Rupprecht, qui lui succèdera à la tête de la Maison de Bavière, ne sera jamais mise en cause.
[4] Arthur Moeller van den Bruck popularisera cette expression dans un ouvrage paru en 1923.
Remarque: une version précédente de cet article, publiée le 30 octobre 2021, mentionnait incorrectement que 78 membres de la famille Alvensleben (dont tous les membres ne portent pas le titre de comte), avaient fait partie de la NSDAP, alors que le chiffre correct est 34. La Ligne Claire s’excuse auprès de la famille Alvensleben pour cette méprise.
WordPress:
J’aime chargement…