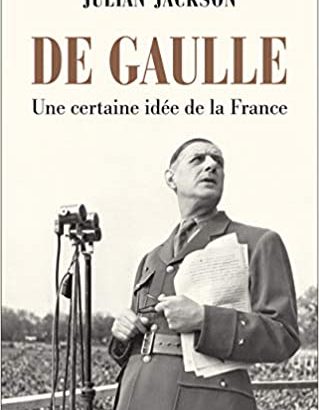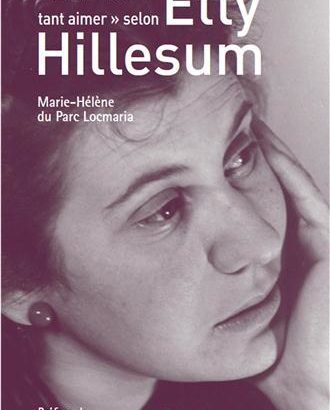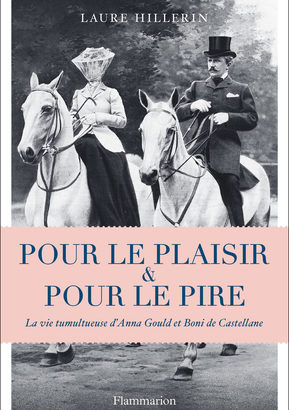Près de cinquante ans se sont écoulés depuis que La Ligne Claire, alors enfant, avait essuyé une réprimande pour s’être réjoui non pas du décès du Général de Gaulle mais du jour exceptionnel de congé octroyé par le lycée à cette occasion. A l’approche de cet anniversaire, Julian Jackson, professeur d’histoire à Queen Mary, University of London, livre une nouvelle biographie très complète du Général, qui a rencontré un grand succès outre-Manche si bien qu’elle s’est vue couronnée du prestigieux Duff Cooper [1] Prize.
La France ne court guère le risque de tomber à court de biographies de De Gaulle ou d’écrits à son sujet mais Jackson ne cache pas le peu de cas qu’il fait des biographies en langue française du Général, celles de Jean Lacouture et d’Éric Roussel en particulier. Spécialiste de l’histoire de France, Jackson connaît son sujet de manière intime pour s’être appuyé sur d’innombrables sources, documents, archives, correspondances et témoignages. Il en ressort une biographie très achevée aux accents mesurés.
Jackson s’adresse bien entendu en premier lieu à un public de langue anglaise et n’entend pas raconter un récit national. S’il admire l’homme, son parcours et son œuvre, il rédige sa biographie à la façon d’un protestant qui ferait celle de Jean-Paul II, sans aucunement avoir l’intention de se convertir à la religion catholique romaine, entendez ici la mystique du gaullisme. De l’avis de La Ligne Claire, la combinaison du caractère très fouillé de ce livre allié au détachement – on serait tenté d’écrire distanciation – manifesté par l’auteur envers son sujet constitue l’intérêt même de cet ouvrage.
Ceci dit, Jackson saisit correctement son personnage, à la fois comédien et calculateur, qui se veut l’incarnation de la France au cours de sa longue histoire. « Cela fait mille ans que je dis cela » aimait dire le Général. Le titre du premier volume de ses mémoires, L’Appel renvoie bien entendu à l’Appel du 18 Juin dont nous célébrons ces jours-ci le quatre-vingtième anniversaire mais aussi aux voix entendues par Jeanne d’Arc qui devaient la conduire à libérer la France, comme plus tard Charles de Gaulle. De même, la Croix de Lorraine, emblème de la France libre, renvoie une fois encore à Jeanne d’Arc, la bonne Lorraine, mais aussi à ce fardeau, le déshonneur de la défaite de 1940, que le Général se sent tenu de porter, comme le Christ a porté tous les péchés du monde sur sa propre croix.
Jackson est anglais ; aussi accorde-t-il une place particulière aux relations agitées que le Général a entretenues tout au long de sa vie avec les Anglais, dont il soupçonne sans cesse la duplicité, et avec les Américains, ce peuple impérialiste mais sans histoire. Seule Elizabeth II trouve grâce à ses yeux, précisément parce qu’elle incarne la continuité de l’État et de la nation britannique.
D’une lecture agréable, élégamment traduit par Marie-Anne de Beru, l’ouvrage de Julian Jackson s’inscrit de plein pied dans l’école des historiens anglo-saxons, où il s’agit de rendre compte des faits tels qu’ils ressortent des sources.
Toute sa vie, De Gaulle s’était forgé une certaine idée de la France fondée sur sa grandeur. Devenu président de la République, conscient des limites à l’action possible de la France dans un monde dominé par les États-Unis et l’Union Soviétique, cette incarnation de la grandeur conçue comme une politique était devenue dès lors davantage une question d’attitude que de moyens. Julian Jackson raconte l’histoire de cette destinée avec autant de rigueur que de talent, et où certains lecteurs de La Ligne Claire retrouveront leur père ou grand-père ; elle vaut la peine qu’on la lise.
De Gaulle, une certaine idée de la France, Julian Jackson, traduit de l’anglais par Marie-Anne de Beru, Editions du Seuil, 984 p.
[1] Alfred Duff Cooper (1890-1954), 1ᵉʳ vicomte Norwich, est un homme politique britannique du Parti conservateur qui fut ambassadeur à Paris de 1944 à 1947.