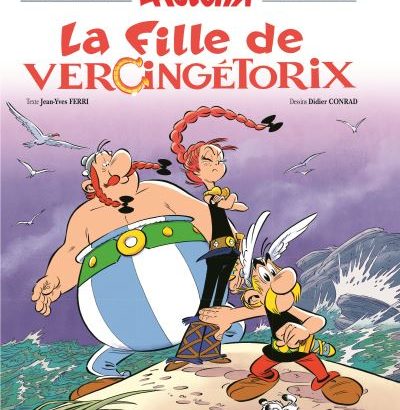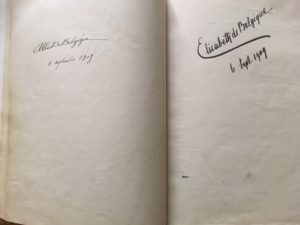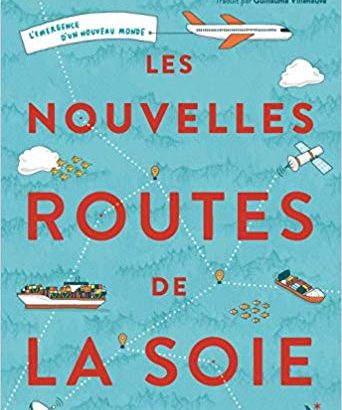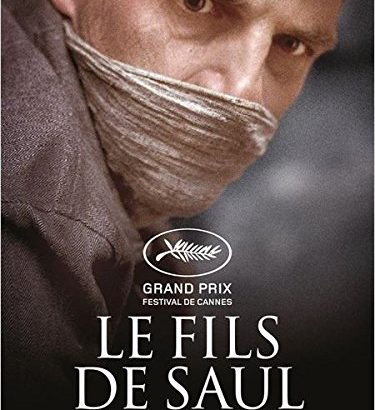Astérix renvoie aux Français un image d’eux-mêmes
Astérix naît en 1959, l’année où le Général de Gaulle est rappelé au pouvoir. Les lecteurs de La Ligne Claire se souviendront qu’elle estime que l’un et l’autre participent de la même œuvre de rédemption, qui consiste à exorciser la défaite française de 1940. De même que l’Homme du 18 Juin, qui résiste encore et toujours à l’envahisseur, est le seul à même d’endosser le destin national, de même le village gaulois représente la France libre face aux légions romaines qui tiennent lieu de la Wehrmacht.
Ce point de vue de La Ligne Claire trouve sa pleine justification avec la publication ces jours-ci du nouvel album d’Astérix, dont le titre, La Fille de Vercingétorix [1], en fournit l’éclatante confirmation même.
Si nous connaissons le Vercingétorix historique grâce au De Bello Gallico de Jules César, le Vercingétorix mythologique lui naît sous le Second Empire ; Napoléon III entreprend les fouilles d’Alésia et y fait ériger une statue monumentale de Vercingétorix, dressée face à la Prusse menaçante. La France n’est pas encore défaite à Sedan que déjà le vaincu d’Alésia est érigé en héros national. Mais le vrai Vercingétorix sera emmené en captivité à Rome par César, où il mourra dans la prison Mamertine si bien qu’il ne pourra faire figure de héros dans un album d’Astérix. Signe des temps, là ou en 1983 Astérix avait un fils, cette fois-ci Vercingétorix aura une fille, Adrénaline.
En juin 1940, fuyant l’ennemi, Charles de Gaulle avait gagné Londres où Winston Churchill avait été fraîchement nommé Premier Ministre. Escortée par Ipocalorix et Monolitix [2], caricatures de De Gaulle et de Churchill justement, Adrénaline quant à elle tente aussi de gagner Londinium, en vue de se mettre à l’abri des Romains qui l’ont prise en chasse avec le concours du sinistre Adictosérix, le collabo de l’histoire.
France libre et village gaulois
L’album s’achève sur une pirouette. Adrénaline rencontre un amoureux ; ils s’embarquent tous deux vers des cieux lointains puis disparaissent. Incarnation improbable de la conscience nationale, Adrénaline confie le casque de cérémonie de Vercingétorix, sorte de sceptre d’Ottokar de la résistance gauloise, au village gaulois qu’elle estime être le véritable héritier de son père. Les Gaulois célèbrent leur banquet final en présence de Ipocalorix et Monolitix et nous voilà donc ramenés au village en qualité de figure de la France libre. CQFD.
L’image ci-dessous illustre parfaitement le point de vue de La Ligne Claire, avant même la naissance d’Astérix. Elle représente le monument aux morts de l’église Notre-Dame de Saulges (Mayenne). Un poilu et un guerrier gaulois se dressent en atlantes de part et d’autre d’un aumônier militaire qui administre les derniers sacrements à un soldat mourant.
[1] La terminaison en rix, qu’on retrouve dans les langues d’origines aryennes, indique que Vercingétorix était un chef ou un roi ; on peut la rapprocher du rex latin ou du raj en Inde. En revanche il n’y a pas lieu de la généraliser à l’ensemble des noms gaulois.
[2] Les lecteurs belges de la Ligne Claire savent bien entendu déjà que c’est à Victor de Laveleye, et non pas à Churchill, que revient la paternité du geste du V de la victoire.