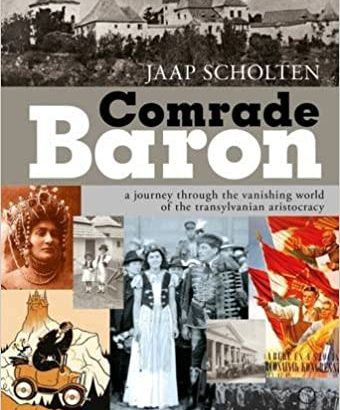Die Reichsidee
Dans ce livre ambitieux, Visions of Empire, l’auteur, Krishan Kumar, s’attaque à l’examen des idées et des idéologies qui ont présidé à l’établissement et à la gouvernance des différents empires sur lesquels il fonde son étude : les empires romain, ottoman, habsbourgeois, russe, britannique et français.
Fondamentalement, la notion d’empire, die Reichsidee, selon le titre d’un ouvrage de l’Archiduc Otto de Habsbourg, se distingue de celle, plus récente, de l’État-nation, dont la France constitue sans doute à la fois le prototype et l’exemple le plus achevé.
Du reste, l’auteur, Krishna Kuman, né en 1942 à Trinidad et Tobago, actuel doyen de la faculté de Sociologie à l’Université de Virginie et citoyen britannique, s’estime lui-même être le fruit de cette notion d’empire, britannique en l’occurrence.
Dans l’histoire du monde, les empires ont précédé de trois millénaires l’émergence de l’État-nation et ont revêtu le formes les plus diverses : empires terrestres ou maritimes, dynastiques ou pas, coloniaux ou pas, plus ou moins liés à l’idée de nation. La notion même d’empire est variable mais on peut néanmoins lui assigner des caractéristiques communes : un vaste territoire composé de peuples divers mais cependant unis au sein de l’idée impériale, un modèle qui souvent dure plusieurs siècles avant parfois de s’effondrer de manière brutale, mais surtout une prétention à l’universalité en vue de mener à bien une mission civilisatrice. La Chine se conçoit comme l’Empire du Milieu tandis que Rome se définit comme la caput mundi.
Kumar examine en détail non pas l’histoire de six empires mais la manière dont ces empires-là en sont venu à concevoir leur existence et leur vocation. Tous, y compris l’empire ottoman selon l’auteur, sont d’origine européenne et trouvent dans l’Empire romain leur archétype. Tous les empires vont cependant « exporter » leurs propres institutions du centre vers la périphérie en vue de constituer une culture commune.
Empire et nation
Kumar étudie en premier l’empire romain. Il n’a pas pour objet d’en examiner l’histoire en détail mais d’analyser l’idéologie qui a présidé à son déploiement. Un point crucial est atteint en 212 lorsque l’empereur Caracalla octroie la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’Empire, quelle que soit leur nation. Plus tard on verra du reste des empereurs d’origine ibérique, dalmate et africaine revêtir la pourpre.
A l’opposé, et en réaction à la constitution de l’Empire napoléonien à travers l’Europe, Gottfried Herder développera au début du XIXe siècle la notion jusque-là inconnue selon laquelle les peuples qui parlent une même langue forment une nation qui doit s’incorporer non plus au sein d’un empire mais d’un État. Cette notion donnera bien entendu naissance plus tard dans le siècle à la constitution de l’Allemagne et de l’Italie modernes puis, après la disparition de l’Empire habsbourgeois en 1918, aux États nationaux d’Europe centrale.
Établir la distinction entre nation et empire n’est jamais aisé ; dans les empires habsbourgeois et ottoman, ni les Allemands ni les Turcs ne représentent une majorité de la population et les uns et les autres ont parfaitement conscience qu’avancer l’idée de nation est incompatible avec celle d’empire à laquelle ils tiennent ; à l’autre extrême, la France de la Troisième République se fixe comme objectif de projeter les valeurs issues de la Révolution française et se donne pour mission de faire des habitants des colonies des citoyens français.
De tous les empires examinés par l’auteur, l’Ottoman est celui qu’il considère comme étant celui le plus conforme à l’idée impériale ; très tolérant de la diversité des peuples, y compris dans leur composante religieuse, il s’attache cependant à forger un sentiment d’appartenance à une civilisation commune. Race, ethnie, nation ne comptaient pas aux yeux des Ottomans (qu’on ne confondra pas avec les Turcs) tandis que si la religion y tient un rôle important (le sultan devient calife à partir de Selim Ier en 1516), elle n’a pas vocation à miner les communautés chrétiennes et juives qui appartiennent tout autant à l’Empire que les musulmanes.
A la différence des Ottomans, les Habsbourg ont lié l’idée impériale à leur propre dynastie, que ce soit au sein du Saint-Empire, de l’empire colonial espagnol en Amérique désormais latine, ou au sein de l’Empire d’Autriche puis de l’Autriche-Hongrie au XIXe siècle. Si les Habsbourg, qui naissent dans ce qui est aujourd’hui le canton suisse d’Argovie, sont indiscutablement une famille allemande, puis espagnole, ils prendront grand soin de ne pas s’identifier à une nation particulière composant leur empire, et en particulier pas aux Allemands qui peuplent les territoires héréditaires d’Autriche ; telle une bonne mère, la dynastie fait montre d’une égale affection envers tous les peuples qui composent l’Empire.
La France, qui avait perdu au profit des Britanniques l’essentiel de son premier empire d’outremer au Traité de Paris de 1763, établira en Europe sous Napoléon Ier un empire continental de courte durée mais aux effets durables, et surtout sous la IIIe République un empire colonial en Afrique et en Indochine. Dans les deux cas, ces entreprises se revendiquent de la Révolution qui fonde la nation française au sens moderne et se donnent pour mission de diffuser la république dans sa conception laïque. Aussi, l’empire français est-il celui qui se rapproche le plus de la conception nationale qui vise à faire des peuples colonisés des citoyens français.
Survivances de l’idée impériale
Avec la disparition des empires européens, tant continentaux que coloniaux, l’auteur s’interroge sur la pertinence de ce modèle d’organisation politique à l’heure où l’ONU compte près de 200 États parmi ses membres. Sans les étudier en détail, Kuman nomme deux institutions qui ont fait leur l’idée impériale, l’Église catholique et l’Union Européenne.
Il est évident que l’Église catholique a repris à l’Empire romain de très nombreux éléments qui contribuent à la définir. Son siège est à Rome, le pape reprend le titre de pontifex maximus hérité de la religion romaine et bien entendu l’Église se nomme elle-même Église catholique romaine. L’administration forme la curie, autrefois le siège du sénat, tandis que les cardinaux revêtent la pourpre, emblème justement des sénateurs romains. Mais surtout, l’Église reprend à son compte la prétention universelle de l’empire et c’est pourquoi le pape s’adresse urbi et orbi, à la ville et au monde. Catholique signifie universel en grec, on ne saurait être plus clair.
L’Union Européenne (née CEE) quant à elle voit le jour en 1957 à Rome et pas ailleurs. Les six pays qui la composent alors recouvrent un territoire qui correspond peu ou prou à celui de l’empire carolingien ; la Commission Européenne occupe du reste à Bruxelles un ensemble de bâtiments dont l’un porte justement le nom de Charlemagne. Mais surtout, le projet européen, à l’instar des empires d’antan et à la différence des projets nationaux « annexionnistes » (l’Italie par exemple) vise à établir une structure supra nationale qui permette néanmoins aux États qui la composent de préserver leur propre identité et de poursuivre leur existence.
De plus, douze ans à peine après la fin de la guerre, l’Europe a conscience de ce qu’elle vient d’échapper à une tentative du projet impérial nazi fondé dans la violence sur la supériorité d’une race sur d’autres. En se réclamant explicitement de l’idée impériale, la CEE signale que toutes les nations, grandes et petites, y ont leur place et y jouissent d’une égale dignité.
De l’avis de La Ligne Claire, ce « récit national » supranational s’est avéré essentiel non seulement à la réconciliation avec l’Allemagne mais à l’émergence de la conscience de l’appartenance à une culture européenne commune, dont le christianisme est l’un des fondements. Le Traité de Rome fut d’ailleurs signé le jour de la fête chrétienne de l’Annonciation.
Quo vadis ?
Avec l’élargissement de l’Union à presque tout le continent, avec l’émergence d’une dominante économique (le marché unique, le traité de Maastricht, l’euro), avec aussi le rejet explicite de la référence aux racines chrétiennes de l’Europe dans la constitution européenne, ce récit supranational n’a plus trouvé de résonnance faute même d’avoir été énoncé. Pourtant, tous les pays qui composent aujourd’hui l’Union ont fait partie en tout ou en partie d’un ensemble impérial plus vaste à un moment de leur histoire. Aucun empire ne les a tous comptés en son sein mais l’Empire romain est celui qui en a compté le plus (17 sur 27 selon les calculs de La Ligne Claire), qui demeure dès lors la référence ultime du modèle impérial en Europe.
Il est malaisé de nos jours d’esquisser un récit supranational qui résonne à la fois aux oreilles des Portugais, des Estoniens et des Bulgares ; pourtant, il paraît essentiel au devenir et peut-être même à l’existence de l’Union Européenne, incarnation moderne de l’idée impériale. La Ligne Claire n’en voit qu’un seul, le christianisme (qu’on distinguera de l’adhésion à la foi chrétienne), matrice d’une culture commune.
Visions of Empire se révèle un livre fascinant ; ouvrage académique, il exigera du lecteur un certain effort de lecture pour renouer une familiarité avec une forme d’organisation politique qu’on retrouve en tous temps et sous tous les cieux.
Krishan Kumar, Visions of Empire, How Five Imperial Regimes shaped the World, Princeton University Press, 2017, 576 pages