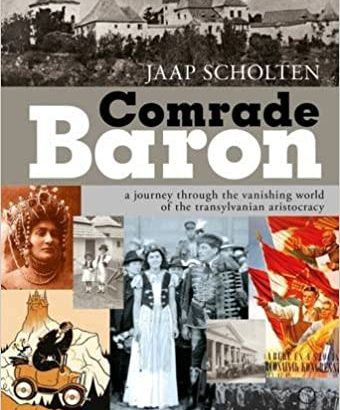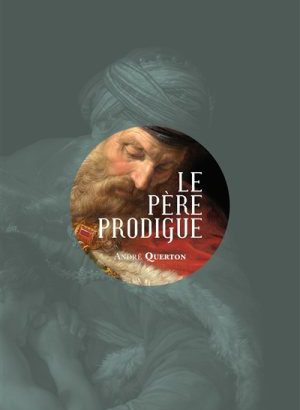Les lecteurs de La Ligne Claire se souviendront d’un personnage qui surgissait des entrailles de « Retour à Lemberg », Otto (Freiherr von) Wächter, général de la SS et gouverneur de Cracovie en Pologne occupée puis de Galicie, dont Lemberg est la capitale, pendant la guerre. La Filière, du même auteur Philippe Sands, ne constitue pas à proprement parler une suite à Retour à Lemberg mais s’inscrit néanmoins dans une sorte de continuité dans la mesure où le livre retrace la vie, puis la fuite et enfin la mort d’Otto Wächter.
Le titre anglais, The Ratline, évoque un réseau d’évasion mais le terme rat, bien entendu dénigrant, renvoie à des criminels qui fuient la justice plutôt qu’à des héros qui cherchent à échapper à l’oppression ; en l’occurrence il s’agit d’une ligne d’évasion qui vise à procurer assistance à des criminels de guerre en vue de gagner l’Amérique latine dans les années qui suivent la défaite en 1945. Car Otto Wächter est un nazi autrichien de la première heure, un brillant juriste, un organisateur hors pair à qui on songe dès lors qu’il s’agit de mener à bien des missions délicates. Hans Frank, son supérieur, l’un des quatre protagonistes de Retour à Lemberg, qui sera condamné et exécuté à Nuremberg, lui confie l’érection du ghetto de Cracovie, puis de celui de Lemberg (Lvov), et de là la déportation de la population juive et son extermination dans le camp de Belzec.
Philippe Sands retrace la vie et la mort de Wächter avec la précision clinique du juriste mais aussi avec une maîtrise de la cadence du récit à la manière d’un roman d’espionnage. Sands connaît tout de son personnage mais amène preuves et témoignages à un rythme choisi, que viennent ponctuer des chutes en fin de chapitre qui invitent aussitôt le lecteur à entamer le chapitre suivant.
Cependant ce livre remarquable ne prend tout son sens qu’à la découverte des différentes filiations qui s’y déroulent. Tout d’abord il y a l’arrière-grand-mère de l’auteur, qui fait partie de ces Juifs de Lemberg que Wächter envoie à la mort. Ensuite et surtout il y a les longs entretiens que Sands a avec Horst Wächter (né en 1939), fils d’Otto, qui ne sont pas sans rappeler ceux qu’avait menés Gitta Serény avec Franz Stangl et Albert Speer. Horst enfant n’a pour ainsi dire pas connu son père, décédé en juillet 1949 ; Horst adulte s’en forgera l’image d’un « bon nazi » que la réalité des faits amenés par Sands vient contredire ; Magdalena, fille de Horst, n’affichera pas la même complaisance ou le même aveuglement et se convertira à l’Islam pour échapper au poids de cette hérédité. Une troisième filiation, plus étonnante encore, vient se nicher au cœur de ce récit et que le lecteur découvrira, stupéfait.
Avec La Filière, Sands se révèle à nouveau comme un maître du récit historique, fruit d’une enquête minutieuse, rédigé d’une plume élégante toujours en tension et qui livre à ses lecteurs un message qui va au-delà du simple dévoilement des faits. Comme pour Ben Macintyre, l’enjeu pour Sands consistera à l’avenir à trouver des événements à la hauteur de son talent.
Philippe Sands, La Filière, Albin Michel, 2020, traduit de l’anglais