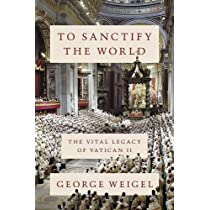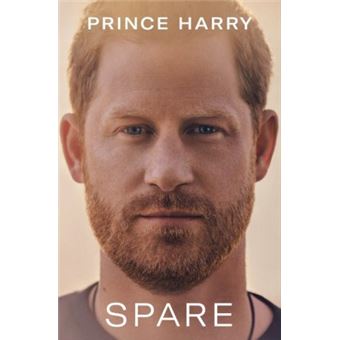L’évangile de ce dimanche nous livre le célèbre récit de Saint Thomas, dit doubting Thomas en anglais, et dont le tableau du Caravage donne une représentation tout à la fois crue, vigoureuse et incarnée. Mais que s’est-il donc passé depuis dimanche dernier ? Une enquête de La Ligne Claire, envoyé spécial en Judée.
Le Matin
Au petit matin de ce que nous appelons désormais le dimanche de Pâques, sans doute le 9 avril de l’an 30 de notre ère, alors qu’il faisait encore nuit, un groupe de femmes se rend au tombeau de Jésus en vue de l’embaumer. En effet, Jésus avait été enseveli à la hâte l’avant-veille en raison de l’approche du Sabbat (dont l’observance démarre le vendredi soir) si bien qu’on n’avait pas pu lui prodiguer de rites funéraires. Tous les évangélistes s’accordent pour mentionner ce groupe de femmes, même si sa composition varie. Jean du reste ne mentionne que Marie de Magdala (Marie-Madeleine), pas tant pour dire qu’elle était seule mais pour souligner son rôle dans la suite du récit. Les femmes découvrent la pierre roulée et le tombeau vide.
Marie-Madeleine se détache alors de son groupe et repart en courant vers Pierre et Jean leur apprendre la nouvelle du tombeau vide, en raison, pense-t-elle, du vol du corps. Entretemps, un ange apparait aux autres femmes qui étaient demeurées auprès du tombeau et leur déclare que Jésus est ressuscité et qu’elles doivent en apporter la nouvelle aux disciples. Tremblantes, elles quittent le tombeau sans rien dire à personne car elles avaient peur. Elles se ravisent cependant et se rendent auprès des Apôtres.
Pendant ce temps-là, prévenus par Marie-Madeleine, Pierre et Jean (deux des Apôtres) se rendent au tombeau, suivis par Marie-Madeleine. Ils n’y voient pas d’ange mais pénètrent dans le tombeau vide, Pierre d’abord, Jean ensuite. A la vue des bandelettes à terre et du suaire roulé à part, Jean comprend que Jésus est ressuscité.
Tandis que Pierre et Jean sont au tombeau ou en reviennent, les autres femmes rapportent aux autres Apôtres ce qu’elles ont vu, en l’occurrence le tombeau vide et l’apparition d’un ange qui leur a communiqué des instructions, mais les Apôtres tiennent ces propos pour du radotage et demeurent sceptiques
Quant à Marie-Madeleine, qui est donc au tombeau pour la seconde fois ce matin-là, elle s’y attarde après le départ de Pierre et Jean. Ce supplice atoce, la mort de Jésus et maintenant son tombeau vide, l’agitation de ce matin, tout cela, c’en est trop, l’émotion la gagne et elle se met à sangloter. Ému par ses pleurs, Jésus s’approche d’elle par derrière si bien qu’elle ne le reconnaît pas et le tient pour le jardinier ; il lui adresse la parole, elle se retourne et oui, c’est bien lui, elle le reconnaît. C’est la toute première apparition de Jésus ressuscité, une scène connue comme « Noli me tangere », ne me touche pas, selon les paroles que Jésus prononce. Comme l’ange lors de la première visite, Jésus enjoint Marie-Madeleine de porter la nouvelle aux Apôtres, mais cette fois-ci sur la base d’un témoignage oculaire.
Les autres femmes quant à elles, qui s’étaient rendues auprès des Apôtres en un deuxième temps, sont en chemin, peut-être de retour chez elles, lorsque Jésus leur apparaît à elles aussi pour apaiser leur tourment et les renvoie une fois de plus vers les Apôtres. Ce sera la seconde apparition.
Alors que les femmes passent la journée à courir de droite à gauche, les Apôtres (moins Pierre et Jean) restent assis dans leur fauteuil et peinent à se laisser convaincre. A Bruxelles, on dirait d’eux qu’ils sont durs de comprenure. Ainsi s’achève le matin de Pâques.
Le Soir
Le soir même se déroule l’épisode connu comme celui des disciples d’Emmaüs, du nom d’un village situé à proximité de Jérusalem dont l’emplacement n’a jamais été identifié avec certitude. Jésus, qui pourtant était ressuscité à Jérusalem, apparaît à deux disciples (distincts du groupe des Apôtres) qu’il accompagne un bout de chemin; comme le soir tombe ils s’arrêtent tous trois à l’auberge y prendre un repas. Bien qu’ils aient cheminé quelque temps avec Jésus, ils ne le reconnaissent qu’à la fraction du pain, avant qu’il ne disparaisse à leurs yeux. C’est la troisième apparition.
Les deux disciples d’Emmaüs s’en retournent en vitesse à Jérusalem en cette journée riche en chassés-croisés et se rendent auprès des Apôtres, toujours eux, leur rendre compte de l’apparition. Mais les Apôtres demeurent tout aussi blasés et méfiants qu’ils ne l’avaient été à l’égard des femmes ce matin-là. Dans le cadre de l’enquête, aucun chef de sexisme n’a été retenu à leur encontre.
Soudain, Jésus, qui de nouveau se retrouve mystérieusement à Jérusalem, apparaît d’abord à Pierre puis aux autres Apôtres, qui reconnaissent enfin le bien-fondé du témoignage des femmes et des disciples d’Emmaüs. Alors que les femmes, on l’a vu, se déplacent vers Jésus qu’elles croient mort, il aura fallu que, de guerre lasse, Jésus vivant se révèle aux Apôtres qui, à l’exception de Pierre et de Jean, n’auront pas bougé de la journée. Lors de cette nouvelle apparition, Jésus s’adresse aux Apôtres « Écoutez les gars, c’est bien moi » et leur montre les plaies que les clous avaient infligées aux mains et aux pieds. Puis, il mangea du poisson en leur compagnie, un léger souper donc puisqu’il avait déjà dîné auparavant avec les disciples d’Emmaüs. Ce soir-là pourtant, Thomas avait à faire et s’était excusé.
Intermède
On perd la trace de Jésus pendant ces huit jours. Tout au plus, les évangiles nous apprennent-ils que les Apôtres informèrent Thomas qu’ils avaient vu Jésus en son absence. Thomas ne s’en laisse pas conter et demande des preuves tangibles.
Épilogue
Huit jours après la Pâque, nous dit l’évangéliste Jean, alors que les portes étaient closes, Jésus apparut à nouveau aux Apôtres, cette fois-ci en présence de Thomas, qui avait pu se libérer. Jésus avait dû lire dans les pensées de son disciple puisqu’il invite Thomas à plonger sa main dans la plaie de son côté et lui offre donc la possibilité de faire le geste que lui-même réclamait. C’est la scène dépeinte par le Caravage, qui clôt une semaine où les femmes tiennent le beau rôle et qui allait changer l’histoire du monde.