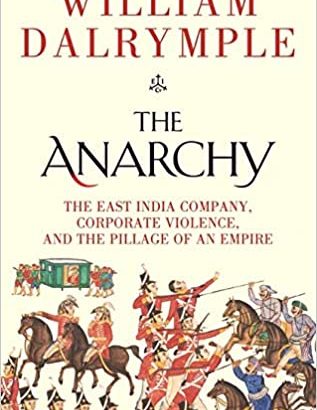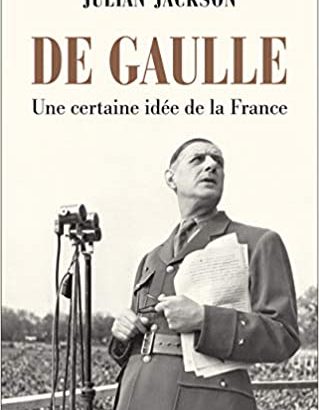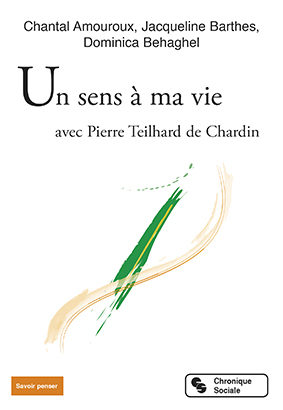L’itinéraire singulier d’un grand seigneur
ll arrive parfois que des pages évangéliques trouvent leur accomplissement dans le monde présent. A cet égard, on peut lire la vie d’Alexandre Rzewuski [1] à la lumière de la parabole du fils prodigue qu’on retrouve au chapitre XV de l’Évangile selon saint Luc. Issu d’une famille de la haute aristocratie polonaise mais établie en Russie, Rzewuski naît dans les dernières décennies de la Russie tsariste, que sa famille avait fait le choix de servir ; à Saint-Pétersbourg le jeune Rzewuski y sera du reste présenté à Nicolas II. La Première Guerre Mondiale puis la Révolution russe viendront mettre un terme à une carrière destinée à la diplomatie et contraindre Rzewuski à l’exil en France. A Paris, où il fréquentera tant le monde que le demi-monde, il connaîtra rapidement le succès en qualité d’illustrateur de mode et de graveur des femmes les plus en vues dans la société. Et puis vient le moment où le fils prodigue délaisse les plaisirs du monde et où Rzewuski, à l’insu de (presque) tous, frappe à la porte de l’Ordre des Dominicains.
Spécialiste de l’Europe orientale, mais surtout amoureux de la vieille Europe et de l’histoire de ses grandes familles, David Gaillardon livre ici le récit de la vie étonnante de Rzewuski. L’auteur se révèle un rédacteur de talent qui sait ajouter de la couleur là où les éléments de fait viennent à manquer en raison de la perte de documents causée par la Révolution russe et les deux guerres mondiales.
Un dessinateur à la mode
Le jeune Rzewuski est un homme du monde. Arrivé ä Paris en 1919 âgé de 27 ans, alors que se tiennent les pourparlers qui aboutiront quelques mois plus tard au Traité de Versailles, il se révèle un dessinateur sensuel et esthète, qui lui vaut de décrocher une première commande de la part de la revue Femina alors en vogue. Dans le Paris de l’immédiat après-guerre, il se fera rapidement un nom auprès des dames de la haute société dont il trace le portrait à la pointe sèche, une technique exigeante dans laquelle il passe maître. Bientôt il voit sa réputation franchir la Manche et devient alors l’artiste le mieux rémunéré de son temps. Jeune dandy, il rencontre Boni de Castellane vieillissant et noue bien entendu des relations avec l’aristocratie en exil, les Youssoupof, les Lubomirski, et les Radziwiłł à qui plusieurs liens de cousinage le rattachent. C’est le Paris des Années Folles ; aux aristocrates qui parfois ont redoré leur blason en épousant une riche Américaine se mêlent des créateurs, Jeanne Lanvin, Coco Chanel ou Christian Dior, auxquels se joignent encore des artistes et écrivains de grande notoriété parmi lesquels on compte Cocteau et Picasso, Darius Milhaud et Maurice Ravel. Des femmes du monde se glissent dans ce univers-là, derrière lesquelles, écrit Gaillardon, se tapit parfois une aventurière dont le comportement est de nature à entacher sa réputation.
La conversion du fils prodigue
Rzewuski s’est-il lassé de la compagnie de ces grandes horizontales ? Toujours est-il qu’un jour de 1926 un ami l’envoie chez Jacques Maritain, le philosophe catholique qui incarne le renouveau néo-thomiste en France. Celui-ci l’envoie à son tour chez Monseigneur Vladimir Ghika, futur martyr et bienheureux. Rzewuski avait fait une première expérience mystique très intense la veille de la Noël 1916 alors qu’il escortait des blessés russes près de Trébizonde. Rzewuski y avait alors ressenti le besoin de se convertir au catholicisme. La recommandation de Maritain est astucieuse car Mgr Ghika est lui aussi un converti de l’orthodoxie et, comme Rzewuski, issu d’une famille de la haute aristocratie. Ces deux rencontres seront décisives si bien que Rzewuski rejoindra le couvent dominicain de Saint Maximin-Sainte Baume où le frère Ceslas – c’est son nom en religion – sera ordonné prêtre en 1932.
Une vie de moine mondain
Dès l’année suivante, il sera affecté à Fribourg en Suisse en qualité de directeur spirituel du séminaire international ; il allait y rester douze ans. La guerre d’Espagne puis la Seconde Guerre Mondiale allaient placer le Père Ceslas au centre d’un réseau politique, spirituel, familial et mondain qu’il enrichira de rencontres nouvelles parmi lesquelles il y lieu de relever l’abbé Charles Journet, futur cardinal. Par ailleurs, il deviendra l’aumônier des moniales dominicaines d’Estavayer, sur les rives du lac de Neuchâtel.
Gaillardon saisit bien tant l’activité que la personnalité de Rzewuski telles qu’elles ressortent des années fribourgeoises. S’il goûte la fréquentation du beau-monde, sa nouvelle vie est le fruit d’une véritable conversion qui n’est pas sans rappeler celle de Charles de Foucauld ; sans cesse il ressentira l’appel du désert et sera tenté de quitter les Dominicains pour les Chartreux, un pas qu’il ne franchira cependant pas.
Quelque temps après la Guerre, il est assigné à Prouilhe, dans le département de l’Aude, où il devient à nouveau aumônier de la communauté de moniales établies dans ce lieu où la présence de Saint Dominique est attestée. Il y passera la dernière phase de sa vie. Spirituel mondain, il remplit avec bienveillance les obligations de son ministère puis, le soir venu, dîne dans une vaisselle à son chiffre et des couverts en argent. Son chauffeur le conduit ici et là et lorsqu’il se rend à Rome, il descend chez ses cousins Caetani qui lui ont aménagé un appartement dans leur palazzo. Si cette vie peut heurter le lecteur moderne alors que le Père Ceslas a fait vœu de pauvreté, Rzewuski la vit comme un partage. Il se révèlera un fund raiser de talent et tout ce qu’il aura récolté d’une main auprès du monde, il le reversera de l’autre à son Ordre.
L’Église et les arts
Dessinateur de talent, Rzewuski appréciait la fréquentation des artistes et se sentait chez lui dans le monde de la culture. Esthète amoureux du beau, devenu religieux, il témoignera des noces du beau et du divin, qui pendant des siècles avaient fait la gloire de l’Église catholique. Vers la fin de sa vie, il rédigera « A travers l’invisible Cristal », ses mémoires publiés chez Plon en 1976. Si elles fournissent le matériel de base pour ce livre, elles se révèleront piètrement structurées si bien qu’il reviendra à Gaillardon de fournir un travail très approfondi de recherche, en particulier auprès du fond Jacques Maritain et du fond Rzewuski ; aussi, il en résulte un ouvrage sérieux et délicat, où l’élégance le dispute à la rigueur et dont le titre finement choisi, « La beauté et la grâce » résume le personnage. La beauté de l’artiste mondain y rejoint la grâce du sacerdoce ; l’une et l’autre séduiront à juste titre tant les amateurs de l’histoire de l’aristocratie que celle de l’Europe et de l’Église.
Dans le siècle, avec Alex-Ceslas s’éteint l’illustre maison des Rzewuski ; dans l’Église, à la suite de l’Abbé Mugnier, il s’inscrit dans la lignée des prêtres de cour, appelés à eux aussi à faire le bien là où la Providence les aura placés.
David Gaillardon, La beauté et la grâce. Itinéraire d’un aristocrate européen, Alex Rzewuski. Éditions Lacurne 2019, 479 pages.
[1] On prononce Jévoussequi
WordPress:
J’aime chargement…