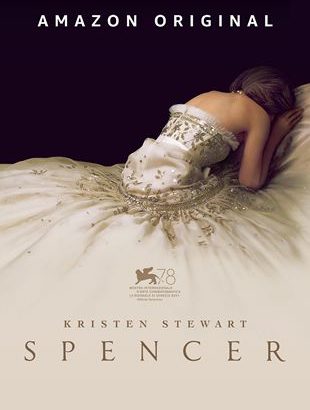La revue tous deux ans environ de la série The Crown, dont la cinquième saison est parue en novembre dernier, figure en bonne place parmi les devoirs d’état de La Ligne Claire, auxquels bien entendu elle se plie de bonne grâce.
La saison 5 nous emmène dans les années nonante du siècle dernier, une décennie agitée pour la famille royale britannique marquée notamment par le divorce du Prince et de la Princesse de Galles et la mort tragique de la princesse. Il revient bien entendu de classer The Crown parmi les œuvres de fiction, au sens où la série de plait à imaginer des scènes et des dialogues entre les protagonistes qui ne sont pas connus du public mais qui paraissent plausibles à l’écran. Cependant, la qualité de la réalisation a pu lui conférer dans l’esprit de certains l’aspect d’un documentaire ; aussi, dès le lancement de la série, ont surgi des controverses quant au mélange de la réalité et de la fiction opéré par Netflix, le producteur de la série. Avec la saison 5 qui se rapproche du temps présent, ces controverses ont resurgi de façon plus aigüe à telle enseigne que les anciens premiers ministres John Major et Tony Blair ont jugé nécessaire de publier des démentis au sujet de la manière dont leur personnage est dépeint dans la série. Le lecteur trouvera aisément sur YouTube des émissions lui proposant de démêler le vrai du faux dans The Crown ; certaines de ces fictions artistiques, le complot mené par le Prince de Galles pour amener sa mère à abdiquer par exemple, sont si évidentes et absurdes qu’on ne les méprendra pas pour la réalité ; d’autres comme la mention fictive par la Princesse Diana de son fils le Prince William lors de la fameuse interview accordée à Martin Bashir à la BBC, elle-même obtenue par tromperie, relèvent de la faute de goût.
Certes les aventures conjugales et extra-conjugales dominent l’activité de la famille royale en ces années-là mais elles semblent insuffisantes pour nourrir le récit tenu par Peter Morgan, le créateur de la série ; aussi fait-il recours à de nombreux flashbacks, Timothy Dalton dans le rôle de Peter Townsend, la flamme de la Princesse Margareth dans ls années 50 et un curieux épisode consacré à l’assassinat de la famille Romanov en 1918, cousins de Georges V alors le roi d’Angleterre, et dont La Ligne Claire estime qu’il est là pour meubler les espaces vides.
Aussi en dépit d’interprétations remarquables par Jonathan Pryce (Prince Philippe), Dominic West (Prince de Galles) et Elizabeth Debicki (Princesse Diana), qui ont su à merveille répliquer les attitudes de leur personnage, on reste sur sa faim. Au fil de ces épisodes somme toute assez décousus, le spectateur assiste à une interprétation de la reine par Imelda Staunton quelque peu en retrait et que viennent alimenter des dialogues souvent médiocres et pas toujours subtils. On se consolera en songeant que le personnage principal, la received pronunciation propre à la famille royale figure toujours en bonne place en dépit de son caractère désormais désuet.