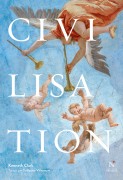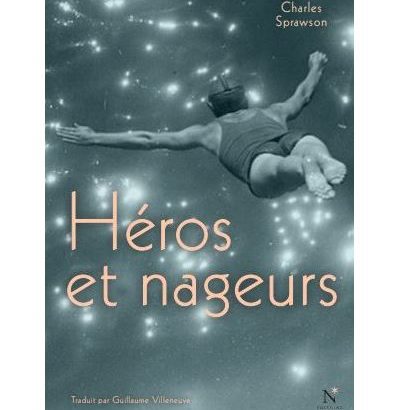En 1969, Kenneth Clark [1] présente à la BBC un documentaire en treize épisodes qui retrace l’histoire de l’art en Occident depuis la chute de l’empire romain. Intitulée Civilisation, la série constitue la première présentation télévisée et en couleurs de l’histoire des beaux-arts à destination d’un public généraliste.
L’émission connaîtra un succès considérable, jamais démenti jusqu’à ce jour, tant auprès des critiques que du grand public. De son émission, Clark tirera un livre qui sera traduit en français en 1974 et dont Guillaume Villeneuve propose aujourd’hui une nouvelle traduction aux Éditions Nevicata. Clark, disparu en 1983, s’était montré critique envers cette première traduction, en particulier envers sa couverture, qu’il jugeait criarde. A près d’un demi-siècle de distance, il fournit à Villeneuve non seulement le prétexte d’une traduction fraîche, élégamment illustrée de clichés en couleur cette fois-ci, mais l’occasion de repenser l’ouvrage.
Dès 1969, le titre tant de la série télévisée que du livre de Clark, Civilisation, fait l’objet de débats. A cette date, Clark a derrière lui une riche carrière académique et muséale qui lui ont valu une grande renommée en Angleterre. Il a certes conscience de l’existence d’autres civilisations, en Orient en particulier, mais choisit de présenter non pas l’histoire de l’art en Occident mais le récit de la civilisation occidentale illustrée par les beaux-arts, principalement la peinture et la sculpture. Au long des quinze siècles dont il retrace le cours, Clark n’aura de cesse de souligner le rôle éminent tenu par l’Église, catholique s’entend, non seulement comme vecteur technique, si l’on peut dire, de la transmission du savoir, mais comme matrice du monde dont nous sommes les héritiers. Clark, pour qui une civilisation ne peut se concevoir que comme une théologie politique, y voit le doigt de Dieu et se convertira du reste au catholicisme au soir de sa vie.
Clark est le fruit d’une éducation classique et élitiste, à Winchester d’abord et à Oxford ensuite. Il en retiendra la conscience de la dette que la civilisation occidentale doit à l’Italie, où naît l’empire romain, où siège la papauté, et d’où se répandront la Renaissance puis les arts baroques. Dans l’esprit de Clark, que la cathédrale Saint-Paul à Londres soit couronnée de la célèbre triple coupole de Christopher Wren, témoigne de cette filiation.
En 1968, Daniel Cohn-Bendit avait tué le père et avec lui tout ce que le père avait pour mission de transmettre. Peut-être Clark en a-t-il déjà l’intuition et a-t-il ressenti la vocation de remplir la fonction de moine copiste à l’âge des mass media, comme on disait alors. Clark sait que toute civilisation est fragile, qu’elle peut être menacée même par la culture ambiante, Coca Cola, Top of the Pops, la Bible en Readers Digest, et qu’en définitive elle repose sur la foi. C’est pourquoi la déchristianisation que nous connaissons en Europe de nos jours est aussi une dé-civilisation, en d’autres termes un barbarisme.
On en revient à la question : pourquoi une nouvelle traduction ? Guillaume Villeneuve, qui partage avec Clark une éducation classique, fait métier de traducteur depuis plus de trente ans. Pourtant, il ne s’agit pas ici d’une traduction ordinaire mais d’une profession de foi en son texte et ce qu’il signifie. Aussi, amis lecteurs, rendez hommage à ce moine copiste et faites une place à Civilisation dans votre bibliothèque, afin précisément d’en assurer la transmission.
[1] Lord Kenneth McKenzie Clark (1903-1983), historien de l’art, auteur britannique, directeur de musée et producteur de télévision.
Kenneth Clark, Civilisation, traduit de l’anglais par Guillaume Villeneuve, Éditions Nevicata 2021, 286 pages.