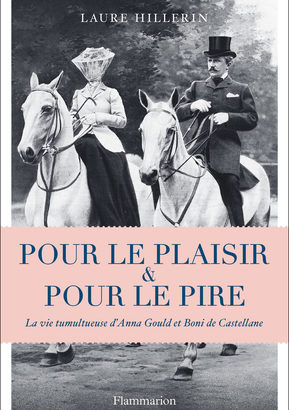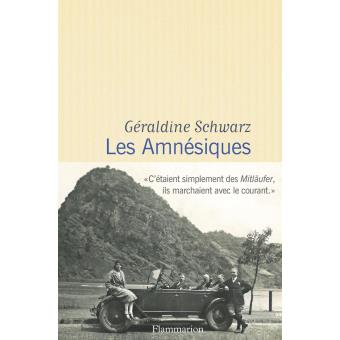La vie tumultueuse d’Anna Gould et de Boni de Castellane
Quelle était belle la Belle Epoque pour autant que l’on eût un nom, de l’argent, ou les deux en ces temps où l’impôt sur le revenu comme celui sur des successions demeuraient encore occultés dans les brumes de l’avenir. C’est à cette époque-là qu’en 1895 le comte (puis marquis) Boniface (dit Boni) de Castellane épouse Miss Anna Gould, réputée la plus riche héritière des Etats-Unis, fille de Jay Gould, self-made man selon les uns, requin de Wall Street détesté de tous selon les autres.
Laure Hillerin, spécialiste reconnue de la Belle Epoque, acclamée pour sa magnifique biographie de la Comtesse Greffulhe, livre ici le double récit de l’improbable union puis désunion de Boni et d’Anna. On y retrouve tous les éléments qui avaient contribué au succès de l’Ombre des Guermantes : une maîtrise parfait de son sujet qui s’appuie sur une documentation aussi ample que fouillée, alliée à une plume élégante qui sache adapter le langage des arts et du monde dans lequel évoluent les héros.
Fraîchement marié, doté d’un goût aussi sûr qu’exquis, Boni se servira de l’immense fortune de sa femme pour se livrer à des dépenses inouïes en vue d’acquérir les objets d’art les plus rares, aménager le château du Marais aujourd’hui situé dans le département de l’Essonne et surtout pour mener à bien la construction du Palais Rose avenue du Bois (aujourd’hui avenue Foch) et malheureusement détruit depuis. Alors qu’il passera à la postérité comme le prototype du dandy menant une vie mondaine vaine, Boni, héritier d’un des plus anciens noms de France, estime en réalité qu’être noble c’est vivre quelque chose qui le dépasse. Metteur en scène de sa propre existence, exilé non pas de son pays mais de son temps, il matérialise avec le Palais Rose le rêve de la France du Grand Siècle. C’est le sens du reste que lui donne à la même époque Marcel Proust ; la Recherche n’est pas tant le portrait d’une classe sociale que le snobisme de l’auteur fascine, qu’une tentative de saisir l’âme française au travers des seules familles qui l’ont incarnée au fil des siècles. Boni est de ceux-là.
Pour le plaisir et pour le pire se veut la double biographie de Boni et d’Anna. Pourtant, et c’est heureux, c’est le personnage de Boni qui en émerge tandis que celui d’Anna n’apparaîtra que comme une sorte d’annexe, pauvre de ses millions, à son premier comme à son second époux, le Duc de Talleyrand. Laure Hillerin a bien saisi son personnage au-delà de la figure du dandy et a su le rendre attachant à ses lecteurs. Loin des vanités, Boni sera par exemple un député très actif du département des Basses-Alpes, où il militera avec ardeur et clairvoyance mais sans succès pour le maintien de l’existence de l’Autriche-Hongrie faute de laisser le champ libre au Reich en Europe centrale. C’est lui aussi qui en 1923 fonde les Demeures Historiques aux côtés de Joachim Carvallo en vue de venir en aide à tous ceux qui possèdent une partie de l’héritage culturel de la France. Enfin c’est l’homme qui, privé de sa fortune et miné par la maladie, mais animé d’une foi ferme, a su faire montre d’une élégance et d’une dignité face à la mort. Tout cela est étranger à Anna qui ne saura jamais rien faire d’autre que de dépenser de l’argent et parfois d’en distribuer ; aussi, mourra-t-elle malheureuse.
Pour le plaisir et pour le pire se lit pour le plaisir justement. Il n’y a pas de pire dans le livre de Laure Hillerin, qui s’adresse à tous les amateurs d’une époque révolue qui, à l’image de Boni, ne s’ennuieront jamais.
Laure Hillerin, Pour le plaisir et pour le pire, La vie tumultueuse d’Anna Gould et Boni de Castellane, Flammarion, 569 pages.