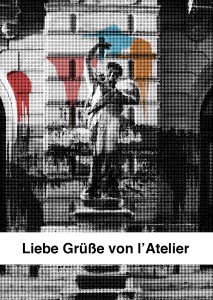Photo: Vanco Dzambaski
En mai 2016, la revue Tracés consacrait un dossier à l’héritage moderniste de la capitale macédonienne Skopje, ainsi qu’au surprenant projet d’antiquisation dont elle fait l’objet. Depuis quelques années, la petite république du sud de l’Europe s’est engagée dans un ambitieux et contestable chantier d’édification de monuments à la gloire du passé.
Le récent mouvement contre la corruption parlementaire qui semble prendre des allures de soulèvement populaire, s’attaque tout particulièrement à ces symboles flamboyants du régime. Supposés faire le lien avec un passé glorieux, ils sont perçus, de plus en plus, comme les emblèmes d’une gouvernance corrompue.
Le néobaroque macédonien : une réaction à l’hostilité grecque.
La dissolution de la Yougoslavie, la menace de la propagation du conflit et l’hostilité des voisins grecs, ont conditionné tant l’évolution du pays vers l’indépendance qu’une nouvelle stratégie de développement pour Skopje. Au début des années 2000 la ville va renier son héritage moderniste au profit d’un désastreux projet d’embellissement, teinté de nationalisme et de grandiloquence.
Le nouveau pays en quête de reconnaissance, menacé par l’isolement économique et les clivages ethniques qui ravagent ses voisins, va devoir affronter une réaction supplémentaire, pour le moins inhabituelle. Les Grecs leur contestent l’usage du nom et des symboles issus de l’héritage de la Macédoine antique. Ils considèrent que cet héritage leur appartient et se montrent peu disposés à le partager avec leurs voisins slaves arrivés dans les Balkans au 6e siècle apr. J.-C. En 1992, les Grecs se lancent dans une campagne internationale de contestation de la légitimité du nouvel Etat et bloquent la reconnaissance internationale de l’ancienne province yougoslave de Macédoine. Aujourd’hui encore, la dénomination officielle du pays à l’ONU, FYROM (pour Former Yougoslav Republic of Macedonia), est provisoire.
Cette polémique, née dans les milieux de la frange droitière du principal parti conservateur grec, pourrait être à l’origine de l’évolution de Skopje ces dix dernières années. Les Macédoniens vont répliquer à cette campagne de dénigrement par une gesticulation en marbre : une surenchère historiciste faite de statuaire géante et de nationalisme exacerbé.
En 2010, est lancé un vaste projet d’antiquisation visant à « rétablir la splendeur perdue » de la capitale macédonienne. On construit à tour de bras sculptures monumentales, arcs de triomphe et ponts, le tout dans un style néo-baroque très gratiné. Les Macédoniens n’ont pas le monopole de cette turbo architecture générique faite de dorures et de bardage en faux marbre, mais ils peuvent se targuer d’en avoir fait beaucoup en peu de temps. Le décor de la grandeur classicisante est moins monumental qu’à Astana, au Kazakhstan, faute de moyens. Il est pourtant très efficace dans sa façon de défigurer les berges du Vardar.
Skopje, un modèle d’urbanisme réussi.
Pourtant, l’identité urbaine de Skopje, repensée par Kenzo Tange après le tremblement de terre de 1963, mêlait assez pertinemment le passé ottoman multiconfessionnel à l’humanisme collectiviste yougoslave. La transition des ruelles de la vieille ville aux rues couvertes ou surélevées du centre commercial avait fait l’objet d’une attention particulière. La dernière couche apposée à la hâte semble nier ce travail d’ajustement qui incarnait pourtant la véritable identité historique de la ville. Elle lui substitue un décor dont l’artificialité ne cesse de rappeler le caractère fallacieux.
Un peuple, malgré tout
La colère des manifestants ne pouvait trouver support d’expression plus adéquat que la blancheur fallacieuse des palais en plâtre du président Gruevski. Elle semble ainsi contester la signification que le régime a voulu faire porter à ces monuments.
Le saccage du décor pourrait finalement accomplir ce que le décor avait échoué à représenter. Le caractère massif des manifestations et l’adhésion populaire dont elles témoignent ne sont-elles pas la plus belle façon de faire consister le peuple macédonien ?
Le président Gruevski devrait se consoler de ce retournement. Peut-être que pour la première fois depuis la dissolution yougoslave, les habitants de Skopje agissent comme un peuple uni.
Finalement, cette révolte pourrait être l’acte fondateur du sentiment de cohésion nationale, tant recherché par les nationalistes. Dans tous les cas, ce ne sera pas la première fois qu’un soulèvement fonde symboliquement un peuple européen.