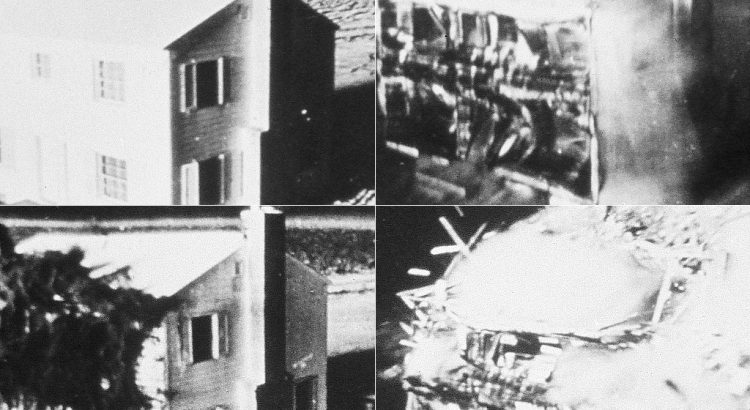LA FORME DES VILLES AMÉRICAINES À L’ÉPREUVE DE LA BOMBE
Cet article est la postface à l’essai d’Alessandra Ponte Desert Testing publié aux éditions B2. Il sera mis en ligne en deux partie les 6 et 9 août, funeste anniversaire du bombardement nucléaire d’Hiroshima et Nagasaki.

Le secret médiatique
Si l’arsenal nucléaire change la façon de faire (ou de ne pas faire) la guerre_9, il a également une incidence sur la façon d’assurer la sécurité intérieure. Dans Them, celui qui découvre la première victime des fourmis mutantes porte encore l’uniforme bleu du policier municipal. À la fin du film, il affronte ces créatures en vert foncé, rangers aux pieds et casque sur la tête. La menace l’a militarisé : glissement symptomatique de l’évolution des sociétés en prise avec la bombe atomique.
Les années 1950 et 1960 sont celles d’une révolte sociale et raciale latente, noyée par le maccarthysme. L’hypothèse d’un basculement à gauche des sociétés capitalistes hante les États-Unis. La réponse à cette menace est bien connue. De la répression dans les milieux artistiques et intellectuels_10, aux guerres de Corée et du Vietnam, sans oublier les coups d’État partout où la transition démocratique menace la pax americana (Iran, Chili, Grèce, Indonésie, Guatemala), l’anti-communisme devient la doctrine officielle de la première puissance mondiale. Sur le front intérieur, une véritable guerre est menée contre l’activisme Noir et les milieux étudiants politisés. Les plus organisés de ces mouvements sont sévèrement réprimés. Dans quelle mesure, l’arsenal nucléaire prend-il part à ce « serrage de vis » généralisé ?
Si une contribution de l’arsenal atomique dans le maintien de l’ordre paraît peu probable, il a pourtant joué un rôle essentiel dans la répression de l’activisme. La paranoïa autour du secret nucléaire a servi de prétexte à une véritable mise au pas de la société. Des centaines de milliers d’employés, scientifiques, universitaires, techniciens, dont le travail touche de près ou de loin à la sécurité nucléaire, sont étroitement espionnés. La peur de la taupe russe devient une hantise nationale. Derrière la nécessité de protéger une technologie sensible, transparaît un dispositif de dissuasion tourné vers l’intérieur, œuvre d’un pouvoir hégémonique excédant tout contrepouvoir et capable d’anéantir toute forme de résistance.
Dans le désert du Nevada, véritable Heimat américain dont l’aspect préfigure l’effet dévastateur d’une détonation nucléaire, les stratèges mettent à l’épreuve bien plus que leur maîtrise scientifique de cette nouvelle technologie. Ils agissent aussi sur l’inconscient collectif d’une nation_11. Ce qui se joue, sur les terrains d’expérimentation, n’est autre que la cohésion du pays et sa façon d’être structuré. La menace nucléaire est en train de devenir un facteur d’aménagement du territoire : elle modifie le rapport aux grandes villes et va bientôt changer la façon de vivre d’une grande partie de la population. Si la dispersion des grandes agglomérations américaines n’est pas exclusivement due à la peur de la bombe, cette dernière n’en constitue pas moins une des principales causes.
Les États-Unis, pour avoir anéanti deux redoutables ennemis en détruisant leurs villes_12, savent mieux que quiconque que la sauvegarde des forces vives du pays, en cas de conflit nucléaire, passe par la réorganisation des villes. Comme partout ailleurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la protection civile devient un facteur déterminant de la planification urbaine. 
Vue du village japonais et du village allemand, utilisés pour des tests d’armes incendiaires.
Les effets de la bombe
Depuis la destruction de Rotterdam en 1940, cela ne fait aucun doute: la ville dense est vulnérable.Cette réalité, maintes fois confirmée pendant la Deuxième Guerre Mondiale avec le bombardement de zone, se maintient et redouble d’importance dans le contexte de la guerre froide. Créer la panique chez l’adversaire est au cœur de la stratégie offensive nucléaire. Certaines descriptions des années 1950 vont même jusqu’à considérer l’arme atomique comme n’étant que le déclencheur psychologique, la matière « explosive » étant la ville et la panique de ses habitants. La peur doit provoquer la désorganisation dès les premières frappes et la vulnérabilité des habitants des villes s’avère dorénavant un sujet de préoccupation et de préparation de premier ordre. À armes égales, vaincra celui qui sera parvenu à endurer une attaque sans sombrer dans le chaos. C’est le raisonnement qui transforme, dans les années 1950, la protection civile en élément clé de la défense nationale_13 .
L’avantage géographique des États-Unis, continental et éloigné des terrains d’opération, cesse avec l’émergence de la menace nucléaire globalisée. Ces essais, mais surtout l’antécédent des bombardements de zone (area bombardement) en Allemagne et au Japon établissent la nécessité d’une dispersion permanente des populations urbaines_14.
Pour autant les États-Unis ne sont pas disposés à financer des déplacements massifs de populations. La solution sera d’accompagner et canaliser le libre entreprenariat et le choix du consommateur. Les agglomérations pavillonnaires périphériques doivent incarner le rêve américain. Elles vont devenir désirables. Ce travail de persuasion cinématographique, mais surtout télévisuel, sera secondé par l’action de nombreuses agences nationales opérant simultanément sur plusieurs niveaux : relocalisation des principales infrastructures militaires et des grandes industries, création d’axes autoroutiers de contournement, et incitations fiscales à la création de nouveaux projets immobiliers, loin des centres urbains. C’est surtout ces deux derniers éléments (l’infrastructure routière et les nouveaux lotissements) qui vont véritablement changer la donne de l’étalement dilué vanté par le sprawling. Pour en mesurer l’effet, il suffit de considérer les chiffres : entre 1950 et 1960 pas moins de 80% du développement urbain global concerne la périphérie_15. Malgré les réticences quant à la mise en œuvre d’une véritable stratégie nationale dans un pays qui vo_15ue un culte à la libre entreprise, la stratégie de dispersion urbaine sera globalement respectée. À la fin des années 1960 elle a effectivement remodelé le territoire périurbain des grandes agglomérations américaines.
Retour de flamme

Cela établi, se pose alors la question des critères qui entrent en jeu dans la réorganisation territoriale des populations urbaines. La classe moyenne en possession d’un véhicule étant seule à pouvoir effectuer la « migration stratégique » vers la périphérie, le nouveau clivage qui se dessine est forcement économique et ethnique.
Pendant que la classe moyenne, essentiellement blanche et protestante, déménage vers les nouveaux faubourgs de lotissements individuels, les Noirs et les populations les plus pauvres restent, par la force des choses, dans les centres villes. Les premiers départs créent un effet « boule de neige » qui incite toujours plus de citoyens aisés à quitter les quartiers mixtes, pour rejoindre les banlieues plus homogènes. Ces nouveaux quartiers étant essentiellement composés de propriétaires, tout va être fait pour que les populations plus pauvres et moins blanches ne puissent y accéder_16. Ainsi, l’Amérique des années 1950-1960 est-elle finalement plus clivée, moins mélangée que celle des années 1930.
Si la dispersion des grandes agglomérations américaines n’est pas exclusivement due à la peur de la bombe, cette dernière n’en constitue pas moins l’une des principales causes. La stratégie de dispersion urbaine combinée au white flight crée une étrange dynamique dont le résultat est encore plus surprenant. Des faubourgs éloignés essentiellement Blancs, et des cœurs d’agglomération Noirs et paupérisés. Savoir si ce clivage social et ethnique a fait l’objet d’une planification reste encore aujourd’hui une question à élucider. Agissant comme un véritable stress test, l’angoisse nucléaire a révélé et intensifié un défaut chronique de la société américaine : la persistance des clivages raciaux, malgré une certaine mythologie de la mixité au fondement de l’identité américaine.
Les clichés de désolation des quartiers Noirs, des immeubles désaffectés du Bronx dans les années 1960 aux quartiers dépeuplés de Détroit dans les années 1990, sont le pendant, non moins apocalyptique, de la menace atomique qui pèse sur la famille américaine. En 1959, quand le réalisateur Ranald MacDougall attribue à Harry Belafonte le rôle du dernier survivant d’un désastre nucléaire, il n’est assurément pas conscient de la dimension visionnaire de son film. Le scénario de The World, The Flesh and the Devil_17, entièrement parcouru par la peur de la bombe, fait étrangement écho au destin de nombreux centres villes transformés en ghettos. Dans une métropole déserte où toute la marchandise lui est enfin destinée, le dernier homme est un Noir et savoure sa triste conquête : Manhattan vidée de ses habitants, il s’efforce de reconstituer des décors de normalité avec des mannequins semblables à ceux disposés dans Doom Town.
Un demi-siècle plus tard, le personnage interprété par Will Smith dans I am Legend (Francis Lawrence, 2007), dernier des hommes vivant à New York, se sacrifie pour expédier la dernière femme Blanche (et le vaccin qu’il a mis au point) vers une communauté de survivants : une gated community bien anglo-saxonne avec ses sentinelles armées, son église, son mur d’enceinte. Entre les deux films, l’Amérique a connu une débâcle, l’anéantissement de son rival, l’avènement du néo-conservatisme et les guerres qui l’ont accompagné, l’effondrement des tours jumelles et un président Noir. Rien de tout cela n’a pour l’heure suffi à supprimer le clivage racial qui structure encore aujourd’hui ses grandes agglomérations.
_10 Voir à ce sujet les enquêtes menées par la HUAC, House of Un-American Activities Committee.
_11 Dans les années 1950, deux stratégies contradictoires s’opposent. La première, alarmiste, vise à sortir la population de sa torpeur face au nucléaire. L’objectif étant d’informer et de former. Elle n’est pas la seule. D’autres campagnes, comme celle menée par le film pédagogique A is for Atom (1953) visent plutôt à générer un enthousiasme dans la population. Dans ce film d’animation destiné aux écoliers, l’atome apparaît comme le garant de la puissance nationale.
_12 Les archives du terrain d’essai Dugway attestent de cette volonté de pointer l’arme sur les familles des combattants plutôt que sur les combattants eux-mêmes. Ces expériences qui se déroulent à partir de 1943 visent à tester la résistance de maisons-types allemande et japonaise aux différentes sortes de bombardements. Ces essais ont permis d’augmenter l’efficacité des engins explosifs et incendiaires en paramétrant le type de construction qu’ils devaient détruire. Plusieurs immeubles ont été construits et bombardés dans le désert de l’Utah avant le déclenchement des bombardements meurtriers sur les deux puissances de l’axe.
_13 Voir notamment Paul Boyer, By the Bomb’s Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age (1ère éd., 1985), Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press, 1994 et Fallout: A Historian Reflects on America’s Half-Century Encounter with Nuclear Weapons, Columbus, Ohio University Press, 1998. Voir aussi Allan M. Winkler, Life under a Cloud: American Anxiety about the Atom, New York, Oxford University Press, 1993 ; Kenneth D. Rose, One Nation Underground: A History of the Fallout Shelter in American Culture, New York, New York University Press, 2001 ; Tom Vanderbilt, Survival City: Adventures among the Ruins of Atomic America, New York, Princeton Architectural Press, 2002 ; et David Monteyne, Fallout shelter : Designing for Civil Defense in the Cold War, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2011. (NdE)
_14 L’ouvrage collectif dirigé par Jörn Düwel & Niels Gutschow, A Blessing in Disguise, War and Town Planning in Europe (Berlin, Dom Publishers, 2013), souligne le lien entre les destructions massives induites par la guerre aérienne et l’urbanisme moderne. Ses auteurs montrent comment les bombardements aériens pendant la Seconde Guerre mondiale ont radicalement changé la perception du milieu urbain. La planification urbaine va réagir très rapidement au potentiel destructeur des bombardements, notamment dans sa façon d’envisager la reconstruction. La généralisation du modèle de la ville fonctionnelle, faite de barres et de tours, le développement de l’urbanisme souterrain et la création de grands axes automobiles interurbains sont parmi les choix des planificateurs, ceux qui relèvent d’une réaction à la menace aérienne. L’urbanisme moderne des années 1950-1960 peut être interprété comme une stratégie collective de dispersion et de camouflage. Des routes pour fuir, des foyer qui ne brûlent pas et des infrastructures pouvant se transformer en abris collectifs : c’est la ville née de la peur des villes.
_15 Kathleen A. Tobin, « The Reduction of Urban Vulnerability: Revisiting 1950s American Suburbanization as Civil Defence », in Cold War History, vol. 2, n°2, janvier 2002, p.1-32.
_16 Dans le troisième chapitre de City of Quartz. Los Angeles capitale du futur (1990 ; Paris, La Découverte, 1997), Mike Davis s’attarde sur la lutte acharnée des associations de propriétaires, dans les conseils municipaux des nouveaux faubourgs de Los Angeles, contre les projets immobiliers destinés à la location. Il commente cette levée de bouclier contre des lotissements pour locataires comme une tentative acharnée de maintenir une certaine homogénéité ethnique dans certains quartiers.
_17 La dimension politique du cinéma post-apocalyptique fut abordée par Jennifer Verraes dans une série d’articles et le projections réalisés en 2013 pour la revue Tracés en partenariat avec la Cinémathèque suisse.