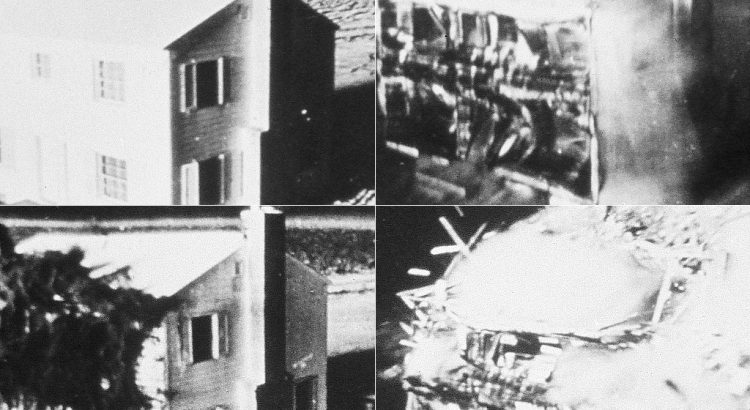LA FORME DES VILLES AMÉRICAINES À L’ÉPREUVE DE LA BOMBE
Cet article est la postface à l’essai d’Alessandra Ponte Desert Testing publié aux éditions B2. Il sera mis en ligne en deux partie les 6 et 9 août, funeste anniversaire du bombardement nucléaire d’Hiroshima et Nagasaki.
Si, comme le montre l’essai d’Alessandra Ponte, les terrains d’essais nucléaires du Nevada ont pu faire l’objet de nombreuses expériences dans le domaine des arts visuels et plastiques, c’est qu’ils furent, dès le début – et en dépit du caractère confidentiel des activités qui s’y déroulaient –, au cœur d’un programme de communication. Chose inhabituelle pour des expériences scientifiques militaires, ces essais ont donné lieu à des images, des enregistrements visuels et sonores, utilisés peu de temps après dans des films pédagogiques ou des ouvrages de vulgarisation. Les États-Unis sont les seuls à procéder de la sorte en menant simultanément à travers leurs expériences scientifiques une véritable campagne médiatique pour démontrer aux adversaires la supériorité de leur arsenal, mais surtout pour familiariser les citoyens avec la menace atomique. La disposition à communiquer dont font preuve les agences scientifiques américaines, contrairement à leurs homologues soviétiques, n’est pas pour autant un signe d’ouverture. Elle témoigne plutôt d’une volonté de maîtriser l’un des principaux effets de la menace atomique : le stress qu’elle crée et la façon dont elle agit sur l’inconscient collectif.
Les monstres cinématographiques qui hantent l’Amérique, les fourmis atomiques géantes qui sillonnent ses égouts, les hordes de morts-vivants qui affluent et dont l’aspect et la gestuelle n’est pas sans rapport avec ceux des véritables victimes du feu nucléaire, les détrousseurs de corps (body snatchers) qui complotent, toujours plus nombreux, sont les indices précoces du malaise qui s’installe_1. Il fallut attendre la fin de la guerre froide pour avoir une image synthétique de ce malaise, et de sa principale conséquence dans l’évolution de la société américaine : son incidence sur la forme des villes.
Chercher la petite bête dans le désert
Géantes et passablement bruyantes, les fourmis mutantes n’en restent pas moins furtives. Dissimulées dans des galeries souterraines, dans les canalisations de Los Angeles, ou tout simplement sous un épais nuage de poussière, elles n’apparaissent que pour tuer ou être tuées. Dans Them, film d’épouvante symptomatique de l’angoisse des années 1950, la traque qui doit permettre de stopper leur prolifération prend la forme d’un safari. En jeep et en hélicoptère, l’équipe de choc est constituée d’hommes d’action – tour à tour simples policiers, agents du FBI puis militaires aguerris – et de scientifiques – l’entomologiste et sa charmante fille marchant dans les pas de son père. Leur alliance n’est pas sans évoquer la collaboration des militaires et des scientifiques qui préfigure l’entrée de la société américaine dans l’ère atomique. Quant à l’enjeu de leur traque, il rappelle l’un des objectifs des essais atomiques : contrôler les représentations, préparer la population et ne pas laisser la panique s’imposer. L’équipe de choc doit agir de manière discrète et efficace, exactement comme leur ennemi, les fourmis.
Ce qui est donc « testé » sur les terrains d’essai du Nevada, c’est autant la technologie nucléaire que la disposition psychologique des populations à vivre avec cette menace. Les Américains, pour avoir disposé de cette arme avant les autres et surtout pour l’avoir utilisée dans un conflit, en connaissent les effets secondaires et en mesurent l’impact sur l’imaginaire et les comportements. Des études menées à Hiroshima juste après sa destruction démontrent le caractère dévastateur de l’explosion nucléaire sur le moral des populations. _2

Persuadés que l’avenir de leur suprématie dépend de leur aptitude à affronter les conséquences d’une attaque, les stratèges envisagent assez tôt la préparation de la population aux conséquences d’un conflit atomique. Entre autres choses, les tests effectués dans le désert du Nevada constituent le laboratoire scientifique et l’antichambre médiatique de cette préparation. Le 17 mars 1953, plusieurs centaines de journalistes sont invités à assister à Annie, une explosion nucléaire de dix sept kilotonnes. Il s’agit là d’un évènement médiatique d’envergure nationale : trois Américains sur quatre ont entendu parler de cet essai ou l’ont vu à la télévision. Baptisé Doom Town par les journalistes, l’ensemble des maisons conçues pour subir l’explosion sont équipées comme des foyers types. Des mannequins en plastique sont disposés dans des attitudes évoquant le quotidien d’une famille moyenne. L’opération relève plus d’une action de sensibilisation visuelle aux risques du nucléaire que d’une véritable étude scientifique sur la vulnérabilité des structures et des matériaux. Les séquences pseudo-scientifiques mettant en scène l’anéantissement du rêve américain sont censées provoquer un éveil national. Comme en atteste le long reportage photographique publié à l’époque par Life Magazine, l’Amérique doit prendre conscience de la menace et des nouvelles incertitudes qui pèsent sur elle (Staline est mort deux semaines plus tôt, le 5 mars). C’est le sentiment que doit inspirer aux téléspectateurs la vue des mannequins démembrés jonchant le sol des maisons soufflées. La morale de l’histoire se laisse déduire de la résistance des prototypes conçus pour l’occasion : la première maison, située à un kilomètre du point d’impact est totalement anéantie ; la deuxième, située à deux kilomètres, résiste. Le message est clair. Plus on habite loin du centre, plus on a des chances de s’en sortir_3.

Le paradoxe d’une arme testée après son utilisation effective
Si les Américains peuvent se permettre en 1953 de mettre en scène des expériences à des fins pédagogiques, c’est que l’évaluation scientifique d’une explosion a été menée bien avant cette date. L’exposition Hiroshima: 1945 Ground Zero, qui s’est tenue en 2011 à l’ICA de New York, revenait sur l’archive raisonnée des dégâts matériels causés par l’explosion nucléaire à Hiroshima, le 6 août 1945. Le caractère ambivalent de cette étude était au cœur de l’exposition : elle servit aussi bien à l’élaboration de stratégies de protection civile, qu’à développer et à perfectionner des armes nucléaires plus puissantes. Les archives déclassifiées qui constituaient l’essentiel de l’exposition s’efforçaient de quantifier l’inimaginable : la pulvérisation instantanée d’une ville.
C’est en septembre 1945, quelques semaines seulement après l’attaque, que la mission comptant plus de 1.150 civils et militaires entama son fastidieux travail dans les ruines d’Hiroshima. Composée de photographes, d’ingénieurs, de physiciens et de médecins, l’équipe de scientifiques observa, testa, mesura, dressant ainsi le premier bilan technique de l’attaque nucléaire.
Les bombes étaient une énigme, tant pour les Japonais que pour ceux qui venaient de l’utiliser. Elles venaient tout juste d’être testées dans le désert du Nouveau-Mexique, trois semaines avant leur largage sur Hiroshima (Little Boy, 12-15 kt) et Nagasaki (Fat Man, 20-22 kt) . Si la nature dévastatrice d’une explosion nucléaire ne faisait aucun doute, personne ne savait vraiment quel serait son impact, ni la durée de l’irradiation produite. Et pour cause : en 1945, les scientifiques américains présents sur place ignoraient la nocivité des retombées radioactives, pourtant bien moins puissantes que toutes les suivantes. Prenant acte de l’effet dévastateur de la déflagration nucléaire, des groupes de travail s’efforcèrent assez rapidement d’établir des stratégies de protection. De nombreuses études cherchèrent à sensibiliser les ingénieurs et les architectes aux méthodes pour renforcer le bâti _4. D’autres encore poursuivirent des réflexions initiées dès les années 1930 autour de la guerre aérienne, et de la nécessité de développer l’architecture et l’urbanisme souterrains _5.
Hiroshima, terrain d’essai

Aux deux thèses qui prévalaient jusqu’à présent pour expliquer la destruction d’Hiroshima – écourter la guerre et envoyer un message clair aux Soviétiques –, la série d’archives de l’USSBS en ajoute une troisième: celle de l’essai scientifique en vraie grandeur. L’état-major se serait servi d’un conflit sur le point d’être gagné pour tester à l’échelle d’une ville sa nouvelle arme secrète. Si les images et les commentaires des techniciens sur l’impact de l’explosion laissent pressentir cette thèse, l’article de John W. Dower la confirme. La destruction massive et planifiée des villes japonaises à partir de mars 1945 par les escadrons de B-29 du général Curtis ménageait en effet certaines agglomérations. Une explosion dans une ville à moitié détruite n’aurait pas permis d’en mesurer l’impact. La cible de la nouvelle arme devait être intacte. Selon Dower,_6 la principale hantise des stratèges américains aurait été que le Japon se rende avant l’utilisation de la bombe.
Si les essais d’Hiroshima et Nagasaki ciblaient des Japonais, ceux du Nevada avaient pour cible théorique les Américains. La préparation de la société aux risques du nucléaire est une opération complexe, impliquant de nombreuses agences nationales, travaillant parfois en concurrence les unes contre les autres_8. Ce dont ils ont l’intuition en 1945 se confirme le 29 août 1949 avec le premier essai nucléaire soviétique. L’arme nucléaire crée une peur collective aussi dangereuse que la destruction à proprement parler. Il faut répondre à l’angoisse, la canaliser pour en faire un facteur de mobilisation. C’est dans cet esprit que furent menées les campagnes de sensibilisation aux risques nucléaires dans les années 1950.
Suite et fin le 9 août 2017.
_1 Nous pensons ici aux fables cinématographiques qu’a inspirée la peur de la bombe comme Them ! (1954) de Gordon Douglas, Invasion of the Body Snatchers (1956) de Don Siegel ou encore Dawn of the Dead (1978) de George A. Romero. Sur plus de cinq cents pages, un ouvrage sous la direction de Phil Hardy en recueille une somme quasi exhaustive : The Overlook Film Encyclopedia, vol. Science fiction (1984), The Overlook Press, New York, 3rd ed. 1995.
_2 L’USSBS (United States Strategic Bombing Survey). Ce comité d’experts constitué pour étudier l’impact des bombardements stratégiques a rédigé pas moins de trois cents ouvrages sur les conséquences matérielles et psychologiques des campagnes aériennes en Europe et dans le Pacifique.
_3 Dans cet âge d’or de la « cybernétique » américaine, c’est ce que Norbert Wiener et d’autres avaient souhaité démontrer et vulgariser in Norbert Wiener, Karl Deutsch, Giorgio de Santillana, « How U.S. Cities Can Prepare for Atomic War. M.I.T. Professors Suggest a Bold Plan to Prevent Panic and Limit Destruction », Life, 18 décembre 1950, p.76-84. Le plan de Wiener prônait « la croissance rapide d’une vie semi-rurale au grand air et à la périphérie des villes », tandis qu’allant dans le même sens, un autre article, publié dans American City, recommandait des « nucléations », c’est-à-dire des poches de zones concentrées séparées par des green belts. (NdE)
_4 « A-Bomb Resistant Buildings: Design Lessons from Hiroshima and Nagasaki », Architectural Forum, novembre 1950, p.146-150.
_5 En France, le GECUS (Groupe d’études et de coordination de l’urbanisme souterrain) milite pour la création de grandes infrastructures souterraines. Son influence aurait été déterminante dans la destruction des Halles de Paris et leur remplacement par le centre commercial souterrain actuel. Sous l’impulsion de l’ingénieur Édouard Utudjian, voir Nikola Jankovic, De Beaubourg à Pompidou – II. Le chantier (1971-1977), Paris, éditions B2, 2017, p.64-67. Voir aussi Beatriz Colomina, La pelouse américaine en guerre. De Pearl Harbor à la Crise des Missiles, tr. fr. H. Sirven & al., et Jay Swayze, Le Meilleur des (deux) mondes. Maisons et jardins souterrains, tr. fr. A. Steiger, Paris, éditions B2, respectivement 2011 et 2012. (NdE)
_6 John W. Dower, « Science, Technocracy, Beauty & Idealistic annihilation », in Erin Barnett & Philomena Mariani (eds.), Hiroshima Ground Zero 1945, Göttingen, Steidl, 2011.
_7 Dans son ouvrage Nuclear Fear, A History of Images, Spencer R. Weart explique qu’il n’est pas rare dans les années 1950 d’entendre à la radio des avis contradictoires : des scientifiques rassurants contredits par des généraux de l’armée de l’air, exagérant le risque et les conséquences d’une attaque soviétique pour forcer l’État Fédéral à augmenter le budget de leur corps d’armée.