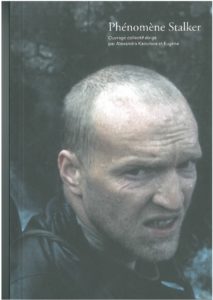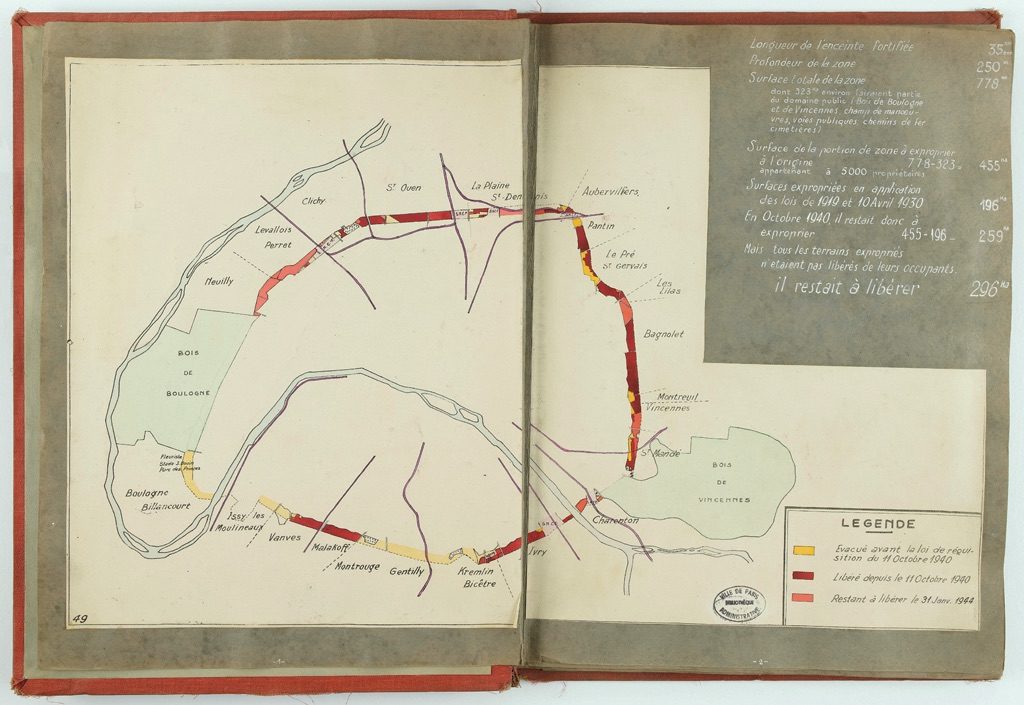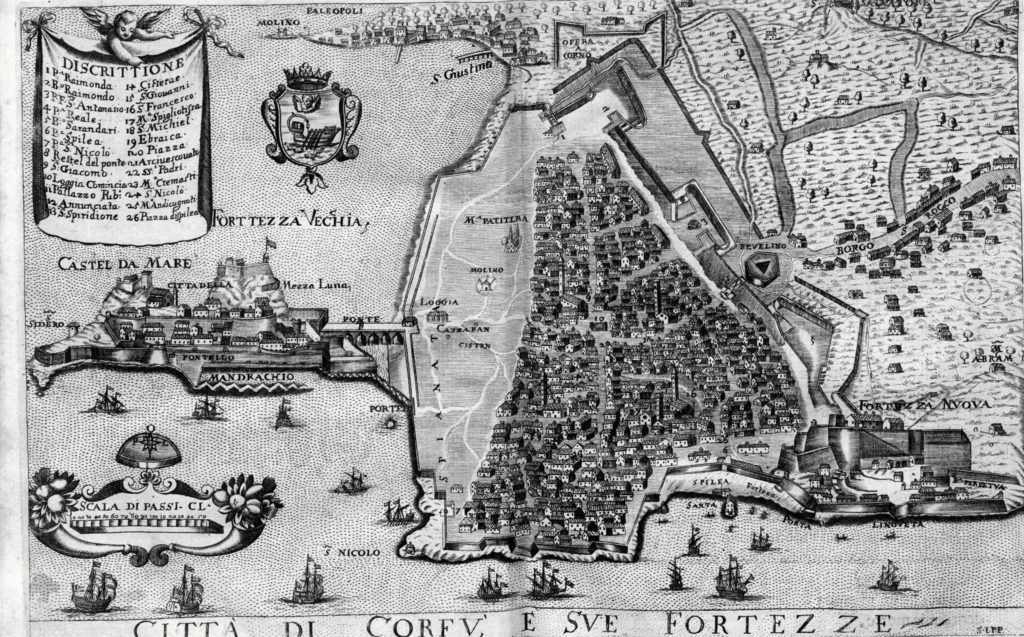Pendant que le Centre Pompidou devient le spécialiste de la «monographie architecturale promotionnelle » (Gehry par LVMH, Ando par Pinault), le MoMA de New York conforte sa position d’institution capable d’écrire l’histoire globale de l’architecture, avec une exposition érudite et généreuse. Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980 offre un tour d’horizon architectural d’un pays qui n’existe plus, la Yougoslavie.
Cette recherche regroupant des théoriciens de toutes les ex-républiques yougoslaves, ainsi que de nombreux expatriés, repose pour l’essentiel sur le travail de l’historien Vladimir Kulic autour du rôle de l’architecture dans l’édification nationale. L’exposition du MoMA vient compléter sa recherche académique par un ambitieux travail documentaire, qui regroupe des images d’archive, des plans et des affiches, ainsi qu’une nouvelle commande photographique des principaux édifices emblématiques. Cette série d’images de Valentin Jeck redonne de la cohérence à un patrimoine architectural dissout tant par la guerre, que par la façon dont le territoire à été reconfiguré autour d’identités micro-nationales. Le cas de Skopje et de son revirement turbo-baroque est caractéristique de cette évolution.

L’exposition permet donc de replacer l’architecture yougoslave dans une histoire globale de la modernité, dont elle fut, pour diverses raisons, exclue. Pourtant, il suffit de se rendre dans l’une des six anciennes républiques pour observer la qualité architecturale des réalisations, dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce que l’exposition nous apprend, c’est que cette culture du bâti fut le résultat d’une stratégie planifiée. Que ce soit dans une Skopje brutaliste, meurtrie par la récente paranoïa classicisante, à Zagreb ou dans le nouveau Belgrade, la modernité yougoslave surprend par son éclectisme et sa nature profondément expérimentale. Les bâtiments ne se ressemblent pas, ils sont l’œuvre d’architectes ayant recours à des écritures très variées. Nous sommes loin de l’écrasante standardisation qui a prévalu en Europe de l’Est.
L’exposition et le catalogue dressent donc un panorama constitué de figures pour l’essentiel inconnues. Car les architectes yougoslaves, malgré le fait qu’ils aient été à certains égards exportés, sont totalement absents du récit globalisé de l’évolution architecturale du XXe siècle. Le premier mérite de ce projet est donc d’opérer une sorte de fouille préventive d’un patrimoine menacé par la dissolution de sa raison d’être : faire exister un pays multiconfessionnel et multiethnique dans un territoire où le nationalisme a fait le plus de ravages, les Balkans.

CONSTRUIRE UN PAYS PAR L’ARCHITECTURE
Dès le début de l’édification yougoslave, l’architecture joue un rôle central dans la constitution d’un récit commun entre des peuples qui partagent, pour certains, la langue, plus rarement la confession, et souvent ni l’un ni l’autre. Ce travail de cohésion va prendre la forme d’un transfert de connaissance et de richesse du Nord développé vers le Sud. Dans une démarche qui n’est pas sans rappeler l’aide au développement russe aux républiques du Caucase, l’État yougoslave missionne des architectes des Républiques prospères pour s’établir et travailler dans celles qui en ont besoin.

Dans ce même esprit d’aide au développement, les grands chantiers, autoroutes, infrastructures collectives, font l’objet d’une mobilisation citoyenne sur la base du volontariat. La Yougoslavie devient le projet collectif d’une jeunesse mobile qui se découvre et découvre les Républiques voisines en venant travailler quelques mois sur des chantiers conçus comme des colonies de vacances.
L’architecture et l’urbanisme contribuent finalement à réduire partiellement l’écart du niveau de vie des populations. Si la disparité du pouvoir d’achat demeure entre la Slovénie, qui avoisine le niveau de vie de l’Autriche, et la Macédoine, plus proche de celui de la Bulgarie, les grands projets d’aménagement, la planification et surtout la volonté d’édifier un avenir commun façonnent le pays, à certains égards bien plus prospère que son voisin grec, pourtant membre de l’OTAN.
AUTOPUT BRATSTVO I JEDINSTVO : L’AUTOROUTE DE LA FRATERNITÉ ET DE L’UNITÉ
S’il est un ouvrage qui résume cette tentative d’édifier une nation par le chantier, c’est l’autoput yougoslave, « l’autoroute de la Fraternité et de l’Unité ». À elle seule, cette route a cristallisé les aspirations et les contradictions du projet national. Conçue peu après la Seconde Guerre mondiale, elle traversait quatre des six républiques qui constituaient la Fédération. De la frontière avec l’Autriche jusqu’à la Grèce, cette artère de 1 180 km était un ouvrage d’exception pour les standards balkaniques.
Empruntée par les Yougoslaves, elle était aussi largement fréquentée par les touristes allemands et autrichiens en quête de soleil méditerranéen. Parsemée de monuments fédérateurs, elle traversait le quartier administratif et résidentiel du nouveau Belgrade, disposé symétriquement de part et d’autre de l’axe. L’autoput yougoslave était une grande avenue à l’échelle d’un pays. Elle a marqué plusieurs générations de voyageurs, par sa monotonie, ses restaurants de service public, mais aussi par son efficacité. En s’y engageant, on traversait l’Europe d’une traite.

SKOPJE, BELGRADE ET ENCORE…
Deux grands projets restent à ce jour emblématiques de la qualité urbaine yougoslave : la reconstruction de Skopje sur des plans de Kenzo Tange suite à la destruction de la ville en 1963 ; et le nouveau Belgrade, sorte de Brasilia balkanique qui vient doubler la capitale serbe, de l’autre côté du fleuve Save, pour y accueillir le centre administratif du pays. Skopje pourrait légitiment revendiquer le titre de capitale métaboliste européenne. Une grande partie du centre-ville reste encore à ce jour tributaire du plan de Tange.
Plus encore que ces grands projets urbains, ce sont les particularités et la diversité de la création yougoslave qui surprennent. Son spectre large oscille entre le brutalisme des grands ensembles croates aux apports vernaculaires dans la modernité bosniaque; du structuralisme du système modulaire K67 Kiosk, qui sera par ailleurs exporté dans le monde entier, à l’expressionnisme de la mosquée blanche de Šerefudin à Visoko, en Bosnie-Herzégovine.

Zlatko Ugljen, mosquée blanche de Šerefudin, 1969–79, Visoko, Bosnie Herzégovine. Rare exemple d’une mosquée conçue selon des critères topographiques, avec un travail architectural sur les apports de lumière à différents moments de la journée, la mosquée blanche de Šerefudin s’inscrit dans une lignée d’ouvrages qui fusionnent éléments vernaculaires et modernes.
Aujourd’hui l’architecture yougoslave peine à être reconnue pour sa valeur réelle. Elle est à l’image de ces centaines de monuments qui parsèment le territoire yougoslave, érigés pour donner corps à un pays qui n’existe plus. 30 ans après la guerre fratricide qui a ravagé le pays, l’Occident découvre que la Yougoslavie titiste avait pour doctrine officielle la démocratie directe, le féminisme et la parité, le soutien à la décolonisation et l’autogestion industrielle. L’exposition montre bien à quel point l’architecture était la pierre angulaire que cet ethos civique et politique.
Article paru dans L’Architecture d’Aujourd’hui
Toward a Concrete Utopia : Architecture in Yugoslavia, 1948-1980
The Museum of Modern Art – New York
Jusqu’au 13 janvier 2019
www.moma.org