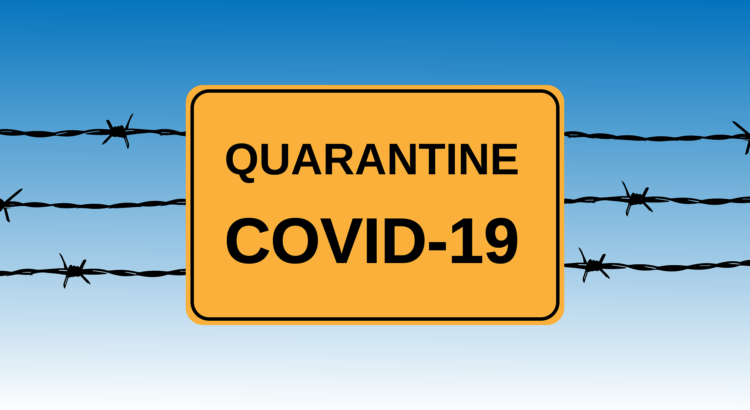De quoi parle-t-on ?
L’accord de libre-échange avec l’Indonésie vise à libéraliser le commerce des marchandises et à renforcer les échanges commerciaux entre la Suisse et l’Indonésie, en améliorant les conditions d’accès au marché indonésien pour les entreprises suisses exportatrices. L’accord élimine en effet les droits de douane sur 98 % des exportations suisses, améliorant l’accès et la compétitivité sur le marché de produits suisses, principalement dans les domaines chimique, pharmaceutique et des machines. L’objectif est également d’offrir de nouveaux débouchés commerciaux en Indonésie pour d’autres produits suisses, dont des denrées alimentaires. Le Conseil fédéral cite notamment le chocolat, le fromage et les produits laitiers. En échange, la Suisse s’engage notamment à réduire les droits de douane sur un certain nombre de produits exportés par l’Indonésie. Il s’agit, entre autres, de réduire de 20 à 40 % les droits de douane sur une quantité d’huile de palme de 12’500 tonnes par an (alors que nous n’en importons actuellement que 35 tonnes). Cet avantage douanier serait accordé sur la base de prétendus critères de durabilité.
Le fait que cet accord fixe, d’une part, un plafond pour la quantité d’huile de palme bénéficiant de droits de douane réduits et que ces réductions soient, d’autre part, soumises à des prétendus critères de durabilité, constitue une réponse à des critiques émises par les milieux agricoles et écologistes.
Des critiques des milieux agricoles et écologistes
En effet, l’huile de palme représente une concurrence directe à la production d’huile végétale locale, ce que les milieux agricoles suisses ont relevé dès le début des négociations. Outre l’évolution de nos habitudes alimentaires, l’augmentation massive de sa consommation est due au prix très bas de l’huile de palme, que la réduction des droits de douane rendrait encore plus attractive face aux alternatives végétales locales que sont l’huile de colza ou de tournesol.
Les écologistes ont en outre critiqué dès le départ le projet de réduire les droits de douane pour l’huile de palme, car sa production implique des atteintes écologiques et sociales graves dans les pays producteurs. En effet, les plantations de palmiers à huile affichent l’une des empreintes CO2 les plus élevées par surface de tous les produits agricoles d’intérêt mondial. Cet impact carbone est dû au fait qu’elles se développent sur la base de destructions massives de forêts humides et de tourbières. La disparition de ces précieux biotopes entraine en outre des pertes désastreuses en termes de biodiversité. Une fois les zones naturelles détruites, le type d’exploitation agricole mis en place représente un impact supplémentaire, puisqu’il s’agit de monoculture intensive utilisant des pesticides polluants. Socialement, la situation n’est pas meilleure : accaparement des terres, expulsion de communautés autochtones et conditions de travail inacceptables dans les plantations font partie de la réalité du terrain en Indonésie. La corruption est aussi présente. Les militaires en sont parmi les plus gros profiteurs, de par leurs relations avec les grandes compagnies d’huile de palme et l’industrie du bois. Les plantations exploitent enfin un grand nombre d’ouvriers agricoles et suscitent l’abandon de cultures vivrières qui assuraient auparavant la sécurité alimentaire des populations locales. L’agriculture s’oriente de plus en plus sur les exportations, au mépris de la souveraineté alimentaire du pays.
Le green-washing érigé en référence
L’accord de libre-échange avec l’Indonésie est le premier à comporter des prétendues exigences de durabilité. Il est très important dans cette perspective. En effet, il servira de référence pour d’autres accords à venir. Or il est quelque chose de plus dangereux encore que le mépris franc et ouvert face aux impacts environnementaux. Aujourd’hui, ce dernier est devenu politiquement incorrect : tout le monde, ou presque, prétend se préoccuper de l’avenir de notre planète. Par contre, un nouveau risque se manifeste de plus en plus souvent. C’est le green-washing, qui permet de continuer, comme avant, à détruire l’environnement, tout en se donnant bonne conscience.
On aurait aimé se réjouir des prétendus critères de durabilité introduits dans l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Malheureusement, les dispositions finalement adoptées ne sont pas crédibles. Elles peuvent certes faire plaisir sur le papier, mais n’auront pas l’impact attendu sur le terrain.
La démarche servant de référence écologique à l’accord de libre-échange, la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), existe depuis une quinzaine d’années et regroupe les entreprises qui produisent les 85 % de l’huile de palme en Indonésie. Or elle n’a pas tenu ses promesses. La RSPO a échoué à freiner la déforestation, ainsi que les impacts écologiques et sociaux désastreux de l’huile de palme en Indonésie.
Elle comporte tout d’abord des faiblesses intrinsèques. Il est possible d’être labellisé, alors que les critères du label ne sont appliqués que sur une partie des plantations. Le défrichage de forêts secondaires d’importance écologique est toléré et la RSPO ne fait que des recommandations en ce qui concerne la destruction des tourbières. Même certifiées, les plantations relèvent toujours de monocultures intensives nuisibles à la biodiversité, impliquant l’utilisation de pesticides toxiques. Les ouvriers agricoles utilisent de tels produits dans de mauvaises conditions, mettant en jeu leur santé, et ces produits polluent les eaux et le sol.
La mise en œuvre des dispositions de la RSPO, déjà insuffisantes en elles-mêmes, laisse de plus à désirer, puisque les mécanismes de validation et de sanction ne sont pas crédibles, voire inexistants. Tout est géré et contrôlé par les producteurs certifiés eux-mêmes, sans contrôle indépendant, dans un contexte où la corruption existe. De facto, la production d’huile de palme, y compris celle qui est certifiée RSPO, ne peut pas être décrite comme durable, ou alors il faut accepter le fait que ce mot ne veuille plus rien dire.
L’accord de libre-échange lui-même n’apporte aucune garantie supplémentaire sur l’impact réel, sur le terrain, des prétendus critères de durabilité qu’il cite. Le chapitre sur le développement durable n’est en effet pas soumis au mécanisme de règlement des différends entre Etats prévu par l’accord et ne peut donc pas, contrairement aux autres parties de l’accord, déboucher sur des sanctions en cas de non-respect de ses exigences.
Une aggravation de la situation écologique et sociale
Depuis la signature de l’accord de libre-échange, qui concerne aussi d’autres pays de l’AELE, la situation écologique et sociale s’est dégradée en Indonésie. Dans le but d’attirer plus encore les investisseurs étrangers auxquels l’accord ouvre les portes du pays, le parlement indonésien a voté une loi dite « Omnibus ». Elle réduit les dispositions existantes dans le pays en matière de protection de l’environnement, ainsi que les droits des communautés indigènes et des employés. Les ordonnances contre les brûlis sont notamment assouplies et le gouvernement pourra créer de nouvelles plantations de palmiers à huile dans des forêts soumises jusqu’alors à un moratoire sur l’exploitation forestière. De facto, les autorités indonésiennes conçoivent cet accord de libre-échange comme un jalon dans l’accélération de l’exploitation – ou de la surexploitation devrait-on dire – des ressources naturelles du pays à des fins d’exportation.
Ce n’est pas ce qu’il convient d’appeler un développement durable. Sur place, seize organisations représentant la société civile (notamment des organisations de pêcheurs, d’agriculteurs, de femmes, de protecteurs de l’environnement et de scientifiques) ont d’ailleurs écrit une lettre ouverte au parlement pour dénoncer l’accord de libre-échange et son impact sur la population locale.
Imposer des critères de durabilité crédibles plutôt que des avantages douaniers
Aujourd’hui déjà, la majeure partie de l’huile de palme importée en Suisse correspond aux critères de la RSPO. On aurait au moins pu exiger dans le cadre de l’accord de libre-échange des critères supplémentaires, débouchant sur une réelle amélioration de la situation écologique et sociale sur place.
En Suisse, certains acteurs positionnés sur le développement durable sont en train de le faire d’eux-mêmes, prenant acte de l’échec de la certification RSPO. Voici la position de Coop, qui s’est initialement engagée auprès de la RSPO : « Il a fallu se rendre à l’évidence : cela ne suffit pas à résoudre les problèmes liés à la culture de l’huile de palme ». Coop a ainsi décidé de n’utiliser à l’avenir plus que de l’huile de palme correspondant aux critères du Bourgeon de Bio Suisse. Les critères du bio sont, eux, crédibles sur le principe : exclusion des plantations issues de défrichements de forêts primaires ou secondaires ayant eu lieu après 1994, feux de déforestation exclus, culture sans pesticides ou engrais de synthèse, standards sociaux, priorité aux coopératives de petits producteurs. De plus, des contrôles indépendants sont réalisés. La production d’huile de palme bio, selon ces critères du Bourgeon, est encore rare à l’échelle mondiale (quelques producteurs au Brésil, en Colombie et à Madagascar). Tout est donc à faire. Ce type de production est inexistant en Indonésie. Le fait d’imposer de tels critères dans le cadre de l’accord de libre-échange aurait dès lors eu du sens : on aurait au moins pu en espérer une véritable amélioration, plutôt que de valider des pratiques qui sont en échec depuis des années et qui ont tout du green-washing.
Plus fondamentalement, Coop prévoit de remplacer l’huile de palme par des alternatives plus écologiques, à chaque fois que c’est faisable et pertinent, dans une série de produits réalisés sous sa propre marque. Ce qui doit susciter notre réflexion, c’est en effet l’omniprésence de ce produit, que l’accord de libre-échange cherche à rendre plus attractif encore. On trouve de l’huile de palme quasiment partout. Pourtant, nos parents n’avaient probablement jamais entendu parler d’huile de palme à notre âge. Ce n’est que depuis peu que sa consommation a augmenté de manière exponentielle. La production mondiale a ainsi presque doublé au cours des douze dernières années, atteignant 70 millions de tonnes. En Suisse, l’importation d’huile de palme a été multipliée par plus de huit, passant de 3’500 à 29’500 tonnes entre 1988 et 2017. Elle est surtout présente dans les aliments industriels ultra-transformés dont regorgent aujourd’hui les rayons de nos supermarchés.
Une omniprésence problématique, également pour notre santé
Le succès de l’huile de palme est principalement dû à son prix très bas, lié au haut niveau de productivité des palmiers à huile, tout particulièrement lorsqu’ils sont exploités en culture intensive, et aux faibles normes écologiques et sociales sur les lieux de production. Ce bas prix encourage l’utilisation de l’huile de palme dans un maximum de produits et en grandes quantités (surconsommation de matières grasses), mais aussi le remplacement d’huiles locales, comme l’huile de colza ou de tournesol.
Ce phénomène est problématique du fait de l’impact écologique et social de l’huile de palme lors de sa production et de son transport, de la concurrence qu’elle représente pour les huiles végétales locales, mais aussi en termes de santé publique. En effet, l’huile de palme est particulièrement riche en acides gras saturés (cinq fois plus que l’huile de colza), qui favorisent les maladies cardio-vasculaires. Alors qu’elle se cache dans d’innombrables produits, elle finit par être consommée, souvent sans que l’on s’en rende vraiment compte, en quantité, et porte atteinte à notre santé. A la monoculture industrielle d’huile de palme, polluant l’environnement et affectant la santé des ouvriers agricoles dans des pays lointains, correspond ici la « mono-consommation » d’huile de palme, dans des produits eux aussi industriels, standardisés et néfastes pour notre santé. Et c’est cela que l’on veut nous vendre comme de la durabilité.
Dès lors, la question que nous devons nous poser, au-delà de la crédibilité des critères de durabilité cités dans l’accord de libre-échange, est aussi celle-ci : est-il vraiment pertinent d’offrir des avantages sur notre marché à un tel produit ? Notre responsabilité ne devrait-elle pas être plutôt d’imposer à l’importation, à la place d’avantages douaniers, des critères stricts d’accès au marché, sous la forme de prescriptions, qui imposeraient des modes de production vraiment écologiques et sociaux ? Si l’on appliquait sérieusement le principe du pollueur-payeur et que l’on réfléchissait à son impact sur notre santé, l’huile de palme ne devrait pas être favorisée financièrement. Elle devrait plutôt voir son prix augmenter par rapport aux alternatives plus locales, plus saines et plus écologiques. Des critères écologiques et sociaux sérieux auraient d’ailleurs probablement un tel impact sur son prix, en attendant l’application du principe du pollueur-payeur aux transports de marchandises internationaux, dont la multiplication sur de longues distances a un effet désastreux sur le climat.
Quel modèle d’échanges commerciaux voulons-nous pour demain ?
Evidemment, on objectera que cet accord de libre-échange est nécessaire pour nos entreprises d’exportation, productrices de machines, de produits chimiques et de médicaments, ainsi que pour nos investisseurs, alléchés par ce nouveau marché. Grâce à la réduction des droits de douanes, leurs produits et services deviendront plus compétitifs sur le marché indonésien et ils pourront obtenir de meilleures marges. Cela va indiscutablement dans le sens de leurs intérêts commerciaux.
Mais les intérêts commerciaux de ces entreprises, tout compréhensibles qu’ils soient, justifient-ils que l’on ferme les yeux sur les impacts écologiques et sociaux d’un tel accord ? Au-delà de la thématique de l’huile de palme, déjà extrêmement problématique en soi, ce type d’accord vise à intensifier les échanges commerciaux sur de longues distances, en réduisant toutes les barrières, douanières mais aussi légales. C’est ce qu’illustre la loi « Omnibus », récemment votée par le parlement indonésien en marge de l’accord de libre-échange, qui affaiblit la protection de l’environnement et du travail.
Avec de tels accords, nous perpétuons le modèle de développement économique actuel, basé sur l’exploration de nouveaux marchés de plus en plus lointains et sur une pression permanente sur les prix. Ce modèle génère une explosion des transports de marchandises sur de longues distances et une dangereuse sous-enchère écologique et sociale. La tyrannie des bas prix débouche en outre trop souvent sur un gaspillage de ressources (le « prêt à jeter ») et sur une surconsommation de produits de mauvaise qualité, dont l’huile de palme n’est qu’un exemple parmi d’autres. Ce modèle a largement contribué à nous mener à la crise climatique et environnementale actuelle.
Les denrées alimentaires servent en outre régulièrement de monnaie d’échange pour des produits d’exportation à haute valeur ajoutée. Or il s’agit de produits vitaux, avec lesquels nous ne devons pas jouer. Dans des pays comme l’Indonésie, l’agriculture industrielle exportatrice remplace l’agriculture vivrière et met en danger la sécurité alimentaire. Le dumping écologique et social que les produits alimentaires exportés représentent ensuite dans les pays d’importation déséquilibre à son tour la production locale. Partout, c’est l’agriculture paysanne, familiale et durable qui est mise à mal.
L’accord de libre-échange avec l’Indonésie n’est qu’un début. Des discussions ont aussi lieu avec la Malaisie, également gros producteur d’huile de palme, avec les pays du Mercosur et leur viande aux hormones, et avec les Etats-Unis, qui souhaitent notamment favoriser l’exportation vers nos étals de leur poulet industriel traité au chlore. Est-ce vraiment ce modèle de développement économique que nous voulons pour notre pays, pour notre planète ?
En pleine crises climatique et environnementale, auxquelles s’ajoute la crise sanitaire, nous devons avoir le courage de repenser ce modèle. Les échanges économiques sont nécessaires, mais ils devraient, d’une part, être soumis à des exigences écologiques et sociales équitables et crédibles et, d’autre part, favoriser les marchés les plus proches. Ce sont de tels principes qu’une organisation comme l’OMC devrait s’attacher à promouvoir à l’échelle mondiale. Nous devons réduire les transports de marchandises sur de longues distances et miser partout sur des modes de production et de consommation responsables.
Car, plutôt que de libre-échange, tel qu’il est conçu dans l’accord avec l’Indonésie, nous avons urgemment besoin d’un commerce responsable. La responsabilité est l’autre face, indispensable et indissociable, trop souvent oubliée, de la liberté. Ce commerce responsable est la seule issue pour préserver notre planète, et la seule façon d’évoluer dans le cadre d’une véritable durabilité.