Disons-le d’emblée, la Suisse n’a pas de politique environnementale digne de ce nom. Remarquez que la Suisse ne fait pas exception, car, et le constat est terrible, c’est le cas de la 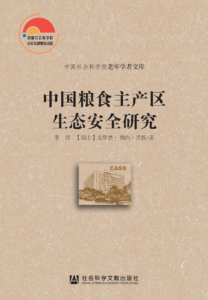 plupart des pays occidentaux que l’on dit “développés”. Comment en est-on arrivés-là n’est pas la question de ce billet, même si cette introspection sur nos politiques environnementales est indispensable et les réponses probablement fort instructives pour éviter de reconduire les mêmes erreurs.
plupart des pays occidentaux que l’on dit “développés”. Comment en est-on arrivés-là n’est pas la question de ce billet, même si cette introspection sur nos politiques environnementales est indispensable et les réponses probablement fort instructives pour éviter de reconduire les mêmes erreurs.
Sortir de l’ornière: Face aux urgences de toutes sortes (changement climatique, crise de la biodiversité, menaces sur la sécurité alimentaire, etc), la question qui se pose aujourd’hui est bien de trouver un moyen pour sortir de l’ornière. Et de manière fort inattendue, la solution pourrait venir de Chine. C’est du moins ce que laisse entendre un ouvrage de deux chercheurs, le Prof. Li Zhou de l’Académie Chinoise des Sciences Agricoles et le Suisse Claude Heimo, ingénieur forestier et ancien diplomate auprès de la FAO. Le livre, intitulé “Recherche sur la Sécurité Écologique des principales zones de production céréalière de la Chine” est publié aux éditions Social Sciences Academic Press (China), ISBN 978-7-5201-8776-3, en édition bilingue, chinois et anglais. (suite…)
