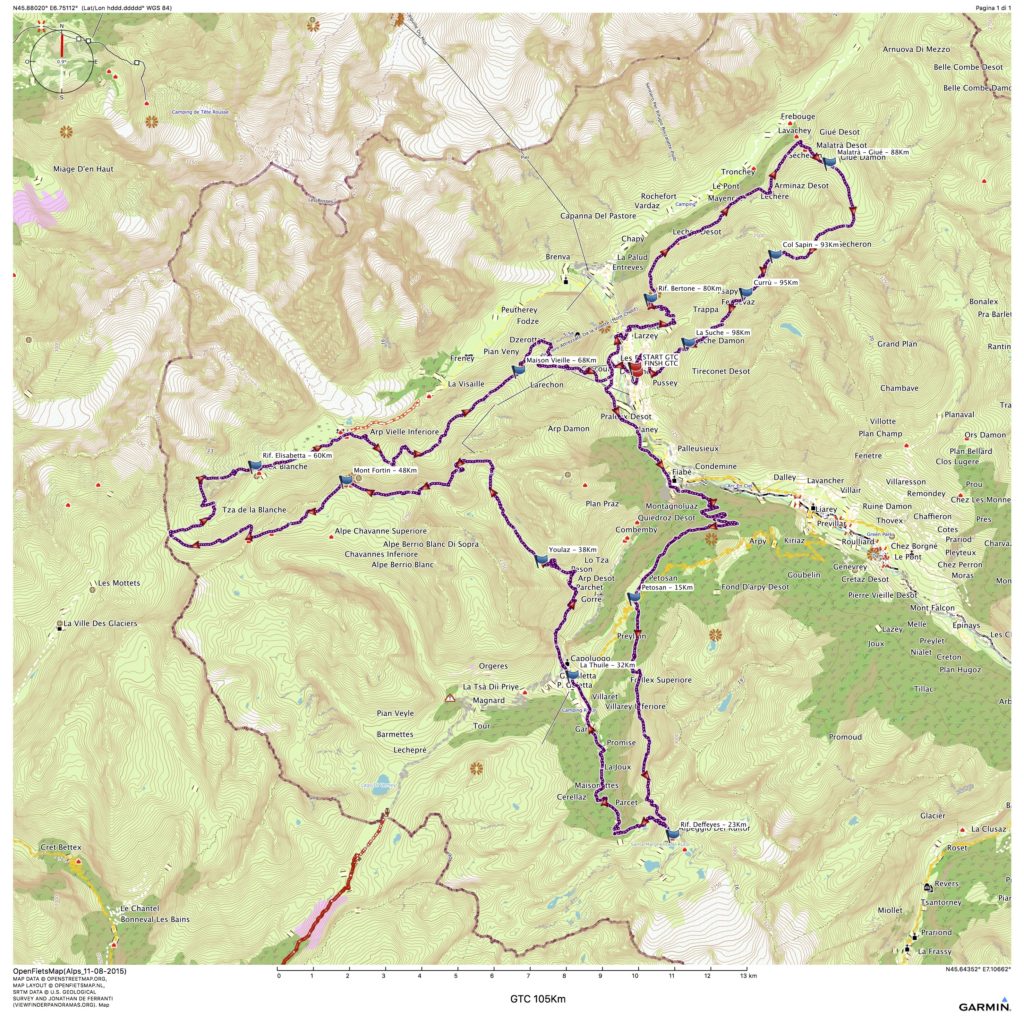Rarement une course ne m’aura essoré comme cet Eiger Ultra Trail. Sur le papier, avec 51 kilomètres pour un dénivelé positif (et négatif) de 3000 mètres, la course n’était pourtant pas particulièrement impressionnante. Si j’ai terminé avec un temps satisfaisant (7 h 30), je suis tombé malade comme rarement quelques heures après avoir franchi l’arrivée. S’en sont suivis trois jours de fièvre et de délire qui m’ont fait me repasser ces quelques heures d’effort en boucle dans ma tête jusqu’à la nausée.
Mais revenons en arrière. Tout a plutôt bien commencé, hormis le fait que durant la semaine qui a précédé, de fortes précipitations ont lessivé les sols et fait rimer pâturages avec marécages. Arrivé à Grindelwald vendredi 16 juillet, j’ai pu profiter de récupérer tranquillement mon dossard et de faire mes préparatifs en vue du départ prévu le lendemain matin à 6 heures. Comme il a plu jusqu’au soir, j’ai renoncé à mon traditionnel petit footing d’acclimatation pré-course pour me concentrer sur le repos.
Je trouve cette station des Alpes bernoises dépourvue de tout charme et sans aucun intérêt urbanistique, mais la présence de l’Eiger est si forte qu’elle relègue tout le reste au second plan. On n’a d’yeux que pour lui, l’Ogre. Passionné d’alpinisme et d’histoire, j’ai lu d’innombrables récits relatant les expéditions souvent dramatiques qui se sont jouées dans sa terrible face nord. Depuis le balcon de ma chambre d’hôtel, j’ai longtemps observé la montagne drapée dans des voiles de brume jusqu’à ce que le soir apporte une accalmie et qu’elle apparaisse enfin, nimbée de toute son austère majesté.

Le réveil était programmé pour sonner à 4 h 30 mais j’étais debout avant déjà. On ne dort jamais très bien la veille d’une course. Le sommeil est léger. On s’endort, on se réveille, on regarde la montre, on se rendort… Partenaire de l’événement, l’hôtel où je suis descendu a mobilisé du personnel dès cette heure extrêmement matinale pour servir les coureurs que j’ai retrouvés dans la salle du petit-déjeuner, silencieux et tendus.
J’ai mangé un peu de müsli et une tartine au miel en buvant un café, puis un deuxième. Une collation assez frugale mais je n’avais pas beaucoup d’appétit et j’ai préféré ne pas me forcer. Mon sac était prêt et à 5 h 45, j’étais dehors, admirant l’Eiger encore voilé de bleu. Avec d’autres coureurs, j’ai marché en direction du départ, situé sur la place principale de Grindelwald. Des centaines d’athlètes venus pour certains de loin patientaient en écoutant le speaker donner quelques ultimes instructions avant le départ.
“Les sentiers sont vraiment trempés et n’ont pas eu le temps de sécher. Soyez extrêmement prudents tout au long de la course !”
3, 2, 1… Boum ! Silencieusement, notre masse mouvante de coureurs a filé à travers le centre de Grindelwald peuplé de nombreux spectateurs malgré l’heure matinale. En moins de cinq minutes, nous étions sur les sentiers avec comme première montée en vue la Grosse Scheidegg, bien connue des cyclistes qui considèrent ce col comme l’un des plus beaux des Alpes. Le brouillard nous est vite retombé dessus et nous n’avons pas tellement pu profiter du panorama. Chacun dans sa bulle, nous avons gravi le plus rapidement possible les quasi 1000 mètres de dénivelé.
Au ravitaillement, j’ai attrapé une barre énergétique, rempli mes flasques avec de l’eau et je suis reparti en trottinant dans une section très roulante du parcours jusqu’à First. Je me réjouissais de découvrir une attraction promettant son lot de vues à couper le souffle, le Tissot Cliff Walk, une passerelle accrochée à même la falaise façon James Bond. Hélas, le brouillard est devenu encore plus dense lorsque j’y suis passé et je n’ai franchement pas pu admirer grand chose…
Tant pis et surtout pas le temps pour les regrets. Je suis reparti aussi vite que je suis arrivé et cette fois, le soleil a enfin réussi à percer les nuages. J’ai vraiment dû faire un effort pour me dominer et regarder un peu le sentier sinon j’aurais sans doute fini étalé par terre. La vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau était véritablement renversante alors que je courais vers le ravitaillement de Bussalp, au km 21.

Une petite section technique de blocs et de pierriers instables a fini de me convaincre de me concentrer sur mes pieds. Nous avons contourné la montagne et attaqué la montée vers le Faulhorn, point culminant du parcours, à quasi 2700 mètres. Je suis toujours le premier surpris de voir à quelle vitesse la course se transforme à mesure qu’on progresse. J’en avais une nouvelle fois la preuve en me hâtant vers le sommet qui marquait aussi la mi-course. Le vent s’est levé et il a commencé à pleuvoir légèrement.
Arrivé en haut, j’ai regardé la montre qui marquait 10 heures. Je me suis hâté d’avaler un bouillon et le sandwich que j’avais préparé avant de quitter l’hôtel. Dans l’effort, les barres et autres aliments sucrés sont vite écoeurants. Quel dommage que les organisateurs fassent si rarement l’effort de préparer autre chose que les sempiternelles bananes, quartiers d’orange, barres énergétiques, carrés de chocolat, coca et boisson isonotonique…
J’ai filé sans demander mon reste avec la Schynige Platte en ligne de mire. Un autre haut-lieu touristique que ce charmant jardin alpin que l’on atteint en montant à bord d’un train d’époque à Interlaken. Mais cette fois, je n’étais pas là pour admirer les fleurs et je commençais à me réjouir de boucler la boucle. Après plusieurs montées-descentes, nous y sommes enfin arrivés. Une mention spéciale tout de même pour le sentier qui semblait à cet endroit suspendu entre terre et ciel, avec une vue plongeante de toute beauté sur le lac de Brienz et ses eaux turquoises, 1500 mètres plus bas.

De là, il n’y avait plus qu’à se laisser descendre. Facile à dire quand on a les jambes entamées par 35 kilomètres de course et près de 3000 mètres de dénivelé positif avalés en moins de 5 heures… Je me suis quand même lancé dans la pente avec l’impression de descendre dans une fournaise à mesure que je perdais de l’altitude. La chaleur et l’humidité rendaient cette dernière partie vraiment éprouvante. Mais le plus dur était à venir.
Si la traversée des pâturages détrempés où le pied s’enfonçait parfois jusqu’à la cheville était pénible, les quelques kilomètres restants à travers la forêt tenaient véritablement du parcours du combattant. Racines, cailloux, tout concourait à faire perdre du temps, obligeant à la plus grande vigilance. J’ai glissé plusieurs fois sans jamais tomber, heureusement. Hormis trois ou quatre coureurs qui m’ont dépassé, j’ai réussi à tenir mon rythme jusqu’à sortir de cet enfer et arriver en un seul morceau à Burglauenen, dernier ravitaillement avant l’arrivée.
Plus écoeuré que jamais, j’ai seulement bu un peu de thé sucré et je suis reparti. J’ai fait les 7 km qui me séparaient de Grindelwald en mode pilote automatique, m’interdisant de marcher malgré la tentation. J’ai dépassé plusieurs coureurs et continué à avancer à un rythme de 12 km/h. A cette allure, les kilomètres défilent rapidement et bientôt, je suis passé sous la barre des 5 puis des 3 kilomètres, une paille.
J’ai passé la station de Grindelwald Terminal et arrêté de courir au pied de la dernière rampe menant de la plaine au village, 200 mètres plus haut. J’ai gravi cette montée en poussant aussi fort que je pouvais sur mes cuisses et recommencé à accélérer à peine j’ai pu. Je me suis retrouvé comme parachuté dans la rue principale, n’en revenant pas d’être enfin de retour. J’ai accéléré autant que mes jambes en feu me le permettaient pour franchir la ligne d’arrivée en 7 heures, 30 minutes et 22 secondes, soit 106e sur les 766 coureurs partis ce matin.

J’étais très heureux de ce temps mais j’étais dans le même temps très fatigué. Je me suis couché un moment sur le bitume chaud, savourant la liberté de pouvoir enfin m’arrêter. J’ai regardé encore mon magnifique trophée, un caillou en guise de médaille qui souligne bien le caractère alpin de cette course. Péniblement, je me suis traîné vers mon hôtel pour prendre une douche. Après un repas sans intérêt pris le regard béatement perdu dans le vide, j’ai repris le train pour Genève où je suis arrivé juste au moment où j’étais pris par les premiers frissons annonciateurs de la dégradation de mon état.
Les trois nuits et les trois jours qui ont suivi ont passé comme dans un mauvais rêve, entre forte fièvre et nausées. Je n’ai quasiment rien pu avaler et perdu beaucoup de mes forces. Je ne saurai jamais ce que j’ai attrapé, même si la fatigue, la déshydratation et le manque de calories absorbées pendant le course ont certainement joué un rôle. Peut-être que j’ai bu une eau infectée par une bactérie, ou alors c’était tout autre chose… En tout cas, je me souviendrai longtemps de cet Eiger Ultra Trail. Même si j’ai toujours tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre, je suis bien content que cette année, l’épreuve à laquelle je devais participer, longue de 101 km, a été annulée pour raisons sanitaires…