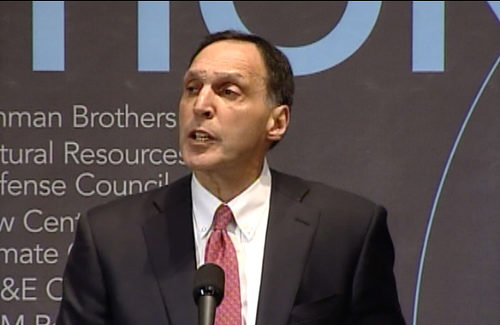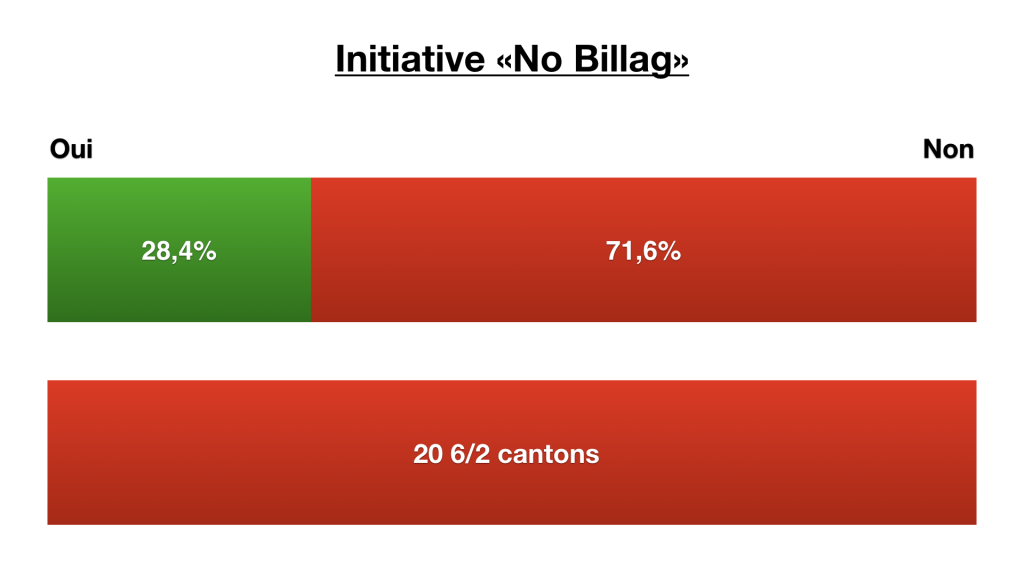Une nouvelle initiative parlementaire propose «la gratuité des transports publics» dans le canton de Vaud. L’idée est presqu’un marronnier, tant elle fleurit régulièrement dans la presse et les organes politiques. Mais elle est, surtout, le fruit d’un terrible malentendu savamment entretenu.
Une chose gratuite est une chose que l’on ne paie pas, ni directement, ni indirectement. Cette stricte définition peut sembler une évidence. Mais dès que le mot «gratuit» est lâché en politique, il devrait être soumis à un strict examen pour s’assurer de sa signification concrète et réelle. Et, bien souvent, ce mot ne saurait être plus éloigné de la réalité…

Ainsi, pour que les transports publics soient gratuits, il conviendrait donc que leurs conducteurs aient la gentillesse de venir bénévolement, nuit et jour, aux commandes de véhicules qu’ils auraient eux-mêmes acheté avec leurs propres deniers et dont ils supportent à leurs propres frais l’entretien et l’opération. Qu’il me soit permis de douter que cela se produise un jour. Et, en fait, nul ne l’imagine ni ne le réclame réellement.
Ce que proposent les promoteurs de la «gratuité des transports publics» n’a en fait rien à voir avec la gratuité. Il s’agirait simplement d’éviter que l’usager ne paie directement le prix de sa mobilité. Ainsi, le mot «gratuit» signifie véritablement dans cette initiative «payé autrement». Ce malentendu nuisant au débat s’amplifie même lorsque certains populistes tentent même de le faire rimer avec «payé par quelqu’un d’autre». Après tout, comme le disait Margaret Thatcher, le problème de certaines politiques est que finalement, elles viennent à bout de l’argent des autres.

Si l’on voulait donc être honnête, on ne parlerait non pas de gratuité des transports publics, mais plus simplement de la répartition de la facture entre l’usager, directement servi, et la collectivité, bénéficiant indirectement en termes d’environnement, de trafic ou d’aménagement du territoire. Et à ce moment-là, il conviendrait de rappel qu’aujourd’hui déjà, l’usager des transports publics ne prend en charge en moyenne qu’environ 44% de leur coût. Plus de la moitié, donc, est issu de l’argent des contribuables, quels que soient leurs déplacements.
Faudrait-il supprimer totalement la contribution de l’usager au coût de son propre mobilité ? Je ne le pense pas, mais c’est un débat qui mériterait d’être posé en termes honnêtes. Car à vendre le mirage de la gratuité, on ment au citoyen croyant économiser ce qu’il devra, in fine, payer indirectement. Ce serait là un bien coûteux malentendu…