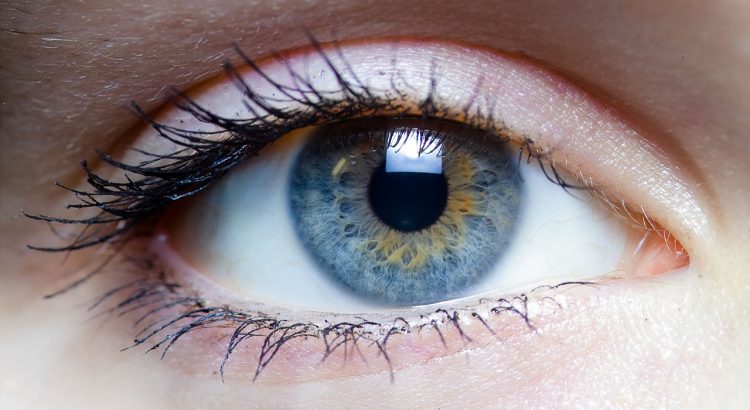La majorité du parlement réunie derrière David Cameron – analyse d'une élection inattendue
Le 7 mai, le peuple britannique s’est rendu aux urnes. L’enjeu était capital : il s’agissait de renouveler intégralement la Chambre des Communes et, indirectement, désigner le Premier Ministre qui allait présider aux destinées du Royaume-Uni. La campagne fut animée par le débat sur l’austérité et le retour à l’équilibre budgétaire, mais aussi par l’éternelle question de l’indépendance écossaise, véritable serpent de mer de la politique outre-Manche. En outre, le rôle des petits partis fait toujours débat dans un pays habitué aux majorités claires.
Mais à la surprise générale, les Conservateurs de David Cameron ont obtenu, seuls, la majorité à la Chambre des Communes – leur permettant ainsi de gouverner seuls, sans avoir à satisfaire des alliés plus ou moins récalcitrants. Le Premier Ministre est ainsi, selon ses propres mots, à la tête d’un gouvernement davantage responsable, puisqu’il mène la politique qu’il décide, sans compromis, et donc sans bouc émissaire. Mais avant de voir comment cela se concrétisera à l’avenir, ces élections peuvent nous apporter quelques leçons.
La question des sondages
Alors que tous prédisaient un parlement déchiré et désuni, où les coalitions seraient difficiles à établir et plus encore à maintenir, les Conservateurs ont obtenu, seuls, une majorité claire. Impossible, alors, d’ignorer la question des sondages – et les fortes critiques qui se sont abattues sur les divers instituts dès la fin du scrutin. Mais, en réalité, les torts sont partagés.
Pour mieux comprendre, intéressons-nous aux deux résultats des sondages : la répartition des votes, et celle des élus.


Si l’on prend la dernière vague de sondages (publiés début mai), on voit très clairement que les prédictions en terme de voix sont relativement précises. Mais hélas, ce furent rarement ces sondages qui firent les titres de la presse.
Mais le Royaume-Uni ne connait pas le scrutin proportionnel. Le pays est donc découpé en 650 circonscriptions qui, chacune, enverront un parlementaire à Westminster. Plus encore, le système britannique prévoit l’élection en un seul tour. Autrement dit, le candidat qui reçoit le plus de voix dans une circonscription est élu – quand bien même il ne représenterait qu’une part réduite des citoyens. La clé n’est donc pas tant la popularité d’un parti au sein de la population, mais bel et bien la situation géographique de ses sympathisants. Ainsi, avec 36.9% des électeurs, les Conservateurs auraient pu obtenir l’intégralité des sièges (si le profil de l’ensemble des circonscriptions était identique, par exemple) ou strictement aucun.

Or, c’est cet élément – la situation géographique des électeurs – qui est impossible à estimer dans un sondage établi sur quelques milliers de participants. Obtenir davantage de précision quant au nombre d’élu nécessiterait des sondages par circonscription – et donc davantage de moyens. Si cette option est réalisable le jour du scrutin à la sortie des bureaux de vote (où les instituts placent des sondeurs dans quelques circonscriptions-clés et infèrent des résultats pour l’ensemble du pays), elle n’est pas vraiment réalisable de façon anticipée. Ainsi, l’erreur ne se trouve probablement pas tant dans les sondages eux-mêmes que dans les conclusions erronées que certains ont pu en tirer.
Le système électoral
Mais il est impossible de parler de la différence entre la répartition des voix et celle des élus sans s’interroger sur le système lui-même. 650 circonscriptions appliquant le scrutin majoritaire uninominal à un seul tour sont-elles capables de représenter l’ensemble des citoyens ? Nigel Farage en doutait peu après son échec électoral, relevant que des millions d’électeurs sont ainsi ignorés. En effet, près de 3.9 millions de britanniques ont glissé un bulletin UKIP dans les urnes. Mais seuls les 19’642 de Clacton ont été utiles à l’élection d’un parlementaire ; le reste aurait pu rester à la maison sans que le résultat ne change…

En comparant les résultats du vote populaire et la composition des chambres basses des parlements, on peut ainsi observer les écarts entre volonté des électeurs et résultats finaux. Sans surprise, les pays pratiquant l’élection par circonscription (Royaume-Uni, mais également États-Unis et France) sont ceux où les divergences sont les plus importantes. À l’inverse, les systèmes suisses et allemands sont relativement fidèles – même si les quorums nécessaires peuvent parfois exclure les petits partis, donnant ainsi une représentation plus favorable aux plus grands. C’est notamment le cas en Allemagne à la suite de l’exclusion des libéraux du FDP. Enfin, le cas de l’Italie est particulier. Le pays utilise certes le scrutin proportionnel, mais le biaise pour assurer une majorité des sièges à la coalition en tête – au détriment des autres partis.
De manière générale, le découpage en de nombreuses circonscriptions électorales est souvent l’héritage du passé – à l’époque ou organiser un scrutin à grande échelle était généralement impossible. Mais aujourd’hui, force est de constater à quel point ce système est démocratiquement douteux.
Les coalitions au pouvoir
Les grands perdants des élections britanniques sont, sans nul doute, les Libéraux-Démocrates menés par Nick Clegg. Avec 57 parlementaires, ils étaient des alliés nécessaires pour les Conservateurs de David Cameron, incapables d’obtenir la majorité à eux seuls. Forts de ce rôle, ils ont fait campagne dans le but de maintenir cette position : leur slogan électoral étant l’idée de donner un coeur à un gouvernement conservateur et un cerveau à un gouvernement travailliste.

(© Liberal Democrats)
Mais les citoyens n’en ont pas voulu ainsi. Près de deux tiers des électeurs des «LibDems» se sont tournés vers d’autres candidats et seuls 8 parlementaires ont réussi à se maintenir à la Chambre des Communes. Cette situation n’est d’ailleurs pas sans en rappeler une autre, à peine deux ans auparavant.

En Allemagne en 2013 comme au Royaume-Uni en 2015, les libéraux (FDP ou Libéraux-Démocrates respectivement) sont les alliés minoritaires des conservateurs de droite au pouvoir. Cette position d’alliés nécessaires leur donne certes un poids bien supérieur à ce qu’ils pourraient espérer seuls. Mais, forcés d’assumer un bilan politique essentiellement décidé par leurs partenaires, ces partis sont souvent désavoués par leurs électeurs lors des prochaines échéances. Préférant sans doute l’original à la copie, c’est bien au leader de ces coalitions que les citoyens choisissent de donner leurs voix. Ainsi, quels que soient les résultats de l’opposition de gauche, lorsqu’ils sont partenaires minoritaires des conservateurs, les libéraux perdent la majeure partie de leur électorat au profit de leurs alliés.
Les responsabilités


(© Ed Miliband & © Liberal Democrats)
Alors que le dépouillement n’était même pas encore terminé, face à leurs échecs respectifs, les leaders travaillistes et libéraux-démocrates, Ed Miliband et Nick Clegg, présenté leur démission. Bien qu’eux-mêmes réélus, ils ont tous deux, séparément, annoncés qu’ils assumaient personnellement la responsabilité des résultats et qu’ainsi, de nouveaux leaders étaient nécessaires à leurs partis. Tous deux ont remercié ceux qui s’étaient engagés à leurs côtés dans cette campagne et ont réaffirmé leurs convictions en leurs idées. Mais ce seront désormais d’autres qui prendront la tête de leurs formations.

(© Gage Skidmore)
À l’inverse, Nigel Farage a présenté sa démission sous un jour très différent. S’annonçant soulagé d’un grand poids à la fin de cette longue et éprouvante campagne, le leader du UKIP s’est lancé dans une critique (certainement justifiée, voir ci-dessus) contre le système électoral. Fidèle à sa promesse, il a également annoncé qu’il quittait la tête de son parti. Mais, moins catégorique que ses deux homologues, il a affirmé qu’il pourrait se présenter à sa propre succession lors des élections internes à son parti en septembre. C’est certes un changement majeur pour Nigel Farage, mais il pourrait n’être que temporaire. Le leader indépendantiste s’est conservé une perspective de retour – quand bien même il avait écrit en mars qu’il ne serait pas crédible pour un absent de la Chambre des Communes de diriger ce parti…


(© David Cameron & © SNP)
Enfin, les grands gagnants sont, sans nul doute, David Cameron lui-même, maintenu et même renforcé à son poste de Premier Ministre, et Nicola Sturgeon. Cette dernière avait accédé à la tête du parti indépendantiste écossais (le SNP) après la démission d’Alex Salmond à la suite de son échec lors du référendum pour l’indépendance de cette nation constitutive du Royaume-Uni. Mais bien que victorieuse, elle ne siègera pas à Westminster. Menant le parti majoritaire au parlement local, elle occupe le poste de Premier Ministre d’Écosse.
Ces changements à la tête des principaux partis sont loin d’être anecdotiques. En cas de victoire électorale, ce sont eux qui sont destinés à occuper les premières places. Et leur désignation n’a rien d’un vote interne symbolique – on oublie trop souvent que c’est un scrutin interne qui a expulsé Margaret Thatcher du 10 Downing Street…