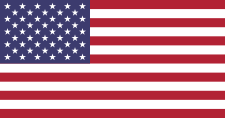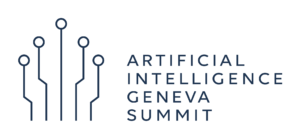Un suspense insoutenable, un président en exercice qui oublie sa défaite dans l’ivresse sportive d’un 18 trous, un (désormais) président élu qui voit ses facultés parfois le trahir, des accusations de fraude électorale, des fake news réelles ou alléguées : l’élection américaine a dépassé les exigences pourtant déjà élevées de la fiction contemporaine.
Dans ce contexte parfaitement inhabituel, certaines télévisions américaines (CBS, MSNBC et ABC News, notamment), drapées dans la cape d’apparente d’invincibilité que leur offrait un Président dont tout démontrait qu’il courait à sa perte, ont pris le parti de le couper au beau milieu de son discours. Une première.
Certains médias en ont même rajouté dans une surenchère somme toute dérangeante : ainsi, sur CNN, le journaliste Anderson Cooper a-t-il déclaré : « Voici le président des Etats-Unis. Voici la personne la plus puissante du monde. Il nous apparaît comme une tortue obèse renversée sur le dos, qui se débat sous le soleil brûlant et qui comprend que son heure est venue ». Avant de s’en excuser platement, de façon embarrassée et, à vrai dire, tout à fait embarrassante.
Sur Twitter, de très nombreux tweets du président ont été occultés et accompagnés d’avertissements divers prévenant les internautes qu’ils risquaient de lire des informations qui n’étaient pas vérifiées ou avérées.
Un concert de louanges s’en est ensuivi sur le courage de la presse, son discernement et la lutte efficace des médias sociaux contre les fake news. Enfin, le retour de la grande presse, du chien de garde de la démocratie!
A voir.
Si l’outrance et l’irrespect dont Donald Trump a fait preuve, depuis le début de son mandat, dans ses relations avec les médias, est évidemment un terreau fertile pour ce type de réaction, il faut à mon sens raison garder et analyser, sans passion mais avec un pas de recul, la réaction des télévisions et médias sociaux américains.
Était-il légitime de couper le président américain en plein discours ? A l’évidence non. La forme est inutilement vexatoire et trahit avant tout l’enthousiasme excessif de la presse américaine à un changement d’administration. Plus grave, le fond trahit les dérives particulièrement inquiétantes d’une certaine presse contemporaine et confine à la censure. Peu importe le nombre d’approximations, d’erreurs ou même peut-être de mensonges délibérés que contenait ce discours. Là n’est pas la question : il fallait le laisser s’exprimer, puis analyser, décortiquer, dénoncer. Mais laisser le Président s’exprimer.
La liberté d’expression, nous dit la révérée Cour européenne des droits de l’homme dans un Arrêt du 7 décembre 1976, vaut également pour les idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent ». Même si ces idées émanent d’un homme à la mèche jaune et au teint orangé.
La réaction de Twitter n’est pas plus belle à voir : que comprendre de ses avertissements sous les messages de Donald Trump ? Que tous les autres messages d’hommes politiques sont vrais et vérifiés ? Que les médias sociaux labellisent désormais l’information ? Ce n’est pas une boîte de Pandore, c’est la rupture sans sommation de la Grande-Dixence. Les plateformes sociales, initialement considérées comme de simples passe-plats ou hébergeur de contenus dans le lexique consacré, se piquent désormais, et de façon croissante, de scruter le contenu, de le labelliser, de l’occulter, de l’accompagner d’avertissements. Elles jouent, de fait, le rôle d’un éditeur et devraient se voir appliquer les droits mais, aussi et surtout, les responsabilités qui vont avec.
Et rappelons que les opinions, par définition exemptes de toute véracité/fausseté, se logent immanquablement dans des déclarations factuelles. Censurer des faits, c’est aussi réduire au silence des opinions.
Nous avons longtemps subi les affres de la censure étatique. Veut-on véritablement confier désormais à des privés, par nature soumis à des influences, le rôle de trier ce que le bon peuple peut ou non lire ou entendre ? Ne devrait-on pas se limiter à saisir la justice étatique lorsque les bornes (existantes) de la liberté d’expression sont franchies ?
La réponse à cette question dépend de l’ordre de priorité que l’on accorde à deux concepts qui sont l’huile et l’eau de nos démocraties : l’hygiénisme et la tolérance à ce qui nous dérange.
Sur cette problématique, lire aussi l’excellent billet de Anouch Seydtaghia.