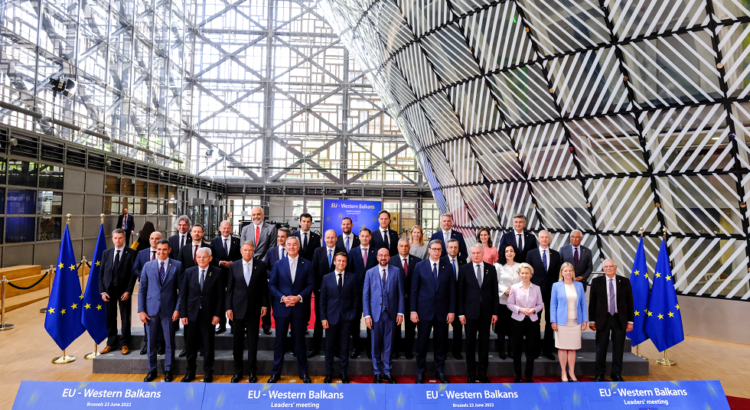Lorsqu’il est question de la gauche, du socialisme ou même de la social-démocratie dans les Balkans occidentaux et en particulier dans l’espace « post-yougoslave », deux narratifs complémentaires s’imposent en général : d’une part, la « gauche » yougoslave est simplement (et de manière simpliste) confondue avec la dictature communiste de Josip Broz Tito, lui-même associé autant que faire se peut par les élites politiques aujourd’hui au pouvoir avec le stalinisme ou le communisme soviétique; d’autre part, on considère que les idées « de gauche » auraient dépéri et seraient sans perspectives dans les actuels Balkans occidentaux, du fait de l’hégémonie des partis ethno-nationalistes sur la scène politique. Pourtant, ces deux narratifs, que leur logique explicative simple rend tentants, sont aussi simplistes qu’infondés. Rectificatif.
La Yougoslavie socialiste : négocier en dedans, contester par le bas
Deux points sont cruciaux concernant la Yougoslavie socialiste, pour la période qui va de 1945 à 1991.
Premièrement, bien que le Parti – puis la Ligue – communiste soit presque immédiatement devenu le seul parti autorisé dans le pays après la Seconde Guerre mondiale, celui-ci ne peut de loin pas être confondu avec un quelconque bloc monolithique sur toute la durée de son existence. Loin s’en faut : si la direction du parti n’autorise aucune déviation de la ligne stalinienne dans les premières années d’après-guerre, la « Ligue des Communistes de Yougoslavie » (re-fondée ainsi en 1952) va progressivement se « libéraliser » (relativement, s’entend) à la suite de la brutale rupture avec l’Union soviétique en 1948 et surtout après la chute en 1968 du très autoritaire Ministre de l’Intérieur et Directeur de la police politique (OZNa puis UDBa) Aleksandar Ranković. En attestent non seulement la décentralisation progressive du système politique et économique, avec l’introduction du principe d’autogestion (de façade), mais également la transformation de la Ligue en regroupement de tendances divergentes, souvent synthétisées par l’opposition entre « conservateurs » et « libéraux », et qui incluent également des tendances que l’on pourrait qualifier de proto-néolibérales. Alors que le mot de la fin en termes d’orientation politique générale revient encore et toujours le plus souvent au Président à vie Josip Broz Tito, celui-ci semble selon les archives avoir changé régulièrement et souvent de manière radicale ses positions, accordant son soutien aux différentes factions non seulement par conviction et en fonction de situations particulières, mais également dans une tentative d’équilibrer les jeux de pouvoir entre les différentes tendances idéologiques.
Deuxièmement, bien que les organisations et mouvements de la société civile étaient systématiquement harcelés et réprimés par le régime titiste, on ne peut de loin pas qualifier la Yougoslavie de « société incivile » (uncivil society), selon la fameuse expression de Peter Kotkin et Tomasz Gross : de nombreux intellectuels et surtout intellectuelles ou mouvements sociaux, opérant principalement hors des institutions officielles et à travers des réseaux peu ou vaguement organisés, ont ainsi négocié, problématisé voire contesté les structures et relations de pouvoir ainsi que leurs principes de légitimation. Ceci non seulement d’un point de vue nationaliste, comme aime à l’affirmer et rappeler une certaine historiographie nationale ou nationaliste contemporaine, mais surtout « depuis la gauche ». A en croire le philosophe slovène Rastko Močnik, ces « alternatives », qui n’étaient d’ailleurs pas toujours en opposition totale au régime mais cherchaient à être des forces de propositions sur des points-clés, étaient d’ailleurs le plus souvent très ancrées dans la défense de l’idéologie dont se revendique alors le pouvoir titiste. Trois exemples ont ainsi été particulièrement mis en lumière par la recherche historienne dans la dernière décennie.
Premier exemple, les mouvements étudiants de 1968 – trop souvent éclipsés par le « Printemps croate” de 1971 par les historiographies ethno-nationales – qui n’appellent pas à moins mais bien au contraire à « plus de communisme » (sic) ainsi qu’à la mise en place d’un véritable système d’autogestion ouvrière, principe de légitimation central du régime communiste yougoslave. Ces mouvements, qui faisaient largement écho aux manifestations qui ont embrasé le monde au printemps 1968, furent d’un côté violemment réprimés par le régime communiste, de l’autre partiellement récupérés par la mise en place de (très modestes) réformes.

Le deuxième exemple est celui du groupe Praxis fondé en 1964 autour de la revue éponyme et d’une école d’été sur l’île adriatique de Korčula en actuelle Croatie, qui réunit un nombre important d’intellectuels non seulement yougoslaves mais également du monde entier à l’instar de Jürgen Habermas, Herbert Marcuse ou encore Henri Lefebvre. Critique à la fois du capitalisme occidental, du communisme soviétique mais surtout du socialisme yougoslave, la revue fut bannie à de multiples reprises avant qu’un terme soit définitivement mis à son activité en 1974. Comme Gerson Sher le suggère dans son étude sur le groupe Praxis, son « rôle particulier consistait à une confrontation sans répit de la pratique yougoslave avec les idées socialistes générées dans le processus de changement social qui n’a jamais cessé en Yougoslavie. »
Le troisième exemple a été récemment rappelé et brillamment analysé par l’historienne Zsofia Lóránd dans une récente monographie sur la contestation féministe à l’encontre du régime communiste. Celle-ci fut particulièrement forte dans les deux dernières décennies yougoslaves, une période trop souvent associée par l’historiographie contemporaine à une montée homogène voire monolithique et fataliste des nationalismes: à partir des années 1970, en effet, des intellectuelles et militantes féministes de tout l’espace yougoslave – souvent proches, bien que très critiques, du groupe Praxis pour ses travers sexistes – développent une critique de la gestion de la « question féminine » (sic: žensko pitanje) par l’État yougoslave à travers une série de revues et de conférences, tout d’abord très informellement avant de progressivement s’institutionnaliser en organisations formelles et revues. De nombreuses autrices féministes contemporaines ont ainsi fait leurs armes auprès de ces mouvements, telles Slavenka Drakulić ou Dubravka Ugrešić, plus tard persécutées par les régimes autoritaires de leurs pays respectifs durant les années 1990.
Ces trois exemples, s’ils ont gagné en visibilité ces dernières années, ne sont évidemment pas les seuls cas d’alternatives ou d’opposition venant de la société civile : on ne saurait évidemment laisser pour compte l’opposition nationale voire nationaliste, souvent coordonnée à partir de la diaspora émigrée en particulier dès 1945, ou encore l’existence d’un réseau culturel underground extrêmement développé et très populaire, souvent proche d’un communisme radical, de l’anarchisme, ou plus généralement du mouvement punk au niveau international. Ces cas feront peut-être l’objet d’un futur article de notre part.
L’opposition de gauche après le socialisme : de l’underground aux institutions
Que sont devenus ces mouvements hétéroclites à partir des années 1990 ? Certains affirment qu’ils auraient dépéri avec l’État commun yougoslave. Pourtant, si les mouvements socialistes et plus largement contestataires ont été à nouveau fortement soumis à la répression dans les nouveaux régimes nationalistes-autoritaires, en particulier en Croatie et en Serbie, ils ont trouvé refuge dans la culture underground. Les exemples les plus connus sont ceux du très populaire (et regretté) hebdomadaire satirique Feral Tribune en Croatie – l’autoproclamé « hebdomadaire des anarchistes, protestants, et hérétiques » – ainsi que le plus académique « Cercle de Belgrade » et ses quelques publications, telle L’Autre Serbie (Druga Srbija). Qui plus est, comme le démontre le sociologue Eric Gordy dans une monographie culte, malgré la destruction des liens transnationaux institutionnels entre les différents pays dont elle dépend et la répression qu’elle subit du régime, la scène rock belgradoise réussit à rester une actrice contestataire majeure du régime autoritaire de Slobodan Milošević. Enfin, comme l’a noté Gordana P. Crnković, les cultures contestataires et transnationales, quand bien même underground, ont su rester présentes à différents degrés dans les habitudes culturelles de nombreux ex-yougoslaves.

La chute des régimes autoritaires de Franjo Tuđman et Slobodan Milošević en l’an 2000 semble devoir donner un nouveau souffle à la gauche. Pourtant, les partis clés identifiés à l’idéologie socialiste ou sociale-démocrate ont principalement promu un agenda par trop similaire à celui des régimes ultra-nationalistes et autoritaires déchus. Durant les années 2000, et plus particulièrement durant les années 2010, la gauche radicale et l’extrême-gauche trouvèrent à nouveau un « refuge » pour croître dans les mouvements spontanés de la société civile, dans les manifestations, ou de manière plus générale dans les organisations actives au sein de la société civile. Les récentes grèves provoqués par les tentatives des gouvernements successifs de « libéraliser » la législation du travail dans les États post-yougoslaves (voir notre article sur ce sujet concernant la Croatie ici) ou de privatiser des entreprises clés sont un indicateur intéressant de la persistance de certaines idées liées à l’époque socialiste au sein de ces sociétés. Ainsi, en Croatie, ces contestations ont pris la forme de manifestations alliant agriculteurs et étudiants suivies de la création de plénums en 2010, d’une grève générale de deux heures en 2014 ou de grèves massives des enseignants en 2019. En Serbie, l’organisation des salariés et les grèves entre 2003 et 2007 ont mené à l’annulation de la privatisation de Jugoremedija et au « retour » de cette entreprise dans les mains de ses salariés. La Bosnie-Herzégovine, si souvent présentée comme le royaume des ethnocrates et de la ségrégation ethnique, a également été secouée par d’importants mouvements trans-ethniques de plénums et d’expériences de démocratie directe en 2014, en particulier à Tuzla mais également dans d’autres villes majeures comme Mostar ou Banja Luka. Un an plus tôt, en 2013, d’importantes manifestations anti-gouvernementales qui s’opposaient aux divisions ethniques avaient créé la sensation, recevant le surnom de Bebolucija (« Révolution des bébés ») : ces manifestations contestaient le blocage administratif provoqué par les disputes de clergé des partis ethno-nationalistes suite auquel les nouveaux-nés ne pouvaient tout simplement plus recevoir leur numéro d’identité personnel. Enfin, pour ajouter à cette liste déjà longue, la lutte pour le maintien en mains publiques des communs en passe d’être privatisés et la protection de parcs et d’espaces verts au coeur des villes ont suscité un nombre important de mouvements civiques en tout genre et dans tous les États des Balkans occidentaux, souvent avec succès.

La plupart des ces mouvements sont nés d’un thème de débat particulier et n’ont généralement pas réussi à s’installer dans la durée (en particulier les plénums en Bosnie-Herzégovine), notamment du fait de l’absence de soutiens et relais politiques aux niveaux national comme international. Certains d’entre eux ont néanmoins réussi à s’institutionnaliser et à peser dans le jeu politique. C’est tout particulièrement le cas en Slovénie avec la « Gauche Unie » (Združena Levica, aujourd’hui Levica), un parti de gauche radicale né de l’alliance de mouvements de la société civile s’opposant d’abord au gouvernement de Janez Janša et siégeant aujourd’hui dans le gouvernement de centre-gauche de Robert Golob. En Croatie, Možemo! (Nous pouvons!), fondé à partir de mouvements écologistes d’opposition citoyenne contre le mayorat controversé de Milan Bandić à Zagreb, occupe aujourd’hui pas loin de la majorité des sièges de l’assemblée municipale de la capitale croate, ainsi que le poste du maire, tenu par Tomislav Tomašević (voir notre article à ce sujet ici). Au Kosovo, le parti arrivé au pouvoir en 2020, Vetëvendosje! (Autodétermination!), fondé et mené encore aujourd’hui par le militant radical devenu Premier Ministre Albin Kurti, a lui aussi réussi à se structurer à partir de mouvements de protestation civile et à gagner en popularité sur une ligne faite à la fois d’anti-corruption et de promesses d’extension de l’État-providence. Bien que tous ces partis aient récemment chuté dans les sondages ou au cours des dernières élections slovènes malgré leur forte popularité initiale, ils partagent tous un point commun assez inhabituel dans les Balkans occidentaux : leur origine et ancrage locaux, à partir de contestations développées par la base de la société, qui leur permet de maintenir une base politique forte ainsi qu’une certaine légitimité, contrairement à d’autres nouveaux venus ou « étoiles filantes » comme le Mouvement patriotique (Domovinski pokret, extrême-droite) en Croatie ou la Liste de Marjan Šarec (LMŠ, libéraux) en Slovénie.
Ainsi, si la mort brutale de la Yougoslavie socialiste et le dévoilement progressif des crimes perpétrés par le régime titiste ont été souvent instrumentalisés par les élites post-communistes pour discréditer toute idée liée de près ou de loin à la sociale-démocratie même la plus modérée, il est difficile de prétendre que la gauche post-yougoslave a véritablement « passé l’arme à gauche ». Elle est au contraire très vivante, le plus souvent sous le radar médiatique et à l’extérieur des institutions politiques et étatiques, et en particulier sous la forme de mouvements spontanés ou d’organisations de la société civile. Mais sa viabilité et le succès de ses politiques sur le long-terme restent pour le moins incertains.
Version étendue d’un article originellement écrit en anglais par l’auteur dans le cadre d’un projet non-abouti de revue universitaire au University College London. Remerciements à mon très cher ami Walter Kovač pour ses relectures attentives et son aide précieuse.
Pour aller plus loin :
Période yougoslave socialiste :
BOCKMANN, Johanna (2011), Markets in the Name of Socialism. The Left-Wing Origins of Neoliberalism (Stanford: Stanford University Press).
JOVIĆ, Dejan (2011), Yugoslavia. A State that Withered Away (West Lafayette: Purdue University Press).
KLASIĆ, Hrvoje (2012), Jugoslavija i svijet 1968. (Zagreb: Naklada Ljevak).
LORAND, Zsofia (2018) The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia (London: Palgrave MacMillan).
MERDŽANOVIĆ, Adis (2020), Liberalism in Yugoslavia: before and after the disintegration. In: Anastasakis, Othon, et al., (eds.), The Legacy of Yugoslavia. Politics, Economics and Society in the Modern Balkans (London: I.B. Tauris): 15-37.
MOČNIK, Rastko (2016), Što je značio izraz civilno društvo: jugoslavenska alternativa. In: Spisi o suvremenom kapitalizmu (Zagreb: Srpski Narodni Vijeć, Aktiv, Arkzin): 298-306.
SHER, Gerson (1978) Marxist Criticism and Dissent in Socialist Yugoslavia (Bloomington, London: Indiana University Press).
Période contemporaine :
ARSENIJEVIĆ, Damir (ed.) (2014), Unbribable Bosnia and Herzegovina. The Fight for the Commons (Baden-Baden: Nomos Verlag).
BAJRUŠI, Robert (2021), Možemo! Kako je nastala nova hrvatska ljevica (Zagreb: Profil).
CRNKOVIĆ, Gordana P. (2013), Nenacionalistička kultura, u podzemlju i na površini. In: Lukić, Renéo, Ramet, Sabrina P., Clewing, Konrad (eds.), Hrvatska od osamostaljenja. Rat, politika, društvo, vanjski odnosi (Zagreb: Tehnička knjiga): 223-240.
GORDY, Eric (1999), The Culture of Politics in Serbia. Nationalism and the Destruction of Alternatives (University Park, PA: The Pennsylvania University Press).
MORAČA, Tijana (2016), Between defiance and compliance: a new civil society in the post-Yugoslav space?, Osservatorio balcani e caucaso (Occasional Paper).
MUJANOVIĆ, Jasmin (2018), The Hunger and the Fury. The Crisis of Democracy in the Balkans (London: Hurst Publishers).
PAVELIĆ, Boris (2018), Smijeh slobode. Uvod u Feral Tribune (Zagreb: Naklada Val).