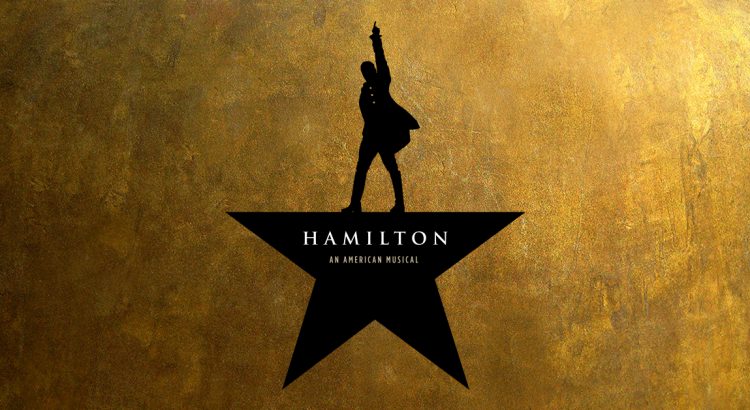Je me souviens des premiers mois en tant que correspondant du Temps aux Etats-Unis. En automne 2011, New York était secouée par le mouvement Occupy Wall Street. Plusieurs centaines de protestataires s’étaient installés avec leurs tentes dans le froid du parc Zuccotti, à deux pas de ce qui était encore Ground Zero. On se demandait si c’étaient les signes avant-coureurs d’une nouvelle petite révolution sociale. Joan Baez était venue à la place Foley chanter l’espoir de voir Wall Street rendre des comptes après la faillite des subprime et la crise économico-financière de 2008-2009.
Cinq ans plus tard, la révolution qui a cours n’est pas exactement celle qu’avaient prévue les militants d’Occupy Wall Street. C’est un milliardaire, Donald Trump, qui va s’établir à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier 2017 à la place de Barack Obama. Parmi les électeurs du magnat new-yorkais de l’immobilier, il y a sans doute des militants d’Occupy Wall Street. Difficile de s’y retrouver, non?
Même si une bonne partie du pays estime que les Etats-Unis ne vont pas dans la bonne direction, ils sont tout de même près de 55% à juger favorablement le président Barack Obama. Le chômage (4,9%) n’a plus été aussi bas depuis 2007. Le candidat républicain à la Maison-Blanche Mitt Romney, qui chercha à déloger Barack Obama de la Maison-Blanche en 2012 aurait été très satisfait d’un tel bilan. Au cours de la présidentielle, voici quatre ans, il promettait, s’il était président, de ramener le chômage à 6%…
Si l’on énumère les succès du 44e président, le bilan est bon. Barack Obama a permis à l’économie d’éviter de sombrer dans une nouvelle grande dépression. Il a sauvé l’industrie automobile grâce à un plan de sauvetage ambitieux et en a profité pour imposer aux constructeurs de Détroit de sévères normes environnementales en matière de consommation de carburant. Il a tendu la main à l’ennemi juré l’Iran et négocié avec cinq autres puissances et l’Iran un accord subtil sur le programme nucléaire de Téhéran. Il a négocié en amont avec la Chine et adopté des mesures draconiennes pour réduire en Amérique les émissions de CO2 (Clean Power Plan), créant avec Pékin une dynamique qui a permis l’adoption de l’historique (même si insuffisant) accord de Paris sur le climat. Constatant un échec patent de l’embargo commercial de plus d’un demi-siècle appliqué par Washington contre Cuba, il a amorcé une normalisation avec la Havane. Aujourd’hui, les deux capitales ont rétabli leurs relations diplomatiques rompues en janvier 1961. Obamacare ou l’Affordable Care Act fut un moment historique outre-Atlantique. Adoptée en 2010 lorsque le Sénat était encore sous le contrôle des démocrates, l’administration Obama a réussi à faire passer la première réforme de la santé d’envergure depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, elle connaît des problèmes en raison d’une forte hausse des primes maladie et nécessiterait, Barack Obama l’a reconnu lui-même, d’être améliorée. Elle n’en a pas moins permis d’assurer 22 millions d’Américains supplémentaires. Le président démocrate aurait aimé assurer davantage de personnes en élargissant la couverture de Medicaid (l’assurance-maladie pour les plus démunis), mais nombre d’Etats (républicains) ont refusé cette “mainmise” de l’Etat fédéral malgré le fait que ce dernier finançait cette extension de la couverture médicale.
Sur le plan intérieur, là où Barack Obama n’a pas été à la hauteur, c’est à propos de la torture. Il en a bien interdit la pratique dès son arrivée à la Maison-Blanche, mais il n’a jamais cherché à traduire en justice les responsables de la torture perpétrée dans les prisons secrètes de la CIA et à Abou Ghraïb sous les années Bush. C’est un manquement, car les prochaines administrations pourraient être tentées d’en faire de même. D’ailleurs Donald Trump a promis, en campagne électorale, de restaurer la pratique des simulations de noyade (waterboarding) voire même des techniques de torture encore plus violentes. Barack Obama a aussi traqué, sans qu’on sache vraiment pourquoi, les journalistes qui ont réussi à obtenir des informations dites secrètes (classifiées) de l’administration. C’est pourtant un principe fondamental du journalisme qui cherche à questionner le fonctionnement des institutions.
Au sujet de la Syrie, tout le monde tire à boulets rouges sur l’administration Obama, estimant qu’elle a démissionné. Barack Obama a sans doute sous-estimé le désastre humanitaire syrien et aurait pu être plus engagé à chercher une manière multilatéral de venir en aide aux Syriens. Aurait-il dû armer les rebelles syriens plus tôt? Le fait qu’il ait fini par s’y résoudre semble laisser entendre qu’il aurait dû agir avant. Mais bien malin aujourd’hui qui peut dire qu’une telle tactique aurait réussi face à une opposition syrienne très éclatée. Un professeur de l’Université de Quantico, un ami, me disait à quel point il était difficile de trouver un terrain d’entente entre chaque composante de l’opposition syrienne qu’il rencontrait régulièrement en Turquie.
Quant à la ligne rouge que Barack Obama a très maladroitement tracée en 2012 si le président Bachar el-Assad utilisait des armes chimiques contre son peuple, nombre d’experts relèvent que son non-respect a sapé l’autorité internationale des Etats-Unis. C’est le point de vue de François Heisbourg, de l’IISS à Londres. Peu crédible si l’on pense que Washington a conclu l’accord sur le nucléaire iranien après cela et l’accord de Paris sur le climat également. De plus, la ligne rouge avait un objectif: punir Bachar el-Assad par rapport aux armes chimiques. Or qu’a fait l’administration Obama? Un an avant le gazage de la Ghouta orientale par le régime syrien, Barack Obama a décidé de son initiative d’entamer des négociations avec la Russie pour tenter d’éliminer l’arsenal chimique syrien. On était en septembre 2012. Quand la tragédie d’août 2013 a lieu, le plan d’élimination est prêt. Il est mis en oeuvre avec la Russie et l’Organisation onusienne pour l’élimination des armes chimiques (OIAC). En plein conflit, la communauté internationale parvient à évacuer près de 1200 tonnes d’armes chimiques. Le programme est un succès diplomatique considérable. Mais bien sûr, il ne règle en rien le conflit syrien. Ce n’était d’ailleurs pas son but. Mais l’initiative a atteint son but, ce que des bombardements en 2013 n’aurait jamais réussi à atteindre.
Avec Donald Trump, dont on ne connaît pour dire pas la vision tant il a bâti sa campagne sur des mots, des slogans, des twittos de 140 caractères, tout cela pourrait s’effondrer. Mais comme le dit Barack Obama, l’histoire des Etats-Unis n’est pas linéaire, elle va en zigzag. En quittant l’Amérique, je suis animé par une grande déception, celle de voir la raison, les Lumières diraient d’autres, éteinte par la vague populiste. Je ne dis pas que Donald Trump a volé son élection. Bien qu’odieux, il a gagné les primaires à la régulière, convaincant 14 millions d’Américains à le soutenir, du jamais vu lors des primaires républicaines. Il a réussi à souffler de manière extrêmement efficace sur les braises de la colère surtout des Blancs qui ont l’impression que le pays leur échappe: sa destinée, sa nature, sa démographie, ses objectifs. Il a mis les partis républicain et démocrate devant leur responsabilité: celle d’avoir omis de faire leur travail.
Donald Trump pourrait toutefois très vite décevoir. Les promesses qu’il a faites, parfois extravagantes, à un électorat furieux, seront très difficiles à tenir. Il dit ainsi qu’il ne va sans doute pas abroger Obamacare alors que pour les républicains, c’est un cheval de bataille depuis toujours. Les cols bleus aimeraient voir Wall Street payer pour les problèmes économiques auxquels ils sont confrontés. Là aussi, pas sûr qu’ils soient entendus. Parmi les “papables” pour le poste de secrétaire au Trésor le chef des finances de sa campagne, un ancien dirigeant de Goldman Sachs…