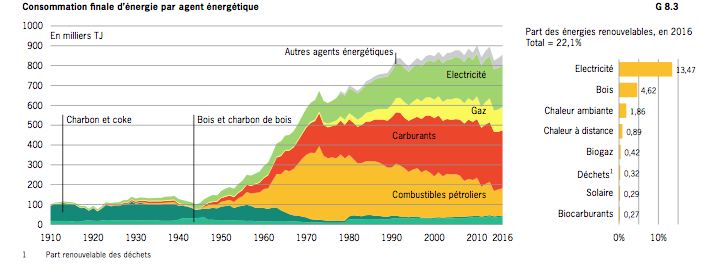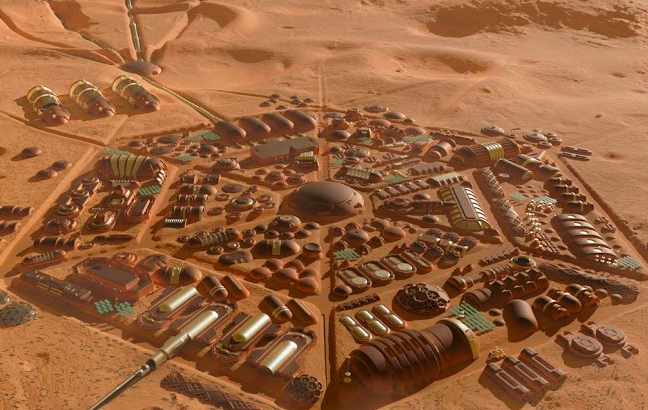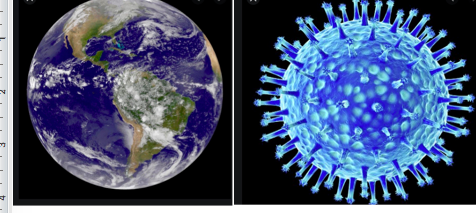Voici un demi-siècle, l’extrême-droite entrait par effraction, les armes à la main, dans les palais présidentiels, semant la terreur dans le pays : coups d’Etat au Brésil en 1964, en Grèce en 1967, au Chili en 1973… Aujourd’hui, ce sont des peuples, souvent avec de faibles majorités mais parfois aussi à travers de véritables plébiscites, qui optent pour la démocratie « illibérale », l’autoritarisme et le chacun pour soi nationaliste.
La tendance fait tache d’huile depuis une dizaine d’années : aux Philippines, un président populiste tue de sa propre main de présumés trafiquants de drogue – dans un Etat de droit tout être humain, aussi criminel soit-il, a droit à un procès équitable. En Turquie, un nouveau sultan veut ressusciter l’Empire ottoman – mais sans la tolérance religieuse et culturelle. En Russie, Poutine poursuit le même dessein, et exerce ses sinistres méthodes d’élimination de ses opposants au grand jour. Au Brésil, tel autrefois un empereur romain, le président met le feu à son propre pays. L’Inde est en mains des descendants des assassins de Gandhi et qui aujourd’hui remplacent méthodiquement son message de nation pluriculturelle et plurireligieuse par un suprématisme et un sectarisme hindouiste. En Pologne et en Hongrie, des apprentis dictateurs musèlent la presse et la justice. Dernier de la série : le Sri Lanka où s’installe un pouvoir de plus en plus autoritaire. A chaque fois, le vote populaire a sanctionné le tour de vis anti-démocratique. L’Italie y a échappé de peu, et rien n’y est joué sur la durée.
Un violent changement de paradigme
On peut vraiment parler d’une mouvement de fond qui a remodelé le monde en quelques années. Les lignes de force de cette rupture avec l’humanisme sont toujours les mêmes : rejet des institutions de régulation multilatérales, imposition d’une priorité nationale court-termiste et égoïste, admiration pour l’»homme fort » et de celui qui a « réussi » peu importe ses méthodes ; rejet du féminisme au profit d’une idéologie familiale et patriarcale ; intégrisme religieux chrétien (évangéliste en fait); marginalisation voire persécution des homosexuels ; rejet, également, de l’écologie et des mouvements sociaux ; idéalisation de caractéristiques nationales présentées comme monolithiques et immuables.
Ce revirement résulte d’un rejet profond d’une « élite bien-pensante» ressentie comme hypocrite et dans laquelle on amalgame allègrement les protagonistes d’une mondialisation sans foi ni loi, et les partisans d’une régulation globale respectueuse des droits humains. On largue les amarres, se lâche, rejette toute éthique de la responsabilité, toute discipline intellectuelle. Est vrai ce que je dis être vrai, est faux ce que décrète être faux, c’est le règne des Fake News qui embrument les esprits et polluent les débats. Même des pilotes d’avion croient, dit-on, à la fable de la terre plate : chaque fois qu’ils atterrissent c’est sur du plat, et pour le reste, c’est Dieu qui leur envoie l’illusion de la courbure de la Terre…
Une droitisation du milieu populaire
Ce revirement s’était annoncé dans le divorce maintenant largement acté entre la gauche, héritière de la tradition des lumières et de l’égalité de chances, et le milieu populaire. La bataille culturelle a succédé à la bataille sociale, les moins bien lotis se nourrissant de leur haine pour ceux dont ils se sentent méprisés, et choisissant les partisans de la fermeture pour contrer les « élites libérales » qui les exposent à la concurrence déloyale de la mondialisation. Le soutien apporté par la gauche aux droits des réfugiés ou des homosexuels a creusé l’incompréhension et le rejet, le milieu populaire endossant largement les préjugés de l’autoritarisme et la peur de la différence (ethnique ou sexuelle). Pas de place pour une gestion écologiquement et socialement responsable de la Planète, patrimoine commun de l’Humanité – c’est « tout au marché » pour les uns, « tout à la nation » pour les autres.
Le premier signe avant-coureur de cette mutation du paysage politique a probablement été l’échec en France en 2002 de Jospin au deuxième tour de l’élection présidentielle, ne laissant aux électrices et électeurs que le choix entre le candidat de la droite libérale et mondialiste et celui de l’extrême droite autoritaire et protectionniste…
Mais rien de ce qui est humain n’est irréversible
L’élection américaine nous dira si cette tendance peut être surmontée. La défaite de Trump, personnage incarnant le populisme de bas étage, la transgression, la vulgarité, la division, le soutien au racisme, au dénigrement et aux complotistes de tout genre, l’irrespect absolu de sa fonction, sonnerait comme un coup d’arrêt salutaire.
Cette défaite hautement souhaitable est loin d’être acquise, tant Trump a réveillé les mauvais démons de l’Amérique et un désir perverti de reconnaissance et de revanche sociale des « perdants de la mondialisation ». Mais au-delà de la personnalité un peu effacée de Biden, son élection pourrait marquer le début d’un retournement de tendance. Il ne faudrait alors surtout pas se reposer sur ses lauriers, mais enclencher sans tarder un combat déterminé contre les inégalités sociales et pour la dignité de chaque être humain. Ce serait le point de départ d’une sérénité politique retrouvée.