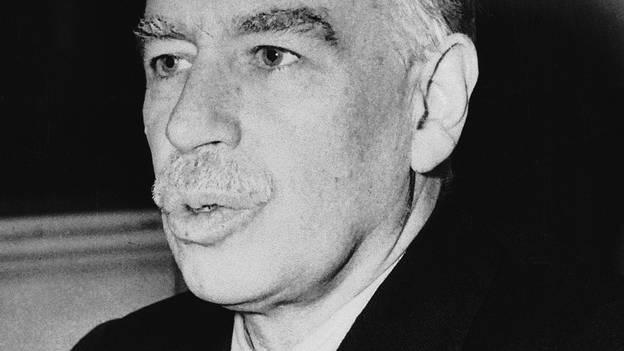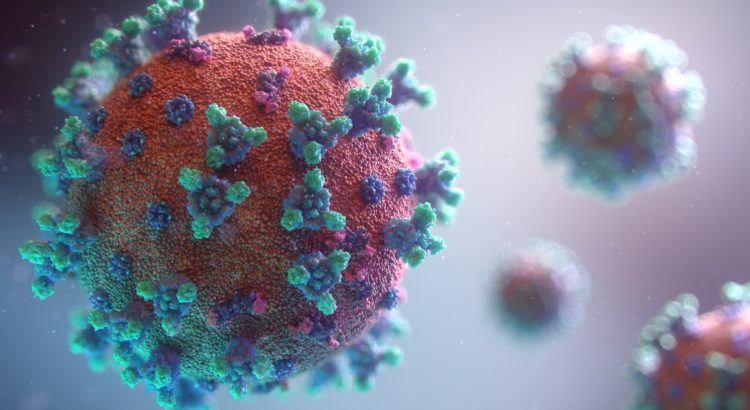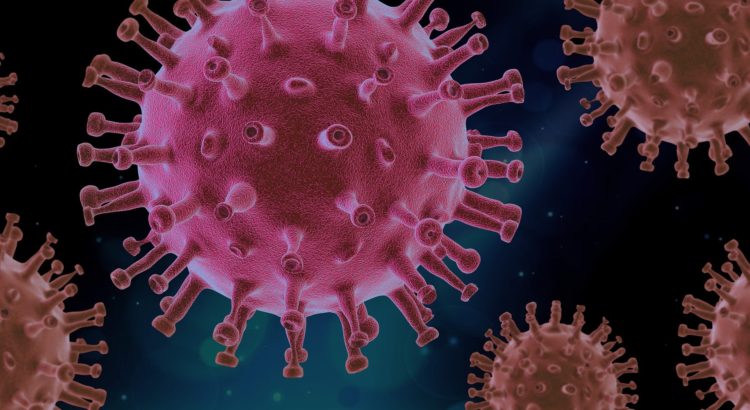Le mois passé, l’Alliance climatique suisse a publié un rapport dans lequel elle fait remarquer le grave retard de la Suisse par rapport à l’Union Européenne (UE) en ce qui concerne le rôle aussi bien de la finance de marché que de la politique économique pour imprimer un virage de nature écologique au système économique contemporain – qui vise la maximisation des profits même si cela va au détriment du bien commun.
L’UE a déjà adopté plusieurs initiatives législatives dans le cadre du Plan d’action pour une finance durable. Celles-ci ont été coordonnées en ce qui concerne leurs contenus et les délais de leur mise en œuvre, de telle sorte à former un réseau systémique visant les mêmes objectifs sur les plans financier et environnemental.
Les acteurs sur les marchés financiers et les entreprises dans l’économie «réelle» de l’UE sont des parties prenantes dans le «Green New Deal» qui est censé réduire les risques climatiques suite aux choix privés et publics favorables à l’environnement. Aussi, les acteurs sur ces marchés dans l’UE doivent-ils publier leurs propres stratégies d’investissement visant la durabilité de celles-ci et, par ailleurs, doivent respecter les règles d’une finance durable dans l’ensemble de l’UE.
Grâce à ces mesures, toutes les institutions financières dans l’UE sont obligées d’éviter les risques de transition, à savoir, la perte de valeur de leurs actifs financiers liés aux énergies fossiles, comme elles sont obligées de réduire les effets négatifs de leurs placements sur le climat, l’environnement et la justice sociale. Qui plus est, l’UE a publié une liste des activités économiques durables, afin d’éviter certaines pratiques de «greenwashing» des institutions financières et pour savoir quelles sont les entreprises qui méritent d’avoir des financements publics car elles respectent les critères de durabilité de l’UE.
Rien de tout cela n’existe, en l’état, en Suisse, étant donné que le Conseil fédéral n’a pas (encore) bougé pour suivre l’UE dans la lutte contre les changements climatiques. Comme par le passé, la Suisse considère simplement les «conditions-cadre» assurant que la concurrence sur le «libre marché» (de n’importe quel bien, service ou actif) puisse déployer ses effets à terme, censés résoudre tous les problèmes d’ordre économique.
Comme ledit rapport le met en lumière, cela explique l’absence d’une stratégie climatique du Conseil fédéral ayant des objectifs clairs et concrets pour les institutions financières de toute sorte (y compris les caisses de pension), qui n’ont dès lors aucune obligation de diligence en ce qui concerne la gestion des risques climatiques découlant de leurs propres stratégies et choix de portefeuille.
Tout cela va peser sur les risques réputationnels de la place financière helvétique et fera du mal à l’ensemble de la société.