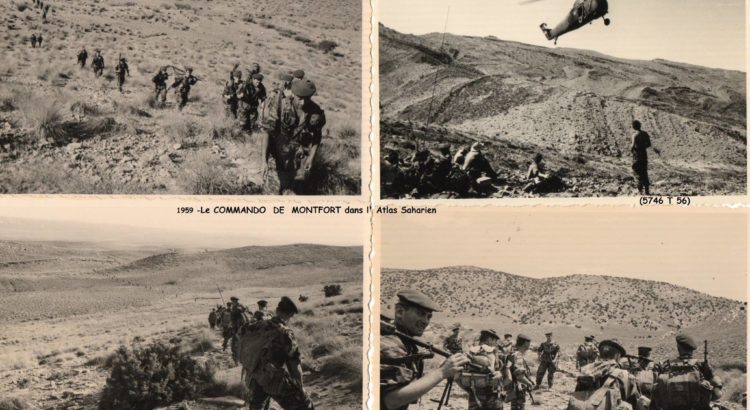Six cents ans durant, c’est-à-dire du XIIIème siècle au début du XIXème siècle, les soldats, enrôlés contre rémunération dominent les champs de bataille européens. Et parmi ces mercenaires, les soldats suisses font figures de professionnels très aguerris. Aussi sont-ils très recherchés. Ce qui conduit les autorités helvétiques à instaurer un système de « location de mercenaires », généralement connu sous le terme de « service étranger ».
Distinction entre mercenaires et soldats capitulés
Ce service marque de son empreinte, dès le milieu du XVème siècle, à la fois la société, l’économie et la politique de la Confédération. C’est alors que les rois de France tentent de s’allier plus étroitement aux cantons confédérés. Pour des fondements certes de stratégie politique, et en particulier en raison de la nécessité pour le gouvernement français de rechercher des alliances pour lutter contre le duché de Bourgogne et l’empire des Habsbourg, le royaume de France doit se rapprocher des villes-États suisses. Mais là ne réside pas le seul intérêt de la coalition espérée.
Le but de la royauté française consiste aussi dans le recrutement des fameux soldats helvétiques[1]. Les soldats suisses que l’on retrouve d’ordinaire dans toute l’Europe, depuis la garde personnelle suisse du roi de France au château de Versailles jusqu’aux gardes suisses du pape au Vatican. Soldats intègres et courageux, ces militaires suisses ne sont pour certains que des mercenaires.

Garde suisse au Vatican (photo : Mromerorta)
Alors qui sont-ils ces Suisses venus défendre et protéger les têtes couronnées d’Europe et combattre pour une cause qui n’est pas la leur sur tous les champs de bataille ?
Pour savoir ce qu’il en est, une distinction capitale est à opérer, c’est celle qui existe entre le terme de mercenaire et celui de « soldat capitulé ». Même si la différenciation entre ces deux termes paraît difficile à établir, il s’avère nécessaire de définir exactement le sens de ces mots pour mieux saisir leur spécificité. Le lexique d’histoire suisse nous permet ainsi de déterminer ce qu’est le mercenariat. À sa lecture, il apparaît que le mercenariat
« consiste en des engagements individuels non sollicités par l’État d’origine de l’engagé[2] ».
Les engagements dont il s’agit sont donc des accords privés aucunement contrôlés par ces traités officiels que l’on dénomme capitulations. Contractés sans autorisation étatique, ces engagements prennent des formes diverses. Ces contrats peuvent être individuels ou collectifs. Lorsque le contrat est individuel, le soldat mercenaire se place volontairement, et par contrat privé, sous l’autorité et la juridiction d’un souverain étranger. Dans le cas d’un contrat collectif, des levées illicites de compagnies dites franches, libres ou ambulantes, sont faites et subordonnées à des capitaines indépendants. Ces derniers signent alors l’engagement de la troupe entière avec le demandeur. C’est une sorte de « capitulation privée[3] ».
Précisons aussi que le terme « mercenaire » désigne en français comme en italien (mercenario), un homme qui sert dans une armée étrangère pour une solde. C’est un professionnel qui loue ses services au plus offrant. L’allemand en revanche emploie le mot « Reisläufer », qui désigne celui qui s’engage pour participer à une campagne militaire ou Reise[4]. Cette différence entre le soldat et le mercenaire, le philosophe Voltaire ne l’accepte pas, puisqu’il considère le soldat quel qu’il soit comme un mercenaire[5]. La réalité historique semble beaucoup plus complexe.
En effet, appliquer aux soldats suisses combattant pour le royaume de France le terme de mercenaire, c’est frapper d’anathème le « service étranger » de la Confédération. Lorsqu’on dépasse l’argutie emphatique, l’aspect réprobateur de cette affirmation ne résiste pas à l’analyse. Ce vocable ne correspond en rien à la réalité juridique qui organise la plupart des accords de « location » de soldats confédérés. Le terme de mercenariat ne peut s’appliquer aux fameux soldats suisses que lorsque ce mercenariat est organisé légalement, dans un cadre étatique. Ce mot s’emploie, à bon escient, lorsque les régiments suisses sont prêtés à des souverains étrangers en vertu de capitulations, établies par l’État.
Ces régiments agissent alors sous le couvert juridique suisse. Et les territorialités dans lesquelles ces corps armés se déploient deviennent de ce fait de véritables territoires suisses, transportés sur le sol étranger[6]. Comme les ambassades, ces régiments militaires suisses bénéficient alors d’un accord d’extraterritorialité. Si de tels accords internationaux existent, c’est en raison de la réputation d’efficacité que la soldatesque helvétique revêt.
Pourquoi et comment une telle notoriété s’est-elle imposée au-delà des frontières de la Suisse ?
Répondre à cette question permet de comprendre l’influence et l’importance que prend au fil des siècles le service étranger dans les cantons suisses.
Le renom des soldats helvètes remonte à l’antiquité romaine. C’est César lui-même qui encense en premier lieu le guerrier suisse dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules. Ces quelques lignes écrites par Jules César résument à elles seules l’admiration que les Romains portent en ces temps aux guerriers des montagnes suisses :
Les Helvètes surpassent en courage tous les Gaulois, parce que, chaque jour, ils combattent les Germains, soit pour défendre leurs frontières, soit pour rentrer eux-mêmes sur le territoire de ceux-ci […] Ils disent que la supériorité du courage leur assurerait aisément l’empire de toute la Gaule[7].
Plusieurs siècles plus tard, le jugement de César se voit confirmer par les prouesses militaires des soldats de la Confédération. L’écrivain Albert de Bonstetten, né en 1442, insiste alors lui aussi sur l’invincibilité des Suisses affirmant que le
« peuple des Confédérés est invincible à la guerre, insuperabile bella[8] ».
L’ouverture de la route du Gothard, nécessitée par l’intensification du transit commercial, permet à ces communautés, situées au nord du col du Gothard, de s’enrichir. Au début d’août 1291, les représentants des communautés paysannes d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald concluent ainsi un pacte d’alliance qui peut être considéré comme l’acte de fondation de la Confédération suisse même. Certes, à l’origine, aucune volonté de créer un nouvel État ne transparaît dans cet accord[9]. Elles décident dans un état d’esprit défensif de s’unir le jour même où un Habsbourg devient empereur du Saint Empire romain germanique[10].
C’est une constante de l’histoire militaire suisse qui se vérifie encore en 1648, lors du Traité de Westphalie, ou en 1815, lors du congrès de Vienne. Ce n’est ni une dynastie nobiliaire, ni une quelconque puissance européenne qui assure le contrôle et la protection des axes de communication transalpins. Ceux-ci sont gardés par leurs seuls habitants. C’est ainsi que se développe la conception suisse de la « défense active ». Celle-ci combine une défense ou un combat retardateur, appuyé sur le terrain ou sur son renforcement, avec un élément dynamique, l’attaque surprise ou la contre-attaque sur les flancs de l’adversaire[11]. Les victoires militaires, que les Suisses remportent à la fin du XVème siècle contre Charles le Téméraire, forgent alors la réputation de l’infanterie suisse[12].
[1] Marc Höchner, Au service de sa majesté. La famille Castella sous les ordres des princes étrangers, Une famille fribourgeoise étoilée : Les Castella, plaquette publiée à l’occasion de l’exposition à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg du 28 septembre au 24 novembre 2012, Éditeur Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 2012, p. 42.
[2] Alain-Jacques Czouz-Tornare, Mercenaires, Lexique historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Dictionnaire philosophique, article « Patrie ».
[6] Alain-Jacques Czouz-Tornare, Vaudois et Confédérés au service de France 1789-1798, Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition présentée au Musée de Morges, Éditions Cabédita, 1998, Collection Archives vivantes, p. 13.
[7] Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules, Édition du groupe « Ebooks libres et gratuits », traduction, L-a.Constans, 1926, p. 4.
[8] Gonzague De Reynold, Gonzague De Reynold Raconte la Suisse et son histoire, op. cit., p. 129.
[9] Ibid., p. 45.
[10] Ibid.
[11] Ibid., pp. 46-47.
[12] Ibid., p. 47.