
La justice vaudoise a amorcé sa reprise en début de semaine.
Le 16 mars 2020, toutes les audiences jugées non urgentes – plus de 2000 – avaient été annulées, et la notification des décisions judiciaires suspendues.
Depuis le 6 avril 2020, les tribunaux et procureurs vaudois ont progressivement recommencé à notifier leurs décisions.
De nombreux justiciables s’en réjouissent, préoccupés qu’ils étaient de voir le traitement de leur cause ralenti. Que ceux dont l’audience initialement fixée à fin mars, et annulée en raison de la pandémie de coronavirus, ne se réjouissent toutefois pas trop vite. L’ordre judiciaire vaudois annonce en effet que les plannings sont déjà pratiquement complets pour mai et juin 2020.
Or, en juillet, débutent les féries d’été – qui s’étendent du 15 juillet au 15 août. En clair, cela signifie qu’une audience initialement fixée à fin mars et annulée en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 sera vraisemblablement réagendée après les féries d’été. Soit dans le meilleur des cas dès fin août – début septembre 2020. Il faudra donc encore un peu de patience, à tout le moins s’agissant des affaires soumises aux féries. S’agissant des causes non soumise aux féries, à l’image des procédures pénales, ou des procédures civiles sommaires – par exemple des mesures provisionnelles, les justiciables peuvent espérer que les audiences puissent éventuellement être appointées plus tôt.
Délais suspendus
Les tribunaux civils et administratifs ne tiennent en effet généralement pas audience pendant les féries judiciaire. Celles-ci sont fixées par la loi aux périodes suivantes : du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (sauf cette année, les féries de Pâques ayant exceptionnellement été étendues et avancées pour être fixées du 21 mars au 19 avril 2020 par ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus), du 15 juillet au 15 août inclus et du 18 décembre au 2 janvier inclus. Ainsi, durant ces périodes, la majorité des délais ne courent pas.
Si elle était considérablement ralentie durant la deuxième partie du mois de mars, la justice n’était cependant pas totalement arrêtée. En effet, les audiences considérées comme urgentes n’ont, elles, pas été annulées. Tel était le cas des audiences concernant des personnes détenues, de celles relatives à des placements à des fins d’assistance, ou d’autres audiences urgentes.
S’agissant de la notification des décisions, qui a repris dans le canton de Vaud depuis le début de la semaine, les délais de recours commenceront immédiatement à courir pour les causes pénales et les autres affaires qui ne sont pas soumises à la suspension des délais. S’agissant des causes civiles et administratives qui bénéficient des féries, les délais de recours ne commenceront à courir qu’à partir du jour qui suit la fin de la période de suspension pascale, soit dès le 20 avril 2020.
Pas d’audiences de jugement par vidéoconférence
Le fait que les audiences annulées ne pourront pas être refixées à brève échéance n’est probablement pas un mal en cette période de pandémie puisque celles-ci impliquent en principe la présence physique des parties, à tout le moins de leurs avocats, et impérativement celle des juges.
Les tribunaux suisses ne tiennent en effet pas d’audience de jugement par vidéoconférence, contrairement à ce qui se pratique désormais en France et au Québec. Dans l’Hexagone, on verra en effet le 8 avril 2020 Christian Quesada, ancien champion d’un jeux télévisé, accusé de délits sexuels, comparaître par vidéoconférence depuis son lieu de détention provisoire en raison du coronavirus. Cette audience vidéo se tiendra à huis clos.
Au Québec, la tenue de procès virtuels dictés par la crise sanitaire a déjà débuté. C’est ainsi que s’est tenu fin mars 2020 le premier procès entièrement virtuel. Magistrats, parties, avocats, et témoins, étaient tous à distance et pouvaient se voir et s’entendre via leurs tablettes ou téléphones. « Une fois que les parties à l’audience ont été branchées au système, cela venait créer une salle d’audience virtuelle où chacune d’elles pouvait interagir avec le juge qui présidait l’audience. Celui-ci s’est assuré que toutes les consignes, particulièrement celles relatives à la confidentialité de l’audience, soient respectées », a précisé le ministère de la Justice à La Presse Canadienne.
La Suisse ne connaît pas une telle pratique. Certes, les auditions par vidéoconférence se pratiquent en matière d’entraide internationale, ainsi que dans des procédure pénales nationales. Le code de procédure pénale prévoit en effet la possibilité, pour le ministère public ou le tribunal d’ordonner la une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées (art. 144 CPP). Cela concerne toutefois les auditions réalisées en cours d’enquête. Il ne s’agit pas encore de tenir des audiences de jugement totalement virtuelles.
Dans le canton de Vaud le rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal 2019, qui vient de paraître le 6 avril 2020 souligne la poursuite des travaux, dans le cadre du programme suisse d’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale (HIJP), en matière de vidéoconférence. Toutefois, là encore, il ne s’agit à ce stade que de permettre aux autorités de disposer de solutions de vidéoconférence pour procéder à des auditions. La tenue d’audiences de jugement entièrement virtuelles, à l’image de ce qui se pratique en France et au Québec, n’est pas (encore?) prévue.
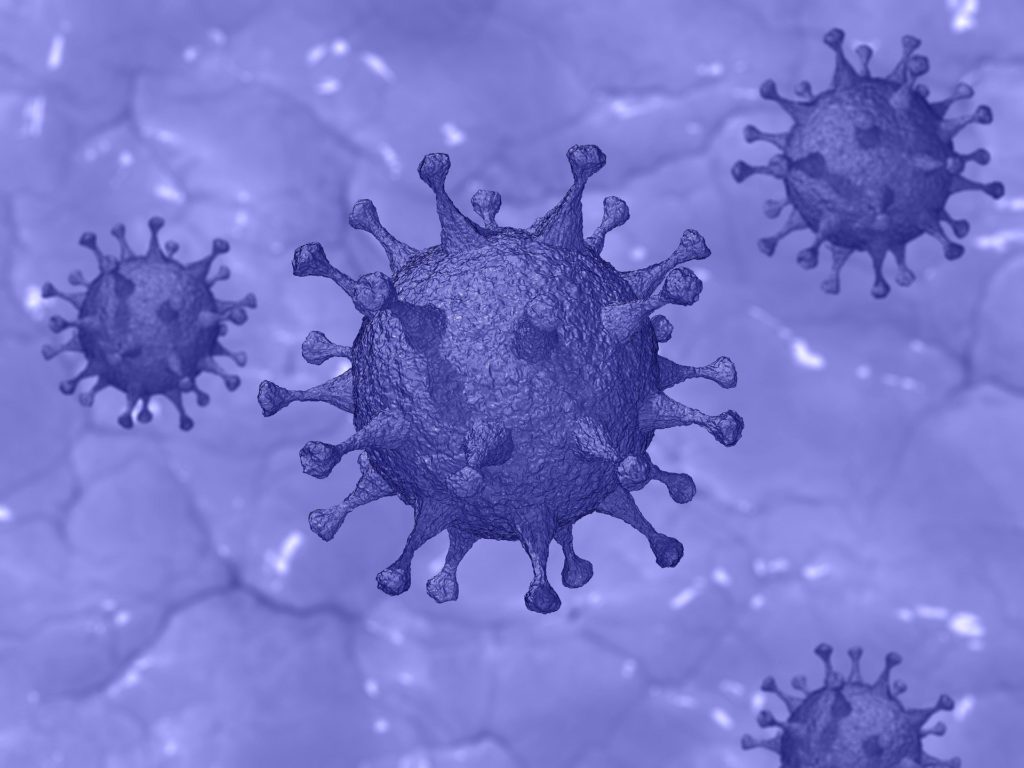


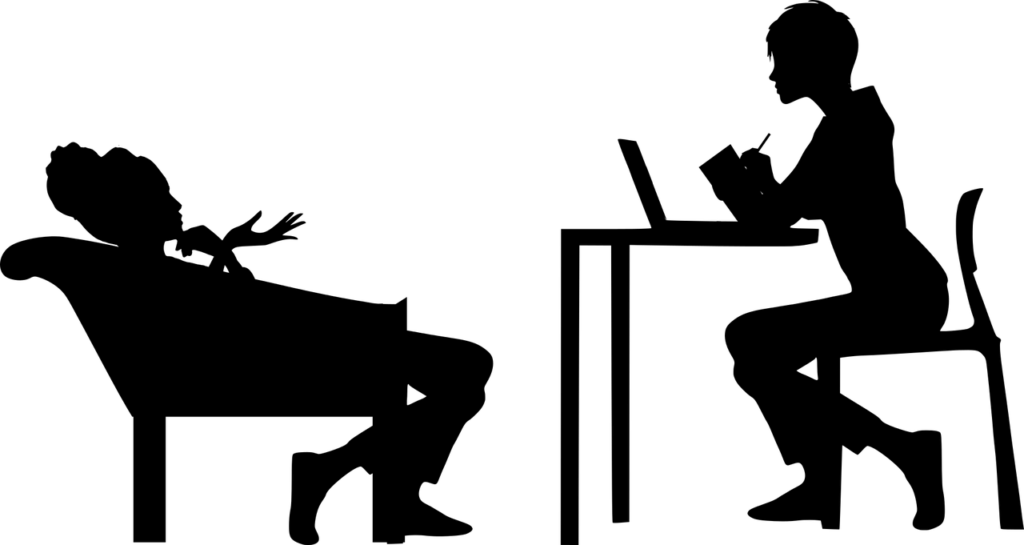

 La robotisation de la justice est en marche. Après l’Estonie, la France projette de remplacer les juges par des robots dans certaines affaires jugées de peu d’importance, et
La robotisation de la justice est en marche. Après l’Estonie, la France projette de remplacer les juges par des robots dans certaines affaires jugées de peu d’importance, et 