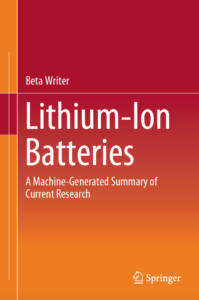Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais pour ma part, la première fois que j’ai utilisé mon empreinte digitale pour effectuer un paiement via une application sur mon smartphone, le geste ne m’a pas semblé anodin du tout. Utiliser ces lignes incrustées dans la peau depuis notre naissance pour piloter un flux monétaire m’a paru d’emblée une alliance d’un genre nouveau, inconnu, incertain. Sans utiliser la médiation du mot, du chiffre ou de la lettre, voici que la peau même ordonnait à des espèces, qui n’étaient plus ni sonnantes ni trébuchantes, d’aller ailleurs.
Depuis cette innovation, le corps n’a cessé d’être de plus en plus partenaire de la matière digitalisée. L’usage des mesures biométriques produit des idées «pas si futuristes que cela», comme le commentait en 2016 cet article imaginant que nous puissions payer à la caisse d’un magasin en montrant notre oreille: «“les oreilles sont uniques”, dit Michael Boczek, president et manager de Descartes Biometrics, une compagnie spécialisée dans les applications mobiles sécuritaires de détection auriculaire. “[L’oreille] est stable et persistante, ce qui signifie qu’elle se modifie très peu au cours de la vie d’un individu. C’est vrai également des empreintes digitales, mais beaucoup moins de la reconnaissance faciale». Trois ans plus tard, Descartes Biometrics s’est dévelopée, en partenariat avec l’Université de Calgary (Canada), et on peut voir sur son site l’image d’une personne détectée par son smartphone grâce à la forme de son oreille.
A cela s’ajoute encore «l’oculométrie (en anglais Eye-tracking (suivi oculaire) ou Gaze-tracking)», qui selon Wikipédia, «regroupe un ensemble de techniques permettant d’enregistrer les mouvements oculaires. Les oculomètres les plus courants analysent des images de l’oeil humain enregistrées par une caméra, souvent en lumière infrarouge, pour calculer la direction du regard du sujet. En fonction de la précision souhaitée, différentes caractéristiques de l’œil sont analysées». De fait, ce type de technologie semble apte à servir de mot de passe pour ouvrir son ordinateur, et autres prouesses, comme l’affirme cette vidéo promotionnelle.
On nous y promet que nous allons «contrôler notre ordinateur», mais on se demande bien vite, entre nos empreintes décryptées, notre oreille reconnue et nos yeux suivis, qui maîtrise quoi dans cette affaire. De fait, voici notre corps de plus en plus embedded dans la matière digitale. Ce terme anglais n’a pas d’équivalent exact en français, et signifie que le corps se retrouve enclos, incorporé, encastré, encapsulé, inséré dans les infinis possibles du numériques. C’est un constat, ni une lamentation ni un cri de victoire. Nous arrivons simplement de manière patente à ce que le philosophe Jacques Derrida annonçait il y a plus de vingt ans: «Ce qui se prépare, à un rythme encore incalculable, de façon à la fois très lente et très rapide, c’est un nouvel homme bien sûr, un nouveau corps de l’homme, un nouveau rapport du corps de l’homme aux machines, et on l’aperçoit déjà cette sorte de transformation» [1]. Nous y sommes.
Avons-nous encore la possibilité de nous extraire de cet univers, de nous en couper momentanément? C’est l’expérience proposée aux éleves vaudois qui effectuent dès ce lundi leur rentrée scolaire sans smartphone dans les plages horaires scolaires. Auprès des plus jeunes d’entre nous, nous exprimons ainsi notre espérance de pouvoir encore nous «désencastrer» de la matière numérique. Quel regard porteront ces jeunes sur cette expérience dans vingt ans? Leur semblera-t-elle obsolète ou salutaire? A lire Jean-Claude Domenjoz dans Le Temps, on en rediscutera sans doute. Mais à l’heure du corps qui flirte de si près avec les cables, le carbone et l’électricité de nos engins informatiques, cette décision reflète notre besoin de l’utopie d’une école sans smartphone, de l’utopie «d’îlots, d’archipels» soustraits à cette incorporation digitale, comme les décrit Alain Damasio dans son dernier roman [2].
[1] Jacques Derrida, Sur parole. Instantanés philosophiques, Editions de l’Aube, 2000, édition Kindle, l. 484.
[2] Alain Damasio, Les Furtifs, La Volte, 2019.