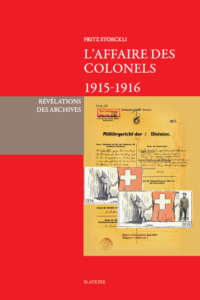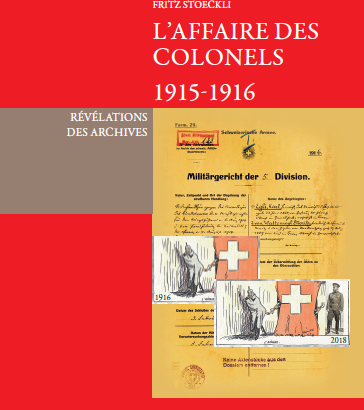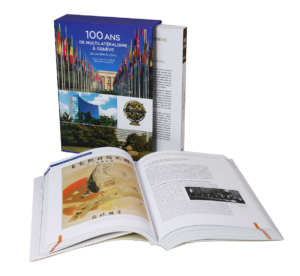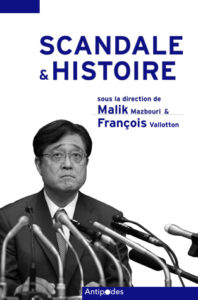En 1802, à dix-neuf ans, assistant de loin à la fin de la Guerre des bâtons menée par les insurgés fédéralistes contre la République helvétique, le Genevois et fils de pasteur Jean-Jacques-Caton entamait ses études de théologie qu’il poursuivrait jusqu’en 1806. Son inscription à l’Académie allait en l’occurrence lui permettre d’échapper à la conscription militaire qui était instaurée cette année-là à Genève, et lui épargner les affres des guerres napoléoniennes.
En 1807, âgé d’à peine vingt-quatre ans, il obtenait son doctorat, une année après avoir été consacré pasteur. Doté du verbe et de la parole de Dieu, il devait être envoyé quelques semaines plus tard à Marseille. Jean-Jacques-Caton traversa donc la France au cours de cette année qui avait vu la victoire de l’Empereur sur les champs de Friedland contre les Russes et la fin de la guerre de la Quatrième Coalition. Jean-Jacques-Caton prêcherait jusqu’en 1809 dans la cité phocéenne, essentiellement à une communauté protestante composée de Suisse et de Genevois[i].

Jean-Jacques-Caton Chenevière, 1820 [CIG Rig 0968]
En 1809, alors que le brasier de la guerre était à nouveau allumé en Europe entre l’Empire français et le reste du monde, Napoléon vainquait les Autrichiens à Wagram le 6 juillet. Jean-Jacques-Caton, quant à lui, s’en retournait à Genève. La Compagnie des pasteurs lui avait en effet demandé d’occuper la chaire de Dardagny dès la fin de l’année. Fort de son expérience méditerranéenne, il quittait une ville de centaines de milliers d’âmes, baignée de lumière, pour gagner un modeste village de la campagne genevoise.
Si c’était un jeune homme qui était jadis parti pour les lumières d’une ville cosmopolite, c’était un homme qui, deux ans plus tard, rentrait dans sa patrie. Déjà profondément habité par une vie spirituelle intense, et animé par la volonté de faire de la théologie une science, il allait progressivement jeter les bases de sa pensée en prônant une forme de supranaturalisme rationnel. Jean-Jacques-Caton, au demeurant, découvrait la Genève de 1809, plus ouverte qu’elle ne l’avait été au cours des années précédentes.
Le groupe de Coppet, réunissant intellectuels et écrivains était actif dans la diffusion des Lumières depuis des années, et la cité, dans un élan consensuel, avait rétabli dans ses traditions le vieil Exercice de l’Arquebuse dont le titre de roi avait été naguère porté par quelques-uns des aïeux de Jean-Jacques-Caton. Écarté de l’effervescence citadine, le jeune pasteur ne put se suffire d’un village éloigné bien longtemps, et il n’hésita pas lorsque proposition lui fut faite d’intégrer la loge maçonnique de “L’Union des cœurs” fondée à Genève en février 1768[ii]

Genève, la rue de Coutance et la place de Saint-Gervais, vers 1811, Christian Gottlieb [CIG 20P Cout 01]
Jean-Jacques-Caton en resterait membre toute sa vie. Il est indéniable que le pasteur Chenevière allait devenir rapidement l’un des piliers fondamentaux de la loge et participerait de près aux modifications apportées à ses rites[iii]. En 1812, il quittait enfin sa charge pastorale à Dardagny et s’installait à Genève. Il espérait être appelé à endosser une nouvelle fonction de pasteur, en ville cette fois, espoir qui ne se concrétiserait qu’en 1814.
C’est derrière les murs de la ville que Jean-Jacques-Caton allait déployer toute la mesure de sa pensée. Il réintégrait la cité à un moment clé de son histoire. La garnison française avait quitté Genève le 30 décembre 1813 et peu après les troupes autrichiennes du général Bubna y faisaient leur entrée. Et alors que l’Empire était passé sur les bords du Léman, Genève se dotait d’un gouvernement réactionnaire dirigé par l’ancien syndic Ami Lullin, lequel se dépêcha d’annoncer la restauration de la république d’Ancien régime. Genève devait alors entamer une remise en question et admettre un mariage de raison avec les cantons confédérés. Le premier juin 1814, un contingent de soldats suisses débarquait au Port noir, épisode bien connu de l’histoire genevoise ; spectacle haut en couleur annonçant le rattachement définitif de Genève à la Confédération le 19 mai 1815.
Enfant, alors que la révolution française changeait la face de l’Europe, ayant grandi dans une Genève vibrant aux accents de la Marseillaise avant d’être napoléonienne, Jean-Jacques-Caton ne devait pas voir d’un œil très amène le retour des prérogatives et des castes. Et lorsque le gouvernement Lullin proposa une nouvelle constitution conservatrice incluant le retour du suffrage censitaire, il prit une position ferme en signant avec quelques amis la pétition datée du 20 août 1814 demandant que soit reporté de quelques jours le vote sur le projet de Constitution[iv]. Et si Etienne Dumont en fut l’auteur, le texte allait être écrit de la main de Jean-Jacques Caton Cheneviere[v]. Ces notables espéraient infléchir suffisamment les magistrats pour que ces derniers renoncent au suffrage censitaire : parmi les réfractaires de l’ordre ancien, l’avocat Jean-François Rocca[vi], membre du conseil restreint en 1792 ; l’astronome Marc-Auguste Pictet[vii] ; Jean-Marc-Jules Pictet-Diodati, membre du conseil militaire[viii] ; le juriste-pasteur Etienne Dumont, un libéral républicain appelé par ses concitoyens à siéger dans le Conseil souverain en 1814 ; le médecin Louis Odier, membre du Conseil représentatif en 1814 ; l’économiste Jean Charles de Sismondi et l’avocat Pierre-François Bellot membre du Conseil représentatif en 1814. Malgré la résistance de ces esprits que l’on considérerait plus tard « éclairés », la nouvelle constitution qui ignorait la plupart des droits démocratiques acquis depuis 1789 était adoptée quelques jours plus tard[ix].
Cet épisode met en évidence les cercles que fréquentait Jean-Jacques-Caton dont les représentants, francs-maçons ou non-initiés, appartenaient aux élites intellectuelles de son temps. Des personnalités avec lesquelles le pasteur allait entretenir des échanges épistolaires soutenus des années durant[x]. C’est que Jean-Jacques-Caton s’était déjà fait connaître dans le giron des libre-penseur genevois en entamant une œuvre littéraire abondante ! Convaincant, doté d’une rhétorique sans faille et mu par des convictions théologiques affirmées, il devait être nommé très facilement en 1817 professeur de théologie dogmatique à l’Académie de Genève, fonction qu’il conserverait jusqu’en 1865. Du haut de la chaire du temple Saint-Pierre, il prononça cette année-là un discours inaugural qui laissait préfigurer qu’elle allait être son positionnement théologique. Le titre de sa harangue était à lui seul une gageure : Les causes qui retardent chez les réformés les progrès de la théologie.

Jean-Jacques-Caton [CIG]
Sa nomination intervenait dans un contexte de crise économique profonde entraînée par la chute du Premier Empire, générant des tensions sociales, et au lendemain du traité du 3 mai 1817 arrêté par la Vénérable Compagnie qui interdisait à tout pasteur de faire allusion à des dogmes « très controversés » tels que la Trinité ou encore la divinité du Christ, lors de leurs prédications et de leurs enseignements. Cette réaction forte à l’encontre du Réveil – mouvement religieux protestant en opposition au rationalisme des Lumières qui s’était répandu dans les Églises au cours du XVIIIe siècle – promu à Genève depuis 1810 par la Société des amis, devait inévitablement générer une controverse dans laquelle Jean-Jacques-Caton serait impliqué.
Adversaire du Réveil, qu’il accusait de déchirer le protestantisme genevois et faire le jeu du catholicisme, et agacé par l’ambiance délétère environnant le pastorat à Genève – ce d’autant plus qu’il était le maître à penser de la théologie dogmatique de la Vénérable Compagnie – Jean-Jacques-Caton se lança dans une œuvre littéraire destinée à asseoir sa pensée et à convaincre ses opposants.
En 1819, il faisait publier chez l’imprimeur Paschoud, à Paris, à la rue Mazarine où Jean-Jacques Paschoud possédait des presses, son livre qui reprenait le discours inaugural qu’il avait prononcé lors de sa nomination à l’Académie. Un ouvrage mordant à l’égard des zélateurs du Réveil qui serait réédité l’année suivante, entraînant de nouvelles réactions.
Respecté, aimé par les uns, craint et détesté par les autres, Jean-Jacques-Caton s’était ainsi attelé à la diffusion de ses idées en multipliant livres et opuscules dès sa nomination à la chaire de théologie dogmatique. En 1824, il faisait traduire et éditer à Londres, chez Smallfield, un précis des débats théologiques qui, depuis des années, agitaient la ville de Genève sous le titre « A summary of the theological controverses which of late years have agitated the city of Geneva, by J.J. Chenevière ».
L’homme était entêté, au faîte de son acuité intellectuelle. Nul ne s’était étonné lorsqu’en 1825, il avait été nommé recteur de l’Académie, charge qu’il devait occuper jusqu’en 1830, puis à deux autres reprises, de 1852 à 1854, et de 1856 à 1858. En lutte constante contre une orthodoxie calviniste fleurtant avec les milieux les plus conservateurs de la cité, Jean-Jacques Caton fondait en juin 1831 le journal « Le Protestant » de Genève en réponse à la Société Évangélique, émanation du Réveil ; une publication qui, sans être l’expression officielle de la Compagnie des pasteurs, devait soutenir les thèses de celle-ci et défendre une « religion de la liberté au nom du principe de la liberté religieuse »[xi]. Commencerait alors une guerre de tranchées faite d’encre et de plumes durant plusieurs années avec le journal catholique “La Sentinelle catholique”.
Le 5 janvier 1838, alors que des grèves avaient éclaté au cours des années précédentes contre le gouvernement conservateur, Jean-Jacques-Caton, s’exprimant comme orateur de la Vénérable Compagnie des pasteurs, prononçait un discours extrêmement critique devant le Conseil d’État, reprochant à ce dernier son attitude à l’égard de l’Église protestante et son favoritisme envers les catholiques. Sa harangue allait susciter l’ire du Premier Syndic Rieu qui l’interrompit de force et le renvoya séance tenante[xii]. Les autorités étaient d’autant plus agacées par l’activisme religieux mais également politique de Jean-Jacques-Caton que celui-ci avait été interdit de prêche dans son office de pasteur pour une période de six mois. La cité était en effet en proie à une polémique remontant à l’occupation napoléonienne portant sur le jeûne, un jeûne considéré comme un événement patriotique réaffirmant l’identité genevoise et protestante de la population à un moment de profondes tensions entre les autorités et les milieux populaires. Une ambiance compliquée donc, causée en partie par la décision de la Diète fédérale en 1832 qui avait décrété que le jeûne, célébré également en Suisse, se tiendrait dorénavant le troisième dimanche de septembre, entraînant la suppression du jeûne genevois. Et, en 1837, après cinq ans de critiques et de rebuffades, de nombreux protestants genevois s’étaient opposés à cette décision œcuménique et avaient décidé d’instaurer à nouveau le jeûne genevois le jeudi suivant le premier dimanche de septembre[xiii], attisant inévitablement les braises de la dispute entre conservateurs et libéraux, au point tel que Jean-Jacques-Caton, qui était monté illégalement en chaire pour le jeûne genevois cette année-là[xiv], avait dû intervenir auprès de ses partisans pour leur demander de mettre un terme à leur action[xv].
Des partisans d’ancienne date au demeurant puisque Jean-Jacques-Caton s’était attiré une grande sympathie au sein du quartier ouvrier de Saint-Gervais – un quartier qui se souvenait également de son père, Nicolas Chenevière, qui en avait été également le pasteur – en défiant les ordres du gouvernement au cours des années précédentes. James Fazy, en 1842, rappellerait ces événements dans le Nouvelliste Vaudois :
« Quoi qu’il en soit, ce vœu fut d’abord mal accueilli par l’ancien Conseil d’Etat ; il refusa pendant plusieurs années d’autoriser le service public qu’on réclamait pour cette fête. Vous vous souvenez qu’alors une fois, toutes les boutiques se fermèrent spontanément au retour de ce jeûne, et que le peuple afflua dans les temples pour entendre un pasteur courageux qui osa prêcher dans deux des principales églises de Genève. Ce pasteur était M. Chenevière, il souffrit cruellement de cet acte de dévouement ; il fut suspendu pendant six mois par arrêté du Conseil d’Etat »[xvi]
En 1838, l’atmosphère était donc explosive et la suspension dont Jean-Jacques-Caton était victime devait créer au sein de ses ouailles un profond sentiment d’injustice. Si bien que le 22 avril 1838, lorsque le pasteur put enfin revenir en chaire et prononcer son premier sermon à l’église de Saint-Gervais depuis « la suspension arbitraire dont il a été victime »[xvii], un grand nombre de personnes devaient l’attendre ce jour-là devant son domicile. La foule allait l’accompagner jusqu’au temple où se bousculaient des centaines de fidèles impatients de l’entendre. Après le sermon, plus de mille personnes du faubourg Saint-Gervais lui emboîtèrent encore le pas jusqu’au pont de l’Ile où cinq cents personnes supplémentaires l’attendaient pour l’acclamer[xviii].
« En résumant toute la question du jeûne dans la personne de M. le pasteur Chenevière, le pouvoir en a fait une question de liberté religieuse unie à celle de la liberté politique, digne drapeau d’une noble nationalité »[xix].
Les passions n’en restèrent toutefois pas là ! Car si Jean-Jacques-Caton put monter en chaire pour célébrer le jeûne cette année-là ainsi que les trois années suivantes, tel ne serait pas le cas en 1842. Une émeute avait éclaté en novembre 1841 soutenant le mouvement révolutionnaire de l’Association du Trois-Mars qui réclamait un nouveau gouvernement. L’association avait en l’occurrence obtenu l’élection d’une assemblée constituante qui allait rédiger la Constitution du 7 juin 1842 prévoyant, notamment, le suffrage universel masculin. Le suffrage censitaire qui garantissait le monopole du pouvoir à une élite aristocratique et bourgeoise disparaissait. La révolution était en marche !
Et, deux mois plus tard, lorsque la Vénérable Compagnie mit au vote les noms des pasteurs devant assurer le prêche du jeûne du mois de septembre, Jean-Jacques-Caton fut exclu, certains pasteurs n’étant guère favorables aux mutations profondes que Genève était en train de vivre et que Jean-Jacques-Caton soutenait. La décision de la Vénérable Compagnie fit scandale dans la presse, enflant de semaine en semaine lorsque les paroissiens de Saint-Gervais déposèrent au mois d’août une pétition pour lui permettre de prêcher[xx]. Pourtant, Jean-Jacques-Caton s’en tint à l’interdit dont il était frappé, l’opportunité pour lui de s’expliquer de la situation dans une lettre ouverte dénonçant les foudres de la Compagnie qu’il encourait, étant trop belle[xxi].
La situation de Jean-Jacques-Caton, tout en délicatesse à l’égard de la Compagnie des pasteurs, ne devait pas perdurer très longtemps. En octobre 1846, lorsque le gouvernement genevois refusa de soutenir à la Diète fédérale la dissolution du Sonderbund, les révolutionnaires radicaux du quartier ouvrier de Saint-Gervais se soulevèrent. Des barricades furent dressées pour empêcher les troupes de la milice de pénétrer plus avant dans le fief radical. Et le 7 octobre 1846, deux pièces d’artillerie étaient mises en batterie pour abattre les obstacles. Les affrontements allaient faire plus de vingt morts à la fin de la journée et aboutir à l’échec des troupe gouvernementales. Refusant de voir plus de sang versé, le Conseil d’État décida alors de démissionner, laissant à James Fazy la liberté d’entrer dans l’Hôtel de Ville et de constituer un nouveau gouvernement. Le conservatisme dont Jean-Jacques-Caton faisait les frais était battu en brèche !
Âgé de soixante-trois ans, Jean-Jacques-Caton, celui que l’on nommerait bientôt le pasteur radical, l’ami particulier de James Fazy[xxii], suivit bien évidemment avec attention les événements, accueillant avec satisfaction la victoire des Radicaux mais avec plus de circonspection la nouvelle constitution de 1847 qui supprimait le caractère dominant du protestantisme.
Fatigué, il n’officierait plus très longtemps comme pasteur puisqu’il se retira en 1851 tout en conservant sa chaire de théologie dogmatique jusqu’en 1865. Il allait par-dessus tout continuer à jouer un rôle de conseiller avisé auprès d’un grand nombre de personnes en entretenant une correspondance épistolaire substantielle[xxiii]. Le cercle de ses correspondants s’était en effet progressivement élargi avec les années, intégrant des personnalités du monde entier appartenant aux milieux les plus divers, allant du simple fidèle à des princes régnants. Jean-Jacques-Caton échangerait ainsi quelques 53 lettres avec le Conseiller d’État radical vaudois Henri Druey de 1845 à 1851, le Genevois soutenant le Vaudois dans le conflit entre l’Église et l’Etat entraîné par la nouvelle loi d’organisation ecclésiastique supprimant la confession de foi helvétique et subordonnant l’Église à l’État conçue par Druey[xxiv]. Au cours de l’année 1846, Jean-Jacques-Caton devait également entamer une correspondance avec le prince Charles de Linange de la lignée des Leiningen-Dagsburg-Hartenburg[xxv] et, indirectement, avec le Premier ministre britannique Lord Palmerston[xxvi].
Référence religieuse internationale, correspondant des puissants de son temps, populaire, influenceur politique et franc-maçon, Jean-Jacques-Caton Chenevière, mettait un terme à sa fonction de recteur en 1858, prolongeant son enseignement de théologie dogmatique jusqu’en 1865. Celui qui était né en 1783 du temps des Magnifiques Seigneurs syndics devait encore voir la mutation profonde de la cité entreprise à la suite de la révolution fazyste, avec la destruction ô combien symbolique des fortifications, et l’édification de nouveaux quartiers au Tranchées et aux Pâquis ainsi que de la gare Cornavin en 1858. Il assisterait ainsi à l’entrée à Genève de la première ligne de chemin de fer mais aussi au durcissement de la politique contre l’église avec l’arrivée à la tête du Parti radical d’Antoine Carteret qui succédait à James Fazy en 1865 et qui, en plein Kulturkampf, allait faire voter des lois anticléricales. Tout en réfutant la dogmatique traditionnaliste calviniste, Jean-Jacques-Caton Chenevière serait avec David-François Munier (1798-1872) l’un des pasteurs les plus brillants du XIXe siècle genevois[xxvii]. Il devait s’éteindre paisiblement le 5 février 1871.
[i] Cinq siècles de protestantisme à Marseille et en Provence, Actes du Colloque tenu à Marseille (Mai 1976), Église réformée de Marseille et Fédération de Provence, Archives départementales, Marseille.
[ii] Collection de fac-similés 1578-2003 / SÉRIE 10 Facs 13 / L’Union des Coeurs 1804-1815 : Archives de la loge maçonnique de Genève et de la chapelle / CH BGE Facs 1-109.
[iii] Jean-Michel Monod, “Approche de la Franc-Maçonnerie genevoise /1786-1865)”, mémoire de licence présenté à la Faculté des Lettres de l’Université de Genève, 1976.
[iv] Très-humble et très-respectueuse pétition adressée à nos très-honorés Seigneurs les Syndics et Conseil-provisoire [sic] : Très-honorés Seigneurs, instruits du…, BGE.
[v] Francois Ruchon, Histoire politique de Genève 1813-1907. Genève, Jullien, 1953, et W. Rappard, Avènement de la démocratie moderne à Genève 1814-1847, Genève, Jullien, 1942.
[vi] Edouard Burnet, Le premier tribunal révolutionnaire genevois, juillet-août 1794, études critiques, Julien, Genève, 1925.
[vii] Marc-Auguste Pictet était un modéré. Élu en 1782 au Conseil des Deux-Cents, il en démissionna face à un conservatisme ambient qu’il ne cautionnait pas. Il allait être élu en 1793 à l’Assemblée nationale dont il démissionna également en raison des abus du jacobinisme. Membre du tribunal durant le Consulat, il serait encore nommé inspecteur général de l’instruction publique en 1807 et inspecteur général de l’Université impériale l’année suivante. En 1815, il fut l’un des fondateurs de la Société Helvétique des Sciences naturelles.
[viii] Notice sur feu M. Pictet-Diodati, membre du conseil représentatif de Genève, 1832.
[ix] La Constitution de 1814 supprimait l’antique Conseil général des citoyens et concentrait les pouvoirs entre les mains d’un Conseil d’Etat de 25 membres, avec un Conseil représentatif aux attributions limitées permis aux seuls citoyens disposant d’un revenu élevé.
[x] Collection de fac-similés 1578-2003 / SÉRIE 2 Facs 2-3 Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi 1797-1842 2 / CH BGE Facs 1-109 ; Facs 19, f. 83-106 Correspondance adressée à Etienne Dumont/ CH BGE Facs 1-109
[xi] Olivier Fatio, éd., Genève protestante en 1831, Actes du colloque tenu en commémoration des 150 ans de la création de la Société évangélique de Genève et de la parution du journal Le Protestant de Genève, Labor. et Fides, Genève, 1983.
[xii] Jean-Jacques-Caton Chenevière. Discours prononcé, en partie, en janvier 1838, en présence du Conseil d’Etat / par M. Chenevière, pasteur et professeur, parlant comme orateur de la Vénérable Compagnie, Lausanne : Samuel Delisle, 1838.
[xiii] Olivier Fatio, « Jeûne genevois, réalité et mythe », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, tome 14, 1971, p. 391-435.
[xiv] Jean-Jacques-Caton Chenevière, La puissance des souvenirs : sermon prêché à Genève au Jeûne improvisé, à la demande du troupeau, le 7 septembre 1837, E. Carey, Genève, 1837.
[xv] Jean-Jacques-Caton Chenevière, La lettre suivante, adressée jeudi 12 octobre aux rédacteurs d’une adresse au Conseil d’Etat, Genève, 1837.
[xvi] Journal de Genève, 14.09.1842.
[xvii] Journal de Genève, 21.04. 1838, p. 1.
[xviii] Journal de Genève, 25.04.1838, p. 1.
[xix] Journal de Genève, 28.04.1838, p. 1
[xx] Elie Couriard, De la pétition pour faire prêcher Mr Chenevière, Genève, 1842. Journal de Genève, 30.08.1842, p. 2
[xxi] Jean-Jacques-Caton Chenevière, Lettre de M. le pasteur et professeur Chenevière sur un incident du Jeûne de 1842, Genève : chez les principaux libraires et dans les cabinets littéraires, 1842
[xxii] Journal de Genève, 30.10.1849, p. 2.
[xxiii] Papiers Chenevière 1631 – 1989 CH BGE Ms. fr. 5864 Jean-Jacques-Caton Chenevière (1783-1871), 10 enveloppes dans 1 carton: Correspondance, textes autographes et documents divers Personne(s) : Chenevière, Jean-Jacques-Caton
[xxiv] Bernard Reymond, « Un document, la correspondance entre Henri Druey et Jean-Jacques-Caton Chenevière : (1845-1851) », Revue historique vaudoise (1984), p. 73-222.
[xxv] Marc Chenevière, « En marge du Sonderbund : une correspondance inédite entre le prince Charles de Linange et le professeur genevois Jean-Jacques-Caton Chenevière », Revue suisse d’histoire 40/4 (1990), p. 434-441.
[xxvi] Correspondance, Jean-Jacques Caton, archives du prince Albert, château de Windsor.
[xxvii] Sarah Scholl, En quête d’une modernité religieuse. La création de l’Église catholique-chrétienne de Genève au cœur du Kulturkampf (1870-1907), Alphil, 2012. Simon Butticaz, Christian Grosse (éd.), Unité et diversité des Réformes. Du XVIe siècle à aujourd’hui, Genève, Labor et Fides, 2018. Sarah Scholl, « Gestion du religieux et construction de l’État moderne. Les hésitations du XIXe siècle au prisme de l’expérience suisse », Histoire, monde et cultures religieuses, 2017/3 (n° 43), p. 65-78.