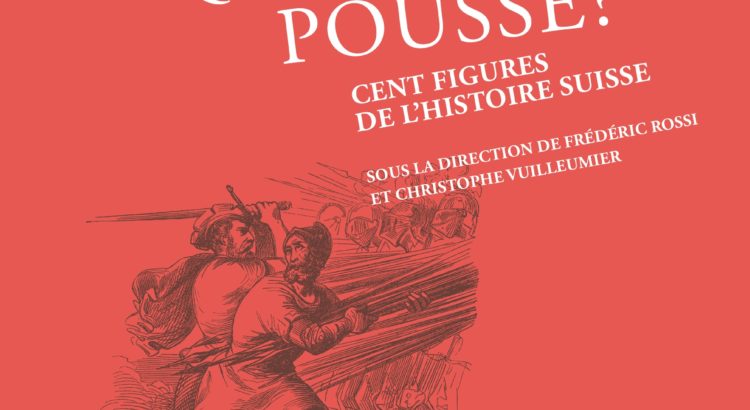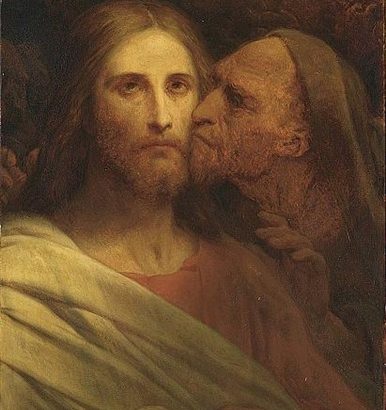Si le coronavirus fait trembler le monde sous l’effet catalyseur des medias, alors même que son taux de mortalité semble osciller à moins de 1% selon les médecins, il ne peut guère être comparé à l’épidémie de grippe espagnole de 1918 autrement plus meurtrière ! Quelles furent les conséquences de cette dernière à Genève ?
Au début du XXe siècle, les maladies épidémiques « historiques » comme le choléra ou le typhus étaient encore fréquentes en Europe, mais si les fléaux se succédaient, la Suisse restait largement épargnée. En 1910, le choléra s’était répandu dans le monde comme une traînée de poudre, causant des dizaines de morts en Italie, et près de 80’000 victimes dans l’ancien Empire allemand. La Turquie, l’Empire austro-hongrois, le Yémen, l’Égypte, le choléra était alors partout, ne cédant sa place qu’en Manchourie où la peste pulmonaire faisait des ravages. En 1911, l’Espagne était touchée à son tour par le choléra, entraînant l’exode de centaines de familles dans le sud de la France, avant de voir l’apparition d’un nouveau fléau, le typhus, qui allait frapper près de 2’500 personne en l’espace de quelques jours. Le typhus devait également se répandre en Suisse mais de manière plus modeste parmi les ouvriers du tunnel du Lötschberg, ainsi qu’à Hérémence, dans le cœur du Valais.
En 1912, l’Occident réagissait enfin. Plusieurs pays organisèrent en janvier une conférence sanitaire internationale à Paris. Une convention devait être signée sur la base du rapport du docteur Calmette, alors directeur de l’Institut Pasteur à Lille, réglant les mesures sanitaires afin d’enrailler les propagations, plus particulièrement de trois maladies pestilentielles : la peste, le choléra et la fièvre jaune. La Suisse, quant à elle, devait mettre une année de plus à consolider son système sanitaire. Le peuple allait ainsi devoir se prononcer sur un nouvel article constitutionnel concernant la lutte contre la maladie et les épizooties donnant à la Confédération la possibilité de légiférer de manière centrale sur les mesures de police sanitaire à prendre contre les maladies transmissibles. Des dispositions communes à l’ensemble du pays pourraient dès lors être envisagées pour lutter contre des affections. L’attention portée à la santé de la population venait de passer un nouveau cap !
Et si le conflit qui éclata en 1914 estompa les craintes liées aux épidémies, la crise de la Grippe espagnole replaça abruptement le sujet sur le devant de la scène.
Alors que la guerre avait bouleversé l’Europe, suivie par les déplacements de populations, de soldats démobilisés, de blessés, de prisonniers et de réfugiés entraînant le désordre et la confusion à travers le continent, le nouveau fléau devait tuer près de cinquante millions de personnes, agonisant dans de fortes fièvres entraînées par des pneumonies ou des surinfections bronchiques bactériennes. Cinquante millions de morts en quelques mois à peine, alors que la guerre avait tué près de dix-neuf millions de personnes en quatre ans[1] (Cette estimation réalisée par l’institut Pasteur a depuis lors été réactualisée par de nouvelles recherches démontrant que ce serait près de 100 millions de personnes que l’épidémie aurait tué à travers le monde).
Originaire d’Asie ou des Etats-Unis, les spécialistes se perdent en conjectures, l’épidémie qui aurait débuté au printemps 1918 allait toucher la Suisse en deux vagues, infectant quelques deux millions de personnes et entraînant le décès de 24’449 personnes entre juillet 1918 et juin 1919. Plus meurtrière que la Première Guerre mondiale, cette épidémie, considérée comme la pire catastrophe démographique du XXe siècle, devait générer de multiples réactions dans les différentes régions suisses.
Genève, à la fin de l’année 1918, attendait la fin de la guerre. Lieu de passage par où transitaient des blessés rapatriés et des militaires étrangers internés, la cité abritait également une communauté étrangère importante faite de déserteurs, quelques 7’000 en 1917, et d’un milieu plus ou moins interlope se fondant au sein de la population. La ville connaissait par ailleurs une situation économique difficile, comme dans presque l’ensemble du pays, provoquant des tiraillements politiques intenses et des craintes de plus en plus fortes portant sur les syndicalistes et les communistes.
Mais le canton devait être confronté à un défi autrement plus lourd, notamment à l’égard de ses capacités sanitaires, à la fin de l’année 1918. Alors que l’armistice résonnait aux clochers de toutes les églises du Vieux Continent le 11 novembre, l’épidémie la plus dramatique que l’Europe avait connu depuis la peste noire de 1348, la Grippe espagnole, débutée dès le mois de juillet prenait de l’ampleur au courant de l’automne. Au cœur de l’été, le 6 juillet, 500 personnes atteintes de grippe avaient déjà été hospitalisées à Genève entraînant une vague de solidarité au sein de la population. Une campagne de dons avait ainsi été levée au cours de ce mois alors que l’automobile-club demandait quant à lui que les propriétaires de voiture puissent mettre ces dernières à la disposition des médecins avec un chauffeur[2]. D’autres encore, profitèrent de cette épidémie pour développer des médicaments de fortune et gagner de l’argent.
Pour faire face à la monté en puissance de l’épidémie, dont les autorités ne mesurèrent que tardivement la portée, la Commission sanitaire genevoise, au cours de l’automne, devait proposer au Conseil d’État de fermer les écoles, d’interdire les spectacles et les cinémas ainsi que les réunions publiques, et d’autoriser les cultes sous certaines conditions. Si le phénomène n’était pas fondamentalement nouveau – certains vieux médecins, comme Henri-Clermont Lombard, se souvenant des épidémies de grippes estivales de 1831 et 1837, ou encore de 1847 qui avaient touché le tiers de la population genevoise et tué de très nombreuses personnes[3] – personne, pourtant, ne se doutait alors de l’ampleur de cette nouvelle crise.
Les chiffres relevés dans les registres de décès portant sur l’année 1918 et 1919 font écho à cette montée en puissance. On relève en effet une intensification du nombre de morts à partir de l’automne 18. On recense ainsi quelques 2’490 décès entre septembre 1918 et mars 1919, soit plus de 26 morts pour 1’000 personnes, alors que la moyenne du taux brut de décès pour l’ensemble du pays pour ce même intervalle de temps était, selon l’Office fédéral des statistiques, de 23 morts pour 1000[4] (Pour rappel, ce taux de mortalité se monte en 2017 à Genève à 6,8 pour 1000). Une mortalité donc plus importante que les années précédentes et suivantes, inhérente à l’épidémie, et une caractéristique genevoise avec son taux plus élevé que dans le reste du pays, vraisemblablement causée par la concentration de population dans la cité. Certains quartiers furent-ils plus touchés que d’autres ? Difficile de répondre à cette question mais il apparaît que la plupart des décès se déroulèrent au sein de l’hôpital cantonal, lequel devait rapidement être saturé par le nombre de patients.

Aussi, dès le mois de septembre, les autorités cantonales sollicitèrent l’armée afin de pouvoir utiliser la caserne des Vernets pour y installer une partie des « grippés ». L’état-major allait toutefois refuser de se passer de ses bâtiments, craignant de devoir héberger des soldats atteints par l’épidémie. La sollicitation de l’hôpital cantonal qui souhaitait le retour des médecins mobilisés pour lutter contre l’épidémie, allait être tout autant refusée.
Les besoins de la population étaient pourtant criants. Le service d’hygiène genevois recensait ainsi quatre-vingt-trois nouveaux cas le 3 octobre. Dépassé par les événements, l’hôpital cantonal qui enregistrait dans son personnel des victimes, tel le chef de clinique Henry D’Arcis[5], dut se résoudre à prendre des mesures drastiques. Ne disposant pas de suffisamment de lits, on utilisa les corridors pour y loger les malades, mais malgré les solutions de fortunes développées par les médecins, la situation allait tourner au drame, emportant des familles entières comme les Babel qui perdirent cinq de leurs membres au cours de l’hiver 1918, ou les Baud dont huit membres décédèrent entre octobre et novembre 1918. La crise était telle que le service du téléphone fut interrompu entre midi et deux heures, ainsi qu’entre six heures et huit heures du soir, quarante employés sur cent étant alors malades. Le 18 octobre, le service d’hygiène dénombrait trois-cent cinquante nouveaux cas de grippe. Et à la fin du mois, Genève comptait 10’189 cas de grippe espagnole[6], soit environ 7% de sa population. Genève voyait alors près de 160’000 habitants[7].
Faute de place, les autorités ne tardèrent pas à demander aux médecins de n’hospitaliser que les cas les plus graves, laissant les autres entre les mains du hasard. La crise de la Grippe espagnole mettait ainsi en lumière de manière cruelle le manque de place qui régnait au sein de l’hôpital[8].

On pourrait s’étonner que les structures qui avaient servi à l’accueil des blessés de guerre les mois précédents, notamment au Grand-Lancy et à Pregny qui pourtant avaient accueilli plusieurs centaines de soldats étrangers[9], ne furent pas réutilisées lors de cette épidémie. Faute de documents ou d’archives à cet égard, on ne peut que se perdre en conjectures et estimer que la nature de la crise autant que l’absence de financement, lesquels avaient été assurés par les nations étrangères lors de l’internement des soldats français et allemands, n’avaient pas permis ce recours.
Quelles furent les conséquences de l’épidémie ?
Palliant le manque de places dans les cliniques et l’hôpital, les infirmières visiteuses de la Croix-Rouge autant que le service de ville de Marguerite Champendal œuvrèrent sans relâche au chevet des malades, recrutant d’aventure les bonnes volontés qui se proposaient spontanément.
Dans une Genève traumatisée par la pandémie et ayant abrité deux ans durant des soldats étrangers blessés hors des cadres hospitaliers, des mesures concrètes ne devaient pas tarder. Le 15 janvier 1920, après de multiples séances menées par le docteur Frédéric Guyot, président de la section genevoise de la Croix-Rouge, celle-ci instituait le dispensaire d’hygiène sociale, à la rue des Corps-Saints, devant soutenir les efforts des trois infirmières-visiteuses fonctionnant depuis 1893. Œuvrant tant au sein du dispensaire qu’à domicile, les trois infirmières allaient dans un premier temps enseigner l’hygiène et la propreté, développant des trésors de prévention et secondant les médecins leurs de leurs consultations gratuites auprès de la population (Dans la seconde partie du XXe siècle, le dispensaire de 1920 après avoir subi plusieurs évolutions devenait le SASCOM et intégrait la Fondation des services d’aide et de soins à domicile, devenue en 2013 l’Institution genevoise de maintien à domicile, plus connue sous le nom d’Imad, l’un des piliers fondamentaux actuel de la politique socio-sanitaire du canton).
Par ailleurs, le Conseil fédéral allait promulguer un arrêté, le 18 juin 1920, créant un service sanitaire aux frontières dépendant de l’armée destiné à « dépister les malades ou les suspects et de les signaler aux services d’hygiène cantonaux qui doivent à leur tour prendre des dispositions pour empêcher la propagation des épidémies dans l’intérieur du pays »[10].
L’épidémie avait provoqué une prise de conscience au sein des autorités, mais également un choc psychologique durable.
En septembre 1940, alors qu’une nouvelle guerre faisait rage en Europe, le Conseil fédéral, dont les membres avaient tous vécu l’épisode de la Grippe espagnole 21 ans auparavant, avait ainsi encore renforcé son dispositif sanitaire aux frontières dans le but d’empêcher la pénétration des maladies contagieuses en Suisse. Une angoisse d’autant plus grande que le spectre de la grippe espagnole et des épidémies était rappelé par la presse qui rapportait régulièrement à l’attention des lecteurs les foyers de maladies infectieuses en Europe et dans le monde.
Ainsi, la Gazette de Lausanne écrivait dans ses colonnes, en 1933, que le typhus avait tué quelques 12’000 personnes en Sibérie, suivi quelques mois plus tard par une épidémie de peste bubonique en Mandchourie emportant 600 personnes. En février 1935, ce journal indiquait encore que la grippe avait causé la mort d’une centaine de personnes à Saragosse. En janvier 1937, la presse allait revenir sur la grippe, signalant que les foyers principaux se trouvaient en Allemagne, en Angleterre, au Danemark et aux Pays-Bas, précisant par ailleurs que le Reich avait enregistré plus de 500 morts. En 1938, c’est à nouveau d’une épidémie de typhus dont il est question, qui se développe alors en Angleterre.
La crainte de la contagion était ainsi une réalité dans la Suisse des années 40. Au sein même du Conseil des États, certains parlementaires s’étaient inquiétés de la situation sanitaire de la Confédération, notamment eu égard au rationnement alimentaire de la population et des épidémies qui pouvaient en découler. Une peur qui allait être instrumentalisée dans le cadre de la politique menée sur la problématique des réfugiés. En 1942, l’un des arguments mit en avant par les autorités fédérales, et plus particulièrement par Éduard von Steiger pour fermer les frontières, serait en effet le danger de propagation de maladies contagieuses susceptibles d’être portées par des populations indigentes.
[1] Voir Johnson N.P., Mueller J. « Updating the accounts: global mortality of the 1918-1920 “Spanish” influenza pandemic. », Bull Hist Med., printemps 2002, 76(1), p. 105-15. Hervé de Weck, «Avril 1918 – février 1919, la grippe espagnole a tué plus que la guerre!», in Bulletin de la Société jurassienne des officiers février 2009, p. 39-41.
[2] Journal de Genève, 26 juillet 1918.
[3] Journal de Genève, 12 juillet 1918.
[4] https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/mortalite.html
[5] Journal de Genève, 13 août 1918.
[6] Journal de Genève, 27 septembre 1918, p. 2 / 3 octobre 1918, p. 2 / 8 octobre 1918, p. 2 / 22 octobre 1918, p. 2 / 22 novembre 1918, p. 2.
[7] Voir Recensement fédéral de la population, 1er décembre 1960, 9ème volume, canton de Genève, Berne, 1963.
[8] Archives de l’Hôpital universitaire du canton de Genève, Commission administrative de l’hôpital cantonal de Genève, PV, No 8, 1917-1922, fo. 43 / fo 46 / fo 60.
[9] Champel 192 / Genève 1690 / Grand-Lancy 160 / Pregny 188 / Troinex 10 / Veyrier 82
[10] Journal de Genève, 3 mars 1942.






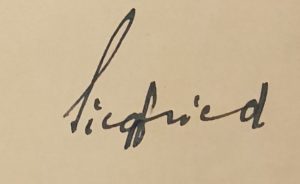



 Cet arpenteur de hiéroglyphes, successeur lointain du mythique Édouard Naville, illustre avec rigueur et chaleur l’école genevoise d’égyptologie qu’il a mené vingt ans durant. À la retraite depuis quelques années, sans que le temps n’ait visiblement de prise sur lui, notre pharaon genevois vient d’être glorifié d’un livre réalisé en son honneur. Deux de ses anciens étudiants, Sandrine Vuilleumier et Pierre Meyrat, ont sacrifié à la coutume académique des Mélanges, en réunissant dans cet ouvrage les contributions de quelques vingt-sept égyptologues internationaux ayant travaillé avec le professeur genevois, déclinant à l’envi des thématiques portant sur des papyrus, des textes médicaux, de la céramique, des pyramides ou de l’archéozoologie…
Cet arpenteur de hiéroglyphes, successeur lointain du mythique Édouard Naville, illustre avec rigueur et chaleur l’école genevoise d’égyptologie qu’il a mené vingt ans durant. À la retraite depuis quelques années, sans que le temps n’ait visiblement de prise sur lui, notre pharaon genevois vient d’être glorifié d’un livre réalisé en son honneur. Deux de ses anciens étudiants, Sandrine Vuilleumier et Pierre Meyrat, ont sacrifié à la coutume académique des Mélanges, en réunissant dans cet ouvrage les contributions de quelques vingt-sept égyptologues internationaux ayant travaillé avec le professeur genevois, déclinant à l’envi des thématiques portant sur des papyrus, des textes médicaux, de la céramique, des pyramides ou de l’archéozoologie…