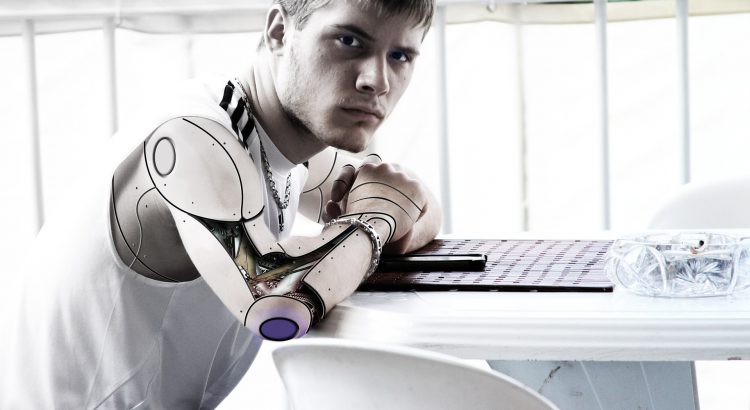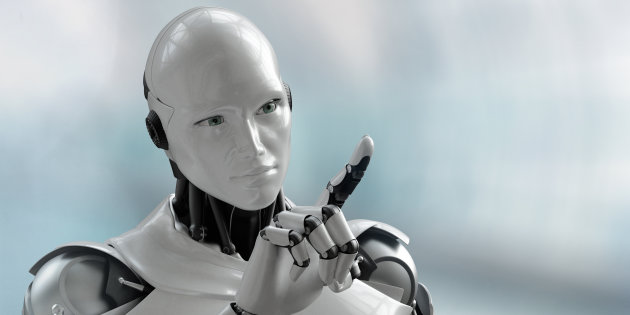L’initiative populaire pour des multinationales responsables veut modifier la Constitution fédérale pour faire en sorte que la Confédération suisse prenne des mesures légales en vue d’assurer le respect des droits humains et la protection de l’environnement par les grandes entreprises transnationales.
Ces dispositions légales ne vont pas s’appliquer aux petites et moyennes entreprises, qui en réalité pourront en retirer des bénéfices dans la mesure où elles ne devront plus faire face à la concurrence déloyale des multinationales qui en l’état ne respectent pas les droits humains ou nuisent à l’environnement.
Cette initiative populaire s’appliquera notamment aux multinationales qui ont leur siège légal, l’administration centrale ou le centre de leurs activités en Suisse. Elle les oblige à respecter aussi dans le reste du monde les droits humains et les normes pour la protection de l’environnement qui s’appliquent au niveau international, assumant aussi leur propre responsabilité pour les sociétés qu’elles contrôlent dans le monde entier.
Dans sa prise de position du mois passé, le Conseil fédéral reconnaît que la violation des droits humains par les entreprises multinationales ayant leur siège en Suisse est un problème pour la Suisse et le monde entier. Le message du Conseil fédéral daté du 15 septembre 2017 remarque aussi le fait que la pollution affecte de manière négative les animaux ainsi que les êtres humains. Le Conseil fédéral partage donc les objectifs de l’initiative pour des multinationales responsables, reconnaissant la nécessité d’agir en faveur des droits humains et de la protection de l’environnement en ce qui concerne le système économique.
Cependant, le Conseil fédéral se rallie à la doctrine néolibérale par son appel à refuser l’initiative populaire pour des multinationales responsables. Ce faisant, il ignore que des pays comme la France et le Royaume-Uni ont récemment adopté des lois qui vont dans le même sens que cette initiative populaire.
En brandissant la menace des délocalisations à l’étranger des entreprises établies en Suisse si l’initiative pour des multinationales responsables est acceptée par le peuple, le Conseil fédéral s’inscrit en porte-à-faux par rapport à l’évolution des bases légales dans les pays européens. Il n’est pas possible de s’en tenir à la liberté économique pour faire en sorte que les entreprises multinationales en Suisse respectent de manière volontaire les droits humains et l’environnement. Il faut adopter les «meilleures pratiques» au plan international afin d’assurer le développement durable de l’économie globale. L’initiative pour des multinationales responsables fait justement les intérêts de long terme de la place économique suisse et renforce la réputation de la Suisse au niveau mondial.