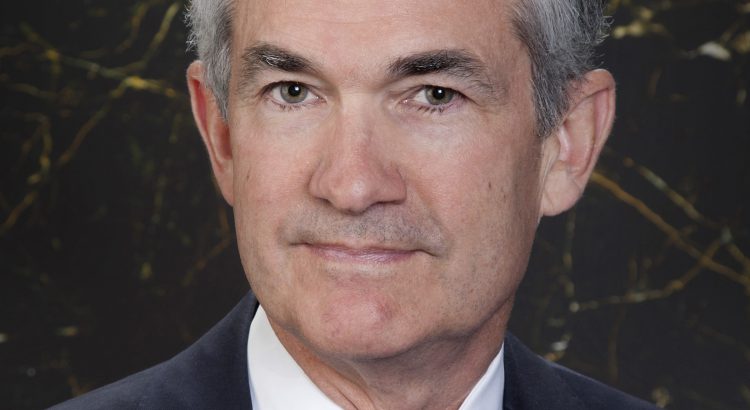Lors d’une interview parue récemment, Luigi Pasinetti (professeur émérite d’analyse économique à l’Université catholique de Milan) a expliqué clairement les problèmes fondamentaux de la pensée économique dominante. La soi-disant “science économique” est, en réalité, un amalgame parascientifique, duquel les approches alternatives à la pensée dominante ont été exclues de manière subreptice, afin d’empêcher une vision différente de celle du libre marché en tant que solution à n’importe quel problème d’ordre socio-économique.
Dans son interview, Pasinetti a bien expliqué la fragilité de la “science économique” de nos jours et a aussi mis en lumière l’ignorance des économistes de la pensée dominante qui ont exclu toute forme de pluralisme, ouverture et confrontation sur le plan scientifique avec toute école de pensée alternative à celle dominante sur le plan académique et politique. Cette situation est clairement visible, en Italie comme ailleurs dans le monde académique, lorsqu’on considère les critères pour la sélection et l’évaluation des candidat-e-s aux postes de professeurs universitaires en économie. Ces critères sont basés seulement sur la pensée dominante, même si celle-ci est de plus en plus critiquée d’un point de vue conceptuel, méthodologique, théorique et empirique, surtout durant les dix dernières années, entendez après l’éclatement de la crise financière globale induite par la pensée dominante en économie.
Dans les facultés d’économie, en effet, et désormais aussi auprès des institutions qui financent les projets de recherche en “science économique”, on remarque la tendance à évaluer les dossiers de candidature sur la base des revues scientifiques dans lesquelles les candidat-e-s ont publié les résultats de leurs propres recherches – au lieu de lire leurs publications pour sélectionner et évaluer les meilleur-e-s candidat-e-s. Il existe en réalité des classements de revues scientifiques qui sont utilisés comme critère principal (voire unique) pour ce processus de sélection. Or, le problème à cet égard est lié au fait que ces classements discriminent lourdement les revues qui acceptent de publier des travaux de recherche s’inscrivant dans des paradigmes différents de la pensée dominante.
Cela induit la très large majorité des économistes sur le plan académique, surtout celles et ceux qui visent à être promus au rang de professeur, à éviter les paradigmes alternatifs à la pensée dominante afin de ne pas porter atteinte à leur propre carrière académique.
En l’état, la situation sur ce plan s’est tellement dégradée que les jeunes professeurs ignorent les approches alternatives à la pensée dominante et, de ce fait, répètent dans leurs propres cours ce qui leur avait été inculqué par leurs prédécesseurs sans aucune connaissance pluraliste en histoire de la pensée économique.
Dans la mesure où cette situation hégémonique va persister, la “science économique” restera dans une crise profonde et, avec elle, l’économie mondiale ne pourra pas contribuer au bien commun. Comme l’avait déjà fait remarquer J.M. Keynes, les idées des économistes (soient-elles justes ou fausses) façonnent le monde entier.