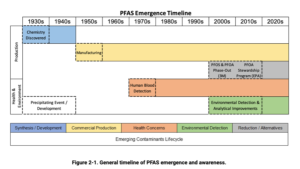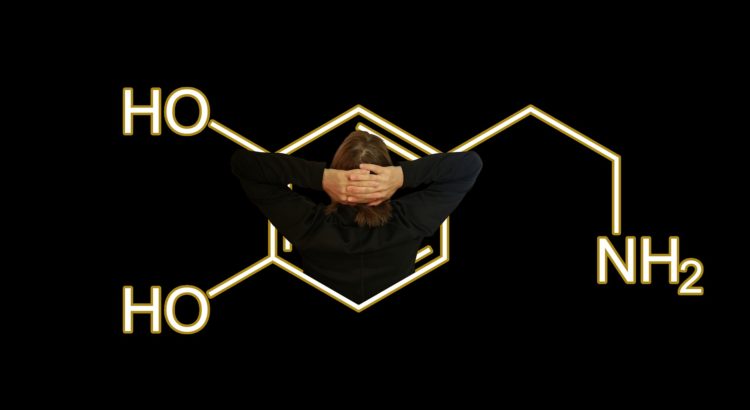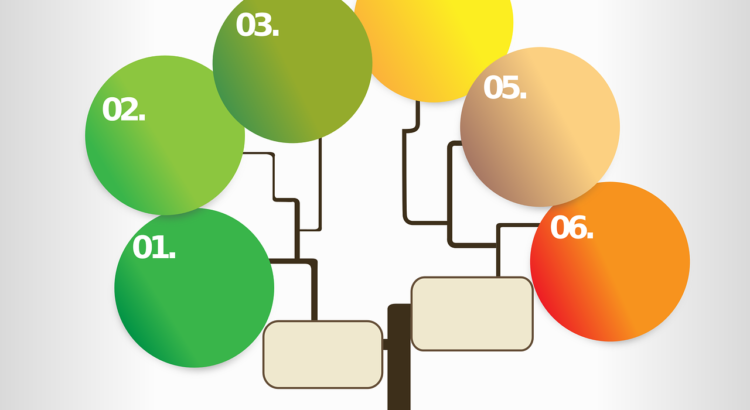Je ne vais pas faire durer le suspense…ceci sera mon dernier article après presque 4 ans de rendez-vous réguliers.
Une certaine lassitude? Je dois avouer que oui.
Malgré vos nombreux commentaires toujours intéressants et pertinents, souvent encourageants, j’ai souvent l’impression de mettre en évidence des problématiques pour lesquelles il y a peu de volonté de changer les choses.
Pire, depuis un an et demi, le nez dans le guidon, on recule sur de nombreux points qui semblaient acquis en terme de risque des polluants.
Comme celui des biocides.
Encore récemment, des auteurs américains ont alerté sur l’utilisation d’ammoniums quaternaires, des bactéricides, dans les désinfectants utilisés maintenant au quotidien, ainsi que sur l’administration systématique d’antibiotiques aux malades atteints du covid-19, ceci malgré l’absence de signes d’infections bactériennes. Selon eux, cela va augmenter le risque de développement de résistances bactériennes dans les prochaines années.
Or selon l’OMS, “la résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement”.
Toute femme qui a déjà eu une infection urinaire en a peut-être fait l’expérience. Si il suffisait de prendre un antibiotique il y a 20 ans, il arrive maintenant qu’on doive en changer en cours de traitement. Et les médecins doivent parfois faire des cultures pour déterminer la souche de bactérie responsable et vérifier sa résistance à l’antibiotique choisi.
Dans l’environnement aussi, la question de la résistance aux antibiotiques se pose. Car ces mêmes substances biocides et antibiotiques vont se retrouver dans les eaux via les eaux usées ou les eaux de ruissellement. De même que les bactéries résistantes. Est-ce que ces polluants vont induire des résistances dans l’environnement? Est-ce que les bactéries résistantes survivent dans les eaux? Est-ce qu’elles peuvent transférer leurs gènes à d’autres bactéries? etc…Autant de questions ouvertes qui n’ont pour l’instant pas de réponses.
Or actuellement les médias, tout à leur décomptes, ne s’intéressent que peu aux thématiques environnementales. Le rapport du GIEC paru en août, pourtant très alarmant, n’a fait la une de la presse qu’un ou deux jours.
Le reportage de Temps Présent, du Rhône au Léman, du poison dans notre eau potable, diffusé en juin 2021, n’a fait l’objet d’aucun relais médiatique ou politique. Et pourtant, il met clairement en évidence l’impact des décharges et effluents industriels sur la qualité et le futur de nos ressources en eaux.
Je vous avoue que c’est décourageant.
J’ai cependant décidé de conclure cette série d’articles sur une note positive.
Dans les années 1990, les pêcheurs constataient que les populations de truites dans les rivières avaient drastiquement diminué. Selon l’OFEV: “en 1980, on pêchait encore 1,2 million de truites dans les eaux suisses. On n’en pêchait plus que 400 000 en 2001”.
En 1998 est donc lancé le projet Fischnetz, un projet interdisciplinaire regroupant plusieurs institutions et hautes écoles suisses.
Treize hypothèses sont formulées pour expliquer ce déclin. Parmi elles, la question de la toxicité des substances chimiques que l’on retrouve dans les eaux.
En 2005, à la fin du projet, aucune conclusion claire. Manque d’habitats naturels, pollution des eaux, maladies infectieuses et changements climatiques, toutes ces causes interagissent certainement pour entrainer ce déclin.
A la suite de ce constat, deux principales mesures ont été décidées: la renaturation des cours d’eau et la diminution des rejets polluants.
Pour le premier point, les bases légales ont été posées en 2011. Ainsi “l’objectif de la Confédération est de mettre en œuvre des mesures de renaturation permettant de rétablir des ruisseaux, des cours d’eau et des lacs semi-naturels et auto-régulés dotés d’une dynamique qui leur est propre et de la faune et flore caractéristique”.
Pour le deuxième point, la Confédération a décidé de s’attaquer en premier lieu aux rejets de stations d’épurations (STEP). En effet, les nombreuses études existantes montrent que nombres de substances chimiques utilisées au quotidien (médicaments, détergents, cosmétiques, etc…) passent au travers des STEP.
Or les STEP n’ont pas été conçues pour traiter ces substances chimiques. Elles ont été construites pour éliminer la matière organique, l’azote et le phosphore. Certaines substances médicamenteuse se retrouvent donc aux mêmes concentrations à l’entrée et à la sortie de la STEP.
La révision de l’Ordonnance sur la protection des eaux est acceptée en 2015. Une centaine de STEP devront donc “traiter les micropolluants”.
Il existe différentes méthodes pour y arriver. Celles retenues pour être appliquées à grande échelle sont principalement le charbon actif (qui piège les molécules comme un filtre) ou l’ozonation (l’ozone, molécule très réactive, casse les substances chimiques). Avec l’ozonation cependant, le risque est de créer des substances de dégradation problématiques, ce qui explique que cette technique est complémentée par un filtre.
En Suisse romande, la première STEP équipée a été celle de Penthaz, en 2019.
Avec succès.
Le bilan de l’épuration des STEPs vaudoises 2020 montre que ce nouveau traitement permet de réduire de 95% la concentration totale des 42 substances recherchées. De plus, les concentrations sont aussi 20 fois inférieures aux concentrations des STEPs qui rejettent le plus de substances chimiques.
D’autres STEPs romandes et suisses, telle celle de Vidy à Lausanne, vont également progressivement être équipées de ces traitements.
Une très bonne nouvelle pour les eaux. Pour les écosystèmes aquatiques, mais également pour notre eau potable!
Voilà pour ce dernier point de situation.
A ce stade, j’aimerais vous remercier, lectrice, lecteur, fidèle, occasionnel ou de passage.
Le nombre de vues sur mon blog, vos commentaires, m’ont encouragée, m’ont fait réfléchir. Ce qui fût toujours stimulant.
Je vous souhaite de traverser cette période troublée le mieux possible.
J’espère vous recroiser au hasard d’écrits ou de conférences.
Nathalie Chèvre
Merci à Banksy pour l’illustration
Références:
ANSES. 2020. Antibiorésistance et environnement. Rapport d’expertise collective.
Mahoney et al. 2021. The silent pandemic: emergent antibiotic resistances following the global response to SARS-CoV-2. iScience 24. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102304