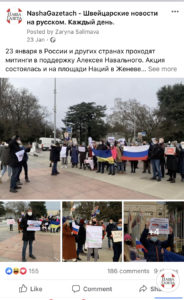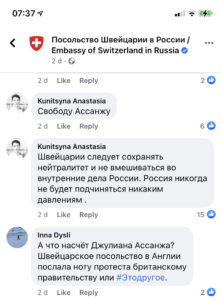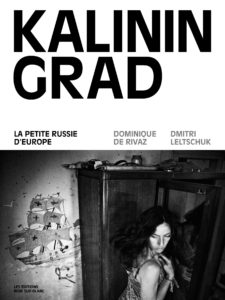Le présentateur Darius Rochebin, ex-vedette de la télévision suisse, connu en Russie seulement grâce à son interview de Vladimir Poutine, en 2015, reviendra dès lundi prochain sur la chaîne française LCI. Vous le savez, il y anime, depuis l’automne 2020, une émission « Le 20 Heures de Darius Rochebin ». Je devrais plutôt dire « animait » car suite à une publication dans le Temps et dans d’autres nombreux journaux ainsi qu’au début d’une enquête commanditée par la RTS après plusieurs dénonciations de son comportement jugé inapproprié il s’est retiré de l’antenne. L’enquête étant terminée sans avoir apporté de preuves de ces allégations et M. Rochebin ne faisant l’objet d’aucune procédure judiciaire, il y retourne. Je ne connais pas personnellement M. Rochebin, comme tout le monde je l’ai vu à la télé ou encore sur la terrasse d’un restaurant thaï au centre-ville. Seul ou avec son épouse mais sans les gardes du corps, un immense privilège des vedettes en Suisse. Je suis contente pour lui ! « Happy end » ? Pas tout à fait, car sa réputation est ternie et le soupçon demeure.
Avant lui, il y a eu Placido Domingo qui, après plus de 50 ans d’une carrière brillantissime, a vu tous ses contrats annulés par les maisons d’opéra qu’il a couvert de gloire et d’argent. L’hypocrisie ne connaisse pas de limites : j’ai vu des mélomanes se faire photographier devant son immense portrait dans le foyer du Metropolitan Opera à New York, alors qu’il avait été dénoncé publiquement par l’administration dudit théâtre. Face à ces accusations, M. Domingo s’est comporté avec la plus grande dignité. La plainte a été finalement retirée. Quant à moi, j’ai eu la chance de l’avoir rencontré, à la Philharmonie de Berlin, en 2015 et j’avoue avoir rarement rencontré un homme aussi galant. En décembre 2019 j’ai eu le bonheur de le voir « live », à La Scala de Milan – les 45 minutes d’ovation du public en larmes ont ému le grand ténor qui, lui aussi, a versé une larme. Ces jours-ci, il est au Théâtre Bolchoï à Moscou, où il chante et donne des master classes. Un autre « happy end » ?
Le chef d’orchestre Charles Dutoit est un des musiciens les plus connus de la Suisse. Suite à l’accusation de harcèlement sexuel par quatre femmes à la fois et de l’enquête qui s’ensuivit, M. Dutoit, alors âgé de 81 ans et marié avec une femme charmante, a dû quitter son poste à l’Orchestre symphonique de Montréal. Cinq autres orchestres ont également annulé ses contrats. La plainte des quatre femmes a, finalement, été retirée. Sans l’attendre, le grand chef russe Yuri Temirkanov avait eu l’élégance d’offrir à son collègue passionné de culture russe un contrat de trois ans comme chef invité de son illustre Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg. L’activité professionnelle de Charles Dutoit perdure donc en Russie et ailleurs. Encore un « happy end » ?
Hélas, pas de happy end la semaine dernière mais une fin tragique passée carrément inaperçue en Suisse et fort remarquée dans la communauté théâtrale russe. Liam Scarlett, le chorégraphe britannique âgé de 35 ans est mort. Le communiqué du Royal Opera House ne dit rien sur les circonstances de cette disparition prématurée mais son entourage parle de suicide. Cet artiste au grand talent honoré, malgré son jeune âge, de prix prestigieux, a été accusé, à son tour, de harcèlement – cette fois, par des garçons, ses élèves et danseurs. L’enquête interne menée par Covent Garden n’a trouvé aucune preuve. Néanmoins, en mars 2020 Liam Scarlett avait été licencié et tous ses projets rayés de l’affiche. Dans « le bon vieux temps » de Staline c’était l’usage eu égard des « ennemis du peuple », qui mouraient, eux aussi, pour être réhabilités des décennies plus tard.
Je n’ai aucune envie de rentrer dans le jeu de « qui a tort et qui a raison » – je n’étais pas là avec une chandelle. Je pense qu’il est autant difficile d’être une femme, surtout une femme jeune et jolie, qu’un homme, surtout un homme célèbre et aisé. J’aimerai parler d’un phénomène qui porte aujourd’hui le nom anglo-saxon de cancel culture. Cette pratique, venue des États-Unis et traduite en français par la « culture de l’annulation », consiste à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d’actions, comportements ou propos perçus comme problématiques. Ce lynchage public qui ne vise que les célébrités, ignore la présomption d’innocence et précède le travail de la justice « officielle ».
Le nom est moderne accompagné par les moyens modernes, mais le phénomène en soi est bien ancien : c’est une autre forme d’une chasse aux sorcières, sauf que le feu vif sur la place centrale est remplacé par le rôtissage lent sur les réseaux. A ce propos, vous le savez peut-être, une des dernières « sorcières » à avoir été exécutée en Europe était une Suissesse, originaire de Saint-Gall. Elle se prénommait Anne Göldin. On lui a coupé la tête à Glaris le 18 juin 1782. En 1991, une cinéaste Gertrud Pinkus a tourné un film sur son histoire, « Anne Göldin, la dernière sorcière », en septembre 2007 un musée qui lui est consacré, a été inauguré à Mollis. Une procédure de réhabilitation a été entamée en novembre 2007 par le Grand Conseil du canton de Glaris, avant qu’Anna Göldin ne soit définitivement innocentée le 27 août 2008. Que voilà une bonne leçon !