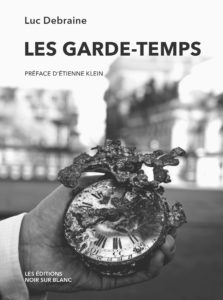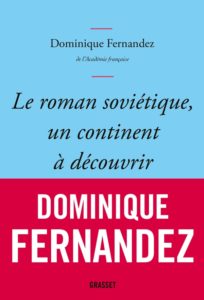Avertissement : Chères lectrices, chers lecteurs ! Ceci est mon dernier blogue sur la plateforme du Temps. Peut-être vous le savez déjà : la rédaction de ce quotidien suisse a décidé de cesser d’abriter ce type d’intervention ponctuelle. Par conséquent, j’ai décidé de transférer les archives de L’accent russe et de créer une nouvelle rubrique – en français – sur le site de Nasha Gazeta. Rien que pour vous ! Ceux qui souhaitent continuer de suivre mes interventions peuvent s’enregistrer ici même https://nashagazeta.ch/fr/blog-accent-russe . En cas de problème, n’hésitez surtout pas à m’écrire à [email protected] et je vous aiderai à le résoudre. Merci pour votre fidélité pendant ces deux dernières années, restons en contact, et maintenant – bonne lecture !
« L’extase symphonique avec Chostakovitch »
C’est ainsi que, dans un de ses récents communiqués, le Gstaad Menuhin Festival a intitulé sa grande soirée du 12 août à venir. J’espère que vous serez nombreux à y assister car, à elle seule, la Symphonie n° 9 de Dimitri Chostakovitch mérite le déplacement.
Christoph Müller, le directeur artistique du Festival, a placé sa 67ème édition sous le signe de l’“Humilité”. Humilité non dans le sens commun de modestie, ni dans le sens religieux. Il s’agit de l’humilité devant la Nature ; de l’acceptation de ses lois.
« Plusieurs crises centennales ont surgi coup sur coup et déstabilisé à plus d’un titre un équilibre en place depuis plusieurs décennies. Une pandémie nous a brutalement rappelé combien fragiles étaient les ressources vivantes et organiques de cette planète. Il suffit d’ouvrir les yeux pour se rendre compte que le changement climatique n’est pas une lubie de scientifiques en quête de sensationnel mais une réalité tangible, un processus en marche dont les conséquences sur notre planète sont déjà parfaitement perceptibles dans notre environnement immédiat », écrit-il dans l’édito sur le site du Festival.
Dimitri Chostakovitch fut une personne humble, de santé fragile, mais dotée d’une redoutable force d’esprit. Dans son récent ouvrage sur le roman soviétique, Dominique Fernandez a salué la capacité de résistance du compositeur qui se manifestait, selon ce membre de l’Académie française, dans ses œuvres délibérément plus faibles. De toute évidence, l’admiration devant le génie musicale et les qualités humaines de Chostakovitch fait l’unanimité, car même le Verbier Festival, le premier à se distancier de la Russie suite au début de la guerre en Ukraine, a inclus trois de ses symphonies – n° 1, 4, et 15 – dans son programme de 2022.
La Neuvième de Chostakovitch est une symphonie a part entière, et ceci pas seulement à cause de sa brièveté – vingt-cinq minutes seulement. Dernière de la tétralogie des symphonies connues comme « symphonies de guerre » (composées entre 1939 et 1945, toutes sont au cœur d’un excellent documentaire signé par le réalisateur canadien Larry Weinstein), elle est la seule à avoir être écrite sur commande émanant du gouvernement soviétique. Quelle sublime perversité ! Lui dont on avait pratiquement prononcé la sentence de mort formulée dans le tristement célèbre article « Cacophonie au lieu de la musique » inclus dans la Pravda du 28 janvier 1936 – ceci en guise de la critique de « Lady Macbeth de Mtsensk » –, lui dont on avait arrêté plusieurs proches et amis… voilà que ce même pouvoir central ne voyait nul inconvénient à continuer d’utiliser les services du Génie. Et voilà donc qu’en 1943, lorsque la Septième symphonie, dite “Leningrad”, donnait la chair de poule aux mélomanes du monde entier de par sa bouleversante “description” de l’invasion de l’Union soviétique par les nazis, puis que la Huitième, déjà terminée et centrée sur la bataille de Stalingrad, n’était pas encore présenté au public, la commande suprême tombait. Elle était claire : la nouvelle symphonie devait glorifier le peuple soviétique guidé par Staline et annoncer la victoire imminente.
Il faut savoir que Dimitri Chostakovitch a essayé à deux reprises de rejoindre l’armée pour défendre son pays, mais que ses demandes furent déclinées pour les raisons de santé. Chostakovitch était de tout cœur avec ses compatriotes ; ayant foi en la victoire, il a donc accepté la commande sans hésiter. En octobre 1943 il annonçait publiquement son nouveau projet, s’engageant à composer une grande symphonie avec chœur, à l’image de la Neuvième de Beethoven. Mais le travail s’est avéré difficile : au début de l’année 1945, la première partie n’était pas encore composée. Finalement, le compositeur a drastiquement changé son plan initial : en lieu et place d’un hymne pompeux il a écrit une œuvre qu’il a lui-même qualifié de « souffle de soulagement après des années sombres, avec un espoir pour l’avenir ».
Staline appréciait peu les souffles de soulagement, leur préférant les derniers souffles. Il est bien connu que la première exécution de la symphonie, le 5 novembre 1945 à Leningrad, par l’Orchestre philharmonique de Evgeni Mravinski, provoqua la colère de Staline, qui n’y a pas perçu l’ apothéose commandée. Nominée au Prix Staline en 1946, la Neuvième ne l’a finalement pas reçu. Deux ans plus tard, en février 1948, l’ordonnance du Comité central du Parti communiste concernant l’opéra de Vano Mouradeli « La grande amitié », qualifiait la musique de Chostakovitch, Prokofiev et Khatchatourian de “formaliste” et “antipopulaire”. Dimitri Chostakovitch fut contraint de démissionner des Conservatoires de Moscou et de Leningrad ; sa Neuvième symphonie ne fut plus jouée jusqu’au 1955 – soit après la mort de Staline. Chanceux sont ceux qui vont la découvrir le 12 août à Gstaad !
… Qu’aurait fait Chostakovitch, eût-il reçu une telle commande aujourd’hui, dans un contexte radicalement opposé ? J’espère qu’il l’aurait refusé, mais je suis heureuse qu’il n’ait pas vécu jusqu’au jour de devoir prendre une telle décision.