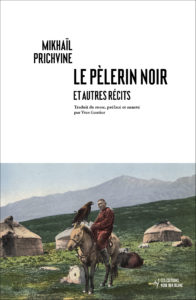Contrairement à certains auteurs dont je vous parle dans mes chroniques, Chamil Idiatoulline est bien vivant. Contrairement à certains autres, il continue à vivre à Moscou où il travaille chez Kommersant, le seul journal russe que je lis tous les matins. Je n’ai pas besoin de vous expliquer la virtuosité d’équilibriste qu’il faut, à l’heure actuelle, pour exercer le métier de journaliste à Moscou. Il faut vraiment peser ses mots. La liberté est un peu plus grande dans la fiction vers laquelle Chamil s’est tourné en 1988. Depuis, il a publié neuf romans, dont deux ont été distingués par le prix Bolshaïa Kniga (« Le Grand livre »), le plus important prix littéraire en Russie. L’un d’eux, intitulé Ex-rue Lénine, est paru la semaine dernière aux Éditions Noir sur Blanc ; il a été traduit par Emma Lavigne. C’est grâce à ce roman que j’ai découvert l’auteur que j’ai l’intention de suivre.
Chamil Idiatoulline est né en 1971 à Oulianovsk, anciennement Simbirsk, la ville natale de Vladimir Lénine ; comme lui, il a fait des études à l’Université de Kazan d’où, précise Chamil, contrairement au leader bolchevique, il n’a pas été expulsé. En parcourant la liste des titres de ses romans, on croit comprendre que nous avons à faire à un nostalgique du passé soviétique. Cette idée-là est fausse. Bien au contraire, sa pensée est tournée vers l’avenir, et même avec un certain degré d’optimisme – ce qui fait du bien.
Le titre français Ex-rue Lénine ne transmet pas, hélas, les « strates » cachées dans le titre original, Бывшая Ленина, lequel tend à suggérer qu’il ne s’agit pas seulement de la rue qui portait, dans le passé, le nom de Vladimir Lénine, mais aussi de l’ex-maîtresse de Lénine (à savoir d’Inès Armand, femme politique communiste d’origine française, morte du choléra en 1920 à Naltchik, Caucase), ou de quelque chose qui, auparavant, appartenait à Lena (diminutif d’Elena, laquelle est l’héroïne du roman). Ceci précisé, nous sommes déjà plus proches du sens du titre original, voulu par l’auteur qui souhaitait raconter l’« ex-vie » de Lena dans l’ex-pays de Lénine.
Au premier abord, on pourrait considérer ce roman comme « écologique ». L’action se déroule à Tchoupov, une petite ville de province imaginée par Chamil Idiatoulline mais parfaitement identifiable car elle est la copie de centaines de petites villes bien réelles. La particularité principale de Tchoupov est une immense décharge où s’entassent les ordures de toute la province. (En parlant avec Chamil, j’ai appris que tchoup signifie « ordures » en tatar, sa langue natale.) Toute l’action du roman tourne autour de cette décharge qui, bien avant le Covid, oblige les habitants à porter des masques sanitaires. Chaque appartement, chaque espace fermé est équipé de filtres aromatisés à la vanille, mais en vain : une odeur insoutenable pénètre partout et remplit tout.
On pourrait également considérer ce roman comme « politique ». En effet, tous les éléments sont là : les élections locales, la corruption, les mensonges quotidiens, les manifestations dans la rue (lors d’une de ces manifestations les citoyens refusent, pour une raison inconnue, d’accepter l’usine d’incinération d’ordures proposée par la Suisse), l’arrestation d’un haut fonctionnaire en plein repas, et même l’empoisonnement délibéré de la moitié de la population par les autorités dans le seul but d’attirer l’attention des chaînes fédérales de la TV. Sans succès : la ville est trop petite, elle est sans importance. La ville pue, ses habitants en meurent et tout le monde s’y habitue.
Toutefois, ces grands axes du roman sont secondaires ; ils servent uniquement de fond pour conter l’histoire de Lena, ce que Chamil Idiatoulline fait avec grande finesse et une compassion plus grande encore, tout en démontrant une profonde connaissance de la psychologie féminine. « Ce livre a été conçu comme l’histoire d’un amour qui meurt. Comment vivre après ? Je ne donne pas de réponse à cette question, mais je montre comment les divers personnages la cherchent. La décharge communale est apparue dans le roman pour servir de contraste avec le drame personnel de Lena, – m’a confié Chamil Idiatoulline lors d’une grande interview qu’il m’avait accordé. – À un moment donné, j’ai remarqué que beaucoup de couples autour de moi, de mon âge, divorçaient. Naturellement, je me suis mis à la place des hommes et je me suis dit : j’ai 45 ans, je ne suis ni gros, ni chauve, j’occupe une bonne position professionnelle, les filles me font les yeux doux, j’ai encore une chance de refaire ma vie. Puis je me suis mis à la place d’une femme – et là, j’ai été tétanisé. J’ai imaginé une femme qui vit pendant 20 à 25 ans avec son mari. Toute sa vie est concentrée sur lui et leurs enfants : les chemises sont-elles repassées ? Les devoirs sont-ils faits ? Elle-même et ses problèmes sont au second plan de ses préoccupations. Et voilà qu’au moment où elle pense enfin pouvoir profiter de la vie, son mari lui annonce qu’elle lui a gâché la sienne, que les enfants sont grands et que lui part avec une autre. C’est la sentence de mort pour Lena – comment survivre à ça ? »
Rassurez-vous, chers lecteurs et lectrices, les femmes sont plus robustes et plus inventives qu’on ne l’imagine ! Ayant surmonté le sentiment d’être jetée à la poubelle (décharge des ordures !) par celui à qui elle avait consacré sa vie, ayant tant bien que mal recollé son cœur brisé, Lena trouve de nouveaux centres d’intérêt et met ses multiples talents au service de ceux qui les apprécient. Quant à son ex, sa nouvelle (et jeune) femme le quitte et la carrière brillante qu’il comptait faire reste un rêve. « Je suis convaincu que derrière chaque homme qui réussit dans la vie, il y a une femme intelligente. Le mari de Lena lui devait tout et le fait qu’il ne l’a pas compris montre qu’il était bien bête », conclut Chamil Idiatoulline.
… Nous quittons Lena au moment où elle part à l’hôpital en laissant une lettre adressée à sa fille. Va-t-elle revenir à la maison, à l’ex-rue Lénine ? Nous l’ignorons, bien que Chamil m’ait promis qu’il lui a trouvé une maladie curable…
Un très beau roman, je vous le conseille.