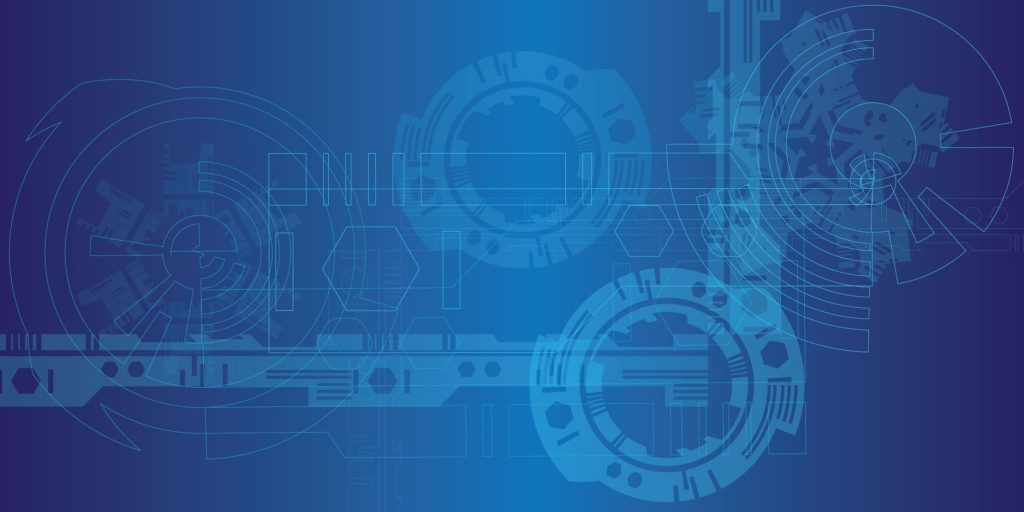Le 10 décembre 2021, la High Court of Justice de Londres a annulé la décision de la District Juge qui avait refusé l’extradition de Julian Assange. La High Court of Justice a estimé que les garanties données par les Etats-Unis en cours de procédure rendaient possible l’extradition du lanceur d’alerte. Les autorités américaines ont en effet assuré qu’en cas d’extradition, Julian Assange ne sera pas soumis à des conditions de détention particulièrement sévères , qu’il ne sera pas détenu dans la prison de très haute sécurité de Florence, au Colorado, qu’il recevra des soins médicaux adaptés à son état de santé et que s’il devait être condamné, il pourrait purger sa peine en Australie. D’après la High Court of Justice, ces garanties permettent d’éviter tout risque pour la vie de l’intéressé. Les avocats de ce dernier ont immédiatement recouru contre cette décision.
Le point déterminant est celui de savoir si la vie de Julian Assange est en danger. La première Juge a estimé que tel était le cas, et qu’en cas d’extradition le risque de suicide était trop important pour être pris. La seconde autorité judiciaire a estimé que compte tenu des garanties offertes par les Etats-Unis, ce risque pouvait être écarté.
Motif politique?
Pourquoi la Grande-Bretagne ne refuse-t-elle pas l’extradition de Julian Assange au motif qu’il est poursuivi pour un motif politique? En effet, il s’agit d’un motif permettant généralement de refuser l’entraide. En droit suisse par exemple, de même que selon la convention européenne d’entraide judiciaire et selon la convention européenne d’extradition, de même que selon le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique, signés par la Suisse, une demande d’entraide provenant d’un Etat étranger est irrecevable lorsque la procédure étrangère vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant (art. 3 al. 1 EIMP; art. 2 let. a CEEJ; art. 3 CEExtr, art. 3 ch. 1 TEXUS). Un telle exception existe-t-elle s’agissant des relations entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ? Oui et non.
Oui, car le traité d’extradition qui lie le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique (Extradition Treaty between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America with Exchange of Notes) précise à son article 4 ch. 1 que l’extradition d’une personne ne saurait être ordonnée si l’infraction pour laquelle elle est requise est de nature politique. Non car cette disposition, bien que contenue dans le traité, n’est pas applicable.
Argument écarté
La défense de Julian Assange n’a pas manqué de plaider l’application de l’exception du délit politique contenue à l’article 4 ch. 1 du traité devant la District Judge. En vain. Il a pourtant été exposé que la majorité des infractions reprochées à Julian Assange relevaient de l’espionnage, et que les 18 chefs de préventions pesant sur lui avaient en commun le reproche d’avoir eu l’intention d’obtenir ou de rendre public des secrets d’Etat américains mettant en péril sécurité du gouvernement. Cet argument a été écarté par la justice anglaise en première instance déjà. Non pas parce que la juge a estimé que les infractions pour lesquelles Julian Assange était poursuivi ne sont pas politiques. L’argument de l’infraction politique a été écarté au seul motif que le traité d’extradition entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne confère en lui-même aucun droit aux particuliers.
En effet, ce n’est qu’après avoir été incorporés au droit interne britannique que les dispositions d’un traité international confèrent de véritables droits. C’est ce que l’on appelle le système dualiste – par opposition au système moniste connu en droit suisse, en vertu duquel les traités internationaux ratifiés par la Suisse sont directement applicables. Or en l’espèce, le Parlement britannique n’a pas voulu rendre cette exception du délit politique applicable.
C’est pour ce motif que la décision de refuser l’extradition de Julian Assange – renversée par la High Court of Justice – reposait sur la santé mentale fragile de Julian Assange et le risque de suicide que faisait peser sur lui une extradition vers les Etats-Unis.
A ce sujet, j’ai eu le plaisir d’être invitée à participer à un débat dans l’émission de radio Forum de la RTS le 14 décembre 2021.