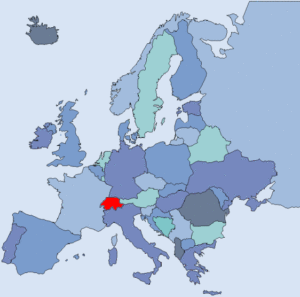Les collectivités publiques et l’économie n’ont absolument pas besoin d’un accord de libre accès des Européens au marché suisse du travail pour accueillir toutes les compétences et talents dont elles ont besoin. D’autant plus que la réciprocité de cet accord est proprement dérisoire. La libre circulation a donc une autre signification. Si les Européens y tiennent tellement, c’est qu’elle revêt une importance politique bien particulière et cruciale pour eux.
Elle fait partie des principes fondateurs du Traité de Rome instituant en 1957 la Communauté économique européenne (CEE). Ce traité n’est pas un simple accord de libre échange ou d’association. Il crée un marché unifié, avec un tarif douanier commun et exclusif vis-à-vis de l’extérieur (union douanière). La liberté de mouvement portant sur les marchandises (revendication plutôt banale à l’époque) est assortie d’une même liberté accordée aux personnes, aux services et aux capitaux. La libre circulation des personnes est donc placée en deuxième position dans la formulation des quatre libertés fondamentales. Ancien militant syndical, favorable à des conventions collectives de travail transnationales, relanceur de la dynamique européenne et président de la Commission Européenne dans les années décisives de 1985 à 1994, Jacques Delors prendra l’habitude de mentionner cette liberté-là en premier.
Les quatre libertés intégratoires ne sont initialement que des principes, qui vont devoir s’appliquer de manière évolutive et de plus en plus approfondie de traité en traité. La Cour européenne de justice a en plus pour mission officielle de produire une jurisprudence arbitrant en faveur de l’intégration (subsidiarité inversée). Les conflits de législations nationales, les vides et flous juridiques seront en particulier interprétés à l’avantage des futurs citoyens européens, bénéficiaires du principe de libre circulation des personnes.
La grande vision de l’époque renvoie à des Etats unis d’Europe, inspirés tardivement des Etats-Unis d’Amérique. Le modèle est accessoirement compatible avec l’Union soviétique, qui était elle-même une sorte de fédération de républiques. Quelque peu oubliée aujourd’hui, cette analogie a légitimé et favorisé pendant des décennies le soutien de la gauche et des intellectuels au grand projet européen : étape historique, voire scientifique ultime vers la future union des républiques socialistes d’Europe.
La dimension économique restreinte de la libre circulation, qui équivaut surtout à augmenter la liquidité du marché des salariés et indépendants, devait flexibiliser dans un premier temps le facteur travail et faire converger progressivement les niveaux de rémunération des différents Etats membres. Il fut prévu dès le départ que la mobilité géographique de la main d’œuvre, considérée comme un élément décisif du succès économique américain, serait activement encouragée en Europe, et de différentes manières (échanges de jeunes travailleurs d’un Etat à l’autre en particulier).
Dynamique intégratoire par la citoyenneté
La libre circulation n’est en réalité jamais venue à bout des différences salariales parfois abruptes entre Etats européens. La littérature théorique s’accorde en revanche sur le fait que ce vecteur d’intégration a surtout permis de sortir la CEE de sa sphère étroitement économique. Pour la projeter vers la future Union Européenne, politique et véritablement transcendante par rapport aux vieux Etats nationaux.
Etape par étape, le principe de la libre circulation va conduire à l’instauration du passeport européen dans les années 1980, à la reconnaissance mutuelle des systèmes sociaux, ou encore aux Accords de Schengen et Dublin. Dans une interview à plusieurs médias européens, dont Le Temps(« L’Europe n’est pas un supermarché, c’est un destin commun », 21 juin 2017), le président Emmanuel Macron rappelait solennellement que la libre circulation des personnes était « un élément constitutif de la citoyenneté européenne ».
La libre circulation fut aussi un ambitieux programme d’intégration sociale à l’échelle du continent. C’est ce qui explique que le Parti socialiste l’ait défendu si longtemps en Suisse. Avant de se rendre compte qu’elle était surtout de nature à tirer les meilleures conditions salariales vers le bas.
A la fin des années 1980, lors de la préparation du traité instituant l’Union Européenne (Maastricht), nouvelle étape dans l’intégration politique, Jacques Delors et son entourage ont imaginé un dispositif de transition (un « sas » disait-il) permettant aux Etats non encore membres de s’intégrer progressivement. En commençant eux aussi par l’économie, en vue d’une adhésion complète à plus long terme.
L’Espace économique européen (EEE) devait inclure les quatre libertés fondamentales, à commencer par la plus importante sur le plan politique : l’audacieuse libre circulation des personnes dans l’état de ses développements de l’époque, déjà bien avancés, et de ses évolutions futures par reprise automatique du droit européen.
Un petit livre remarqué de la collection Que sais-je, paru en 1992 à Paris, intitulé « La Libre circulation en Europe », donnait une idée de l’ampleur de ce que le principe impliquait : les Etats de l’EEE allaient en particulier devoir reprendre les dispositions du droit communautaire en matière d’avantages sociaux. « Or, la Cour de Justice européenne a souvent eu recours dans ses arrêts à la fois à la notion d’égalité de traitement et à celle d’avantages sociaux élargie (…). La notion d’avantage social telle qu’elle est entendue par la Cour est à son tour devenue, à certains égards, l’un des piliers de l’évolution du droit de la libre circulation.» Un corpus juridique qui atteignait déjà un niveau de complexité proprement labyrinthique.
 L’illusoire réciprocité
L’illusoire réciprocité
La Norvège, l’Islande et le Liechtenstein acceptèrent et ratifièrent en 1992 leur adhésion à l’EEE. Leur marché du travail était à vrai dire peu attrayant, pour des raisons géographiques et linguistiques toujours valables s’agissant des Nordiques. Les Suisses, en revanche, ont rejeté le traité de justesse le 6 décembre par référendum, malgré l’unanimité institutionnelle, médiatique et partisane (Parti populaire et Verts alémaniques exceptés).
De l’avis également général, ce fut principalement la libre circulation des personnes, ses risques pour le marché du travail, son étendue, son caractère évolutif, sa finalité identitaire qui avaient fait échouer le projet. Mise continuellement en avant dans le débat politique, la réciprocité n’avait pas non plus convaincu : cadres et spécialistes de haut rang mis à part, souvent binationaux et que la Suisse n’avait de toute manière aucun intérêt à laisser partir, pourquoi des salariés sans double nationalité se seraient intéressés en Europe à des emplois payés sensiblement en dessous des prestations de chômage en Suisse ? Voire des rentes de base de l’Assurance vieillesse (AVS)?
Après l’échec de 1992, la recherche d’une voie plus particulière encore que l’EEE vers l’intégration, dite cette fois « bilatérale », lente et non évolutive, s’est provisoirement contentée d’une libre circulation simplifiée et statique : interdiction des quotas d’immigration et de travail frontalier, non-discrimination nationale lors des recrutements, avec quelques aménagements complémentaires. Les négociations furent longues et difficiles, prenant plusieurs années.
Le ratage politique retentissant sur l’EEE avait ouvert les yeux des formations politiques de gauche. Indispensable pour obtenir une majorité en vote populaire, une partie significative de leur base, en général syndicale, était en fait opposée à la libre circulation. L’un des buts de cette LCP n’était-il pas d’augmenter la compétitivité de l’économie en augmentant la concurrence sur le marché du travail ? Faisant ainsi converger les niveaux de salaire suisses et européens vers le bas ? L’argument selon lequel le niveau général des prix baisserait également ne convainquait pas davantage. A peu près tout a d’ailleurs été fait par la suite pour anéantir l’îlot suisse de cherté. En vain.
 Ouvrir la porte et mettre le pied
Ouvrir la porte et mettre le pied
La gauche a finalement consenti à la libre circulation des personnes dans la seconde moitié des années 1990, à condition qu’elle fût assortie de mesures d’accompagnement. C’est-à-dire de contrôles systématiques permettant de s’assurer qu’il n’y aurait pas de dumping salarial dans les entreprises des secteurs les plus sensibles. La gauche progressait ainsi d’un pas dans l’une de ses grandes aspirations idéologiques : le contrôle des salaires.
Ces mesures étaient complètement contraires à l’esprit et à la lettre de la libre circulation en Europe, mais elles furent acceptées du côté de Bruxelles. Le premier objectif des Européens n’était-il pas de caler la singularité suisse sur la voie de l’intégration, fût-elle tardive et très progressive ? Tout s’est passé comme si le but était surtout d’ouvrir une porte et d’y mettre le pied. Il serait toujours temps de faire évoluer les choses dans le bon sens par la suite. Comme leur nom l’indique, des mesures d’accompagnement ne sont que des précautions transitoires.
Totalement inutile pour la Suisse
Il y avait évidemment un risque dans cette affaire hautement sensible : que l’inutilité intrinsèque et pratique de la libre circulation apparaisse assez vite. La Suisse n’a en réalité nullement besoin de cet accord pour accueillir toute les compétences et talents européens dont son marché du travail a besoin. Les quotas annuels d’immigration en vigueur jusqu’à l’introduction de la libre circulation dans les années 2000 n’étaient d’ailleurs jamais atteints.
Les milieux économiques en étaient bien conscients, mais ils soutenaient la libre circulation pour que l’immigration européenne et le travail frontalier ne dépendent plus d’une opinion publique chroniquement soupçonnée d’être bien trop restrictive et aveugle sur les intérêts de l’économie, qui étaient aussi les leur: réduire les coûts salariaux augmente la compétitivité des exportations et des multinationales.
Les négociateurs européens n’eurent aucune peine à obtenir dans ces conditions un redoutable dispositif rendant pratiquement inenvisageable toute réversibilité de la libre circulation. L’adhésion à l’UE n’est-elle pas restée l’horizon et objectif officiel du Conseil fédéral pendant toutes les années 1990 (et même au-delà) ? Une clause dite « guillotine » prévoyait donc qu’une dénonciation de l’accord sur la libre circulation entraînerait automatiquement l’invalidation des six autres traités sectoriels du premier paquet bilatéral. C’est ce qui rend si difficile aujourd’hui la dénonciation de la libre circulation par la Suisse, bien que les effets migratoires n’aient pas du tout été de l’ordre de ce qui avait été prévu (ce qui invaliderait de fait n’importe quel traité international dans le monde).
 Point de départ de l’intégration
Point de départ de l’intégration
Contrairement aux six autres accords liés des Bilatérales I, la libre circulation ne relève ni du libre échange, ni de la simple association. On se rend mieux compte avec le recul à quel point elle est en réalité vouée à reproduire avec la Suisse ce qu’elle a réalisé en Europe depuis les années 1950 : partir de la relation d’accès réciproque aux marchés nationaux pour s’élever à une dimension beaucoup plus globale, identitaire, historique et politique.
Les Européens, qui « accèdent » au marché suisse pour 20 milliards de francs de plus que les exportateurs Suisses n’ « accèdent » au marché européen (balance commerciale 2018), ne parlent d’ailleurs pas d’ « accès » des Suisses à leur grand marché. C’est en général de « participation » dont il est question, bien que les Suisses n’aient aucun pouvoir de décision.
Avec la libre circulation européenne en Suisse et sa contrepartie en termes de participation au marché européen, les Suisses participent déjà et de facto au grand chantier de la construction européenne. Pourquoi ne feraient-ils pas les petits pas intégratoires supplémentaires, qui leur donneraient au moins le droit de participer aux décisions? Puis de se rendre compte en définitive que l’adhésion complète n’est plus qu’une formalité (lire prochainement « Généalogie de la voie bilatérale ») ?
 Le oui de la grande lassitude
Le oui de la grande lassitude
En attendant que les Suisses se décident à participer complètement à la vie communautaire européenne, ouvrant peut-être un jour la voie aux Etats retardataires de l’EEE, les Accords bilatéraux I ont été soumis au vote populaire le 21 mai 2000. Huit ans après le rejet traumatique de cet EEE, les circonstances semblaient cette fois idéales. L’opinion publique et le climat politique étaient empreints d’une grande lassitude.
La Suisse était plongée depuis plus de dix ans dans une profonde crise immobilière, bancaire et économique. Olivier Steimer, ancien membre de la direction du groupe Credit Suisse dans le monde, puis président de la BCV et du Swiss Finance Institute, dira après 2008 dans un entretien off avec des rédacteurs en chef que cette crise fut pour la Suisse ce que le subprime fut pour les Etats-Unis : un choc d’une violence inouïe, dont elle ne s’est remise complètement que dans les années 2000.
Pendant toute cette période, le rejet de l’EEE et de la libre circulation furent pourtant présentés par celles et ceux qui les avaient soutenus en vain comme la cause d’à peu près tous les problèmes. Les futurs accords bilatéraux pouvaient alors fonctionner comme une rédemption. Ce narratif déprimé et biaisé n’a d’ailleurs guère changé aujourd’hui.
Si loin des clichés morbides
Encore mal documentée historiquement, la décennie 1990 fut en réalité, et de toute évidence celle qui a vu la Suisse sortir de son économie de guerre, si représentative du XXe siècle. Entre décartellisation, programmes de revitalisation, politique monétaire rigoriste contraignant les exportateurs à monter en gamme, délocalisations et globalisation forcées, ou encore mise en ligne du marché des actions (une première planétaire), l’économie et la politique économique menée par le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz ont connu un véritable bouleversement.
Or c’est bien le choc politique du rejet de l’EEE, privant en plus la Suisse du confortable oreiller de paresse économique européen, qui a paradoxalement donné à cette révolution son impulsion initiale. En ce sens, cet événement fut une chance immense pour le pays. Une génération plus tard, le rayonnement industriel et économique de la Suisse dans le monde en est encore largement redevable.
Très orienté Europe, le secteur des machines venait d’ailleurs d’augmenter ses ventes à l’étranger de près de 20% en cinq ans lorsque les Suisses se sont prononcés sur les Accords bilatéraux I en mai 2000. Mais comme toute réorganisation, ce formidable effort d’adaptation et de relance eut il est vrai un coût sévère sur le moment : plusieurs années de récession et taux de chômage au plus haut. Beaucoup mieux chroniqués, l’accompagnement social, les investissements de long terme et la mise à jour du secteur public ont généré un endettement considérable.
 Sous la rédemption, la refondation
Sous la rédemption, la refondation
D’autres Etats en Europe et dans le monde, plus ou moins à la même époque, sont également passés par ce genre de refondation, que ses détracteurs qualifient en général de néolibérale. Assez loin à vrai dire des récits de punition collective s’abattant sur le peuple coupable d’avoir rejeté la libre circulation des personnes et le saint accès privilégié au marché européen (de plus en plus protectionniste d’ailleurs à partir de ces années-là).
C’est dire qu’il y a une manière bien plus positive de considérer les choses : la Suisse fait aujourd’hui partie des plus grands gagnants de la mondialisation d’après Guerre froide, y compris sur le plan social : ce n’est pas la plus mauvaise position pour affronter les courants actuels de démondialisation. Tout a commencé dans les années 1990 déjà. La croissance de l’économie suisse était d’ailleurs réorientée vers le haut avant la fin de la décennie. Elle rattrapait les moyennes de l’OCDE à grande vitesse.
A partir de 2007, lors de la pleine application de la libre circulation avec l’UE, les performances économiques des multinationales et de l’industrie d’exportation dans le monde ont provoqué un formidable appel d’air. Ce sont des dizaines de milliers d’Européens qui sont venus travailler en Suisse. Mais pas seulement là où l’économie les attendait. Dans le secteur public et para-public principalement, le social, la formation, les organisations internationales. C’est cet élargissement démographique du marché intérieur qui a soutenu la croissance en Suisse dans les années 2010, pendant et après la profonde crise mondiale de 2008. Du jamais vu depuis des décennies.
 L’immense écart prévisionnel
L’immense écart prévisionnel
C’est dire si rien ne s’est passé comme prévu. En 2000, lors du vote populaire, la libre circulation des personnes apparaissait comme le prix à payer pour sortir d’un enfer économique largement fantasmé. Avec les autres accords bilatéraux, elle a été plébiscitée à plus de 65% des voix. Tous les partis gouvernementaux les ont soutenus, y compris l’UDC. Les électeurs de gauche étaient rassurés par les mesures d’accompagnement. Trompés par la dépression régnant sur le marché du travail dans les années 1990, le gouvernement tablait sur une modeste augmentation de l’immigration européenne de quelque 8000 personnes au plus par an.
Les milieux économiques en espéraient 10 000. Ils étaient surtout soulagés que le marché du travail fût enfin élargi au vaste bassin de population européen, et que la politique d’immigration ne dépende plus en Suisse de la sphère politique (de plus en plus lente et imprévisibles dans un monde très changeant). L’industrie d’exportation économisait quelques coûts et lenteurs administratives liés aux demandes de permis de travail pour ressortissants européens.
Les entreprises orientées marché intérieur devaient en revanche assumer les charges nouvelles générées par l’application des mesures d’accompagnement. Que du bonheur dans un pays imprégné de mercantilisme (comme l’Allemagne et d’autres petits Etats d’Europe du Nord), mentalité économique classique considérant les exportateurs comme des héros, les importateurs comme des profiteurs et les Arts et métiers comme de l’intendance.
Le contrôle paritaire et sectoriel des salaires permettait aussi aux syndicats d’augmenter leurs revenus et effectifs. Rien de bien alarmant, ni de quoi s’adonner à l’euphorie. Et comme l’avait imprudemment déclaré le chef du Département fédéral de l’économie Pascal Couchepin le 17 mars dans le Blick, ces accords bilatéraux allaient servir « de banc d’essai en vue d’une future adhésion à l’Union Européenne, en particulier sur la libre circulation ».
 Comment la trappe s’est refermée
Comment la trappe s’est refermée
La Suisse était surtout parvenue à échapper à toute contrainte de reprise automatique du droit européen. La sécurité juridique semblait parfaite, l’incertitude des conditions cadres réduite à l’insignifiance. L’Union Européenne allait sans doute avoir d’autres exigences et formuler d’autres demandes par la suite, la Suisse aussi d’ailleurs, mais les citoyens seraient libres d’accepter ou de refuser.
Deux jours avant le vote, le Genevois Bernard Koechlin, membre du comité du Vorort (future economiesuisse), se réjouissait à son tour de ces bilatérales dans le Temps. Il pensait comme à peu près tout le monde qu’elles allaient permettre de faire un essai avec l’Union Européenne, « et que si ça n’allait pas, nous pourrons toujours faire un pas en arrière et remettre certaines choses en question ».
On a vu ce qu’il en était en 2014, lorsque le corps électoral a suivi l’UDC en vote populaire dans la dénonciation de la libre circulation. Mais personne ne semblait bien se rendre compte sur le moment de ce que représentait le lien juridique entre les sept accords (clause guillotine). Il en était d’ailleurs fort peu question.
Ce n’est que des années plus tard, lorsque l’horizon adhésif s’est éteint, que la clause guillotine est clairement apparue comme un piège dans lequel la Suisse s’était tragiquement laissée enfermer. Même Alexis Lautenberg, ancien chef de la vaillante mission suisse à Bruxelles, qui avait suivi les négociations dans l’esprit des mandats du Conseil fédéral, me confiait humblement lors d’un séminaire en novembre 2013 à Genève que cette clause guillotine « avait été une erreur malheureuse».
Les neuf Accords bilatéraux II finalisés cinq ans plus tard ne furent pas liés juridiquement, ce qui montre par surabondance ce que personne n’a d’ailleurs jamais vraiment nié : en deça des belles paroles sur le pragmatisme et les intérêts économiques, la libre circulation des personnes et sa clause guillotine sont l’acte par lequel Bruxelles et les vaincus de 1992 ont pris leur revanche en arrimant la Suisse à la dynamique intégratoire de l’Union Européenne. Avec elles, les accords bilatéraux ne se contentaient plus d’un caractère commercial ou associatif. Ils devenaient des accords dynamiques et irréversibles d’intégration.
9 février 2014
Le résultat de cette triste dynamique de l’obstination et du ressentiment est apparu dans toute sa pesanteur lors du débat politique précédant le vote populaire de 2014 sur la première initiative de l’UDC contre la libre circulation des personnes : réintroduction de quotas et fin de la préférence nationale européenne en Suisse par rapport aux ressortissants du monde. Il n’y fut plus question d’adhésion.
C’est le soumissionnisme à la petite semaine, fébrile et transi de peur qui a dominé toute l’opposition à l’initiative. Faisant valoir que reprendre le contrôle de l’immigration européenne en Suisse n’était tout simplement plus possible. Qui avait envie de renoncer ainsi aux six autres Accords bilatéraux I, si pratiques et politiquement inoffensifs ? Sans parler des multiples contrariétés et rétorsions que cette folle rébellion allait inspirer à Bruxelles et dans certaines capitales européennes. A commencer par Paris, toujours très motivée s’agissant de s’en prendre à la Suisse. Puis Rome, Madrid, et bien des petits Etats du Nord que la souveraineté suisse renvoie à leur propre condition.
 Contorsions inédites
Contorsions inédites
L’initiative fut même proclamée inapplicable tout au long de la campagne. Une fois acceptée quand même de justesse, grâce à l’appui assez prévisible des souverainistes non identitaires hors UDC, l’inapplicabilité fut confirmée avec un aplomb confondant. Le texte constitutionnel adopté par le corps électoral fit alors l’objet de contorsions inédites dans la longue histoire du traitement des initiatives populaires en Suisse : une sorte de contre-projet de rattrapage ultérieur au verdict des urnes, soumis à référendum après avoir été élaboré et approuvé par le Conseil fédéral et le Parlement
Lucide sur ses chances de l’emporter de nouveau dans ces circonstances exacerbées, l’UDC a refusé de lancer un référendum. Incongruité contre incongruité, elle a préféré répliquer aussitôt par une deuxième initiative contre la libre circulation des personnes.
Contrairement à ce qui a été répété sur tous les tons après 2014, appliquer la fin de la libre circulation des personnes n’impliquait nullement de revenir au système archaïque d’avant son introduction. Des dizaines d’Etats performants et prospères dans le monde régulent leur immigration dans l’intérêt de l’économie et de la population.
Il s’agissait toutefois de préserver le principe et de sauver les apparences pour ne pas contrarier les dignitaires européens. Le compromis du Parlement maintenait donc formellement la libre circulation des personnes, bien qu’en la vidant d’une partie insignifiante de son contenu. Les Européens conservaient leur libre accès au marché suisse du travail. Mais les entreprises étaient quand même tenues d’annoncer leurs offres aux services publics de l’emploi lorsque les taux de chômage des groupes de métiers auxquels elles appartenaient étaient supérieurs à la moyenne. Une discrimination vénielle validée par Bruxelles en se bouchant le nez.
 Chaos et impasse programmée
Chaos et impasse programmée
Cet épisode rocambolesque tombait en plein Brexit, avec de surcroît le refus de la gauche en Suisse de céder sur l’affaiblissement des mesures d’accompagnement prévu dans le cadre de l’Accord institutionnel finalisé en 2018. Il devenait de plus en plus clair que la voie bilatérale vers l’intégration et l’adhésion, empruntée dans les années 1990, menait bel et bien vers l’impasse programmée en réalité depuis ses débuts.
La prochaine étape sera le vote populaire sur la deuxième initiative de l’UDC contre la libre-circulation des personnes. En 2020 probablement. Elle s’annonce aussi dramatique qu’imprévisible. En cas de refus, une troisième initiative pourrait être lancée lorsque la fin de la libre circulation au Royaume-Uni aura produit tous ses effets. Il sera peut-être possible alors de mieux se rendre compte que l’on peut vivre sans elle. Et que l’on peut même bien vivre, avec des relations de voisinage désidéologisées, clarifiées et assainies.
Revue de presse commentée https://cutt.ly/ve5wzDI






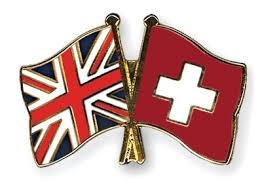

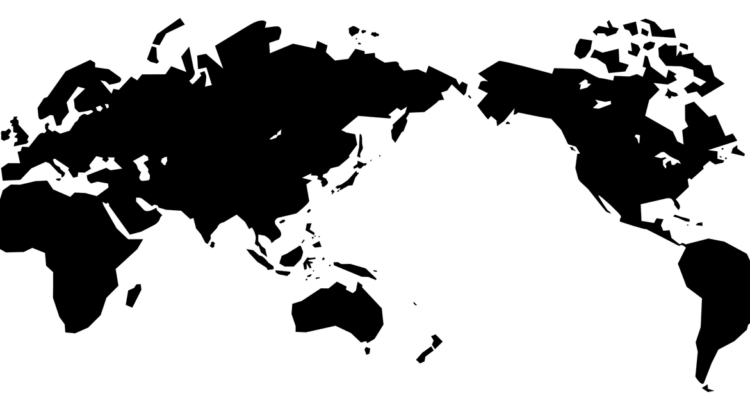
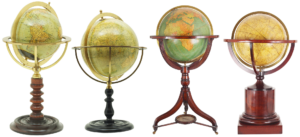









 Ce n’est peut-être qu’une vague start-up financière de quelques personnes, localisée dans un espace de coworking sur le Quai de l’Ile à Genève, mais la libra concentre un maximum d’attention au plus haut niveau dans le monde. Rien à voir avec les techno-pignoufleries spéculatives du bitcoin.
Ce n’est peut-être qu’une vague start-up financière de quelques personnes, localisée dans un espace de coworking sur le Quai de l’Ile à Genève, mais la libra concentre un maximum d’attention au plus haut niveau dans le monde. Rien à voir avec les techno-pignoufleries spéculatives du bitcoin.