Comment obtenir à peu près tout ce que l’on veut de la part des Suisses ? Bruxelles a bien compris qu’il suffisait de menacer les hautes écoles de ne plus être associées aux financements publics de la recherche scientifique en Europe (programme Horizon 2020 et suivants). Mais de quoi parle-t-on au juste ? Et où sont les solutions pour sortir de ce chantage? Explications, évaluation et récit en huit actes. (L’essentiel en bleu)
Accès « privilégié » de l’économie suisse au marché européen. Une sorte de contrepartie théorique au libre accès des Européens au marché suisse du travail. Et lorsque l’on parle de ce grand arrangement transitoire, négocié quand l’objectif officiel était encore l’adhésion de la Suisse à l’Union Européenne*, on pense surtout au septième volet des Accords bilatéraux I (conclus en 1999) : l’Accord de coopération scientifique et technologique dans le domaine subventionné. Soit l’accès au marché des financements publics de la recherche et de l’innovation en Europe.
La Suisse est en fait partenaire depuis les années 1980 des programmes-cadres européens de recherche (PCR). Il s’agit du morceau d’intégration le plus consensuel de la Suisse à l’Union. Le plus pragmatique aussi, le plus abouti et le plus médiatique. Il n’est certainement pas vital pour la prospérité du pays, mais personne n’a intérêt à le remettre en cause. Quand les Européens s’y appliquent quand même, c’est seulement pour en faire un levier politique d’intimidation.
C’est précisément ce qui s’est passé après le vote populaire du 9 février 2014 mettant fin au droit d’accès des Européens à une activité économique en Suisse (libre circulation des personnes). Bruxelles a aussitôt suspendu les négociations sur l’association de la Suisse au huitième programme cadre (Horizon 2020). En se gardant de toucher aux autres Accords bilatéraux I, pourtant tout autant liés entre eux sur le plan juridique (clause guillotine). Tout s’est passé comme si le but, pour la Commission Européenne, était surtout de manifester sa détermination, dissuadant ainsi l’Assemblée fédérale d’appliquer la décision populaire fautive dans le domaine migratoire.
La stratégie s’est avérée efficace. Le Parlement n’a appliqué que très partiellement le nouvel article constitutionnel, de manière que les dispositions puissent être agréées par Bruxelles. Les risques par rapport à la pleine association de la Suisse aux programmes-cadres de recherche se sont ainsi provisoirement dissipés. Ils reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène politique.
* Lire précédemment: Généalogie de la libre circulation des personnes (11.09.19) et Généalogie de la voie bilatérale (13.09.19).

Ce qu’il s’agit de montrer
Le but de cet article est d’évaluer les effets d’un nouveau rejet de la libre circulation sur l’accord d’association de la Suisse aux programmes-cadres de recherche. En vue du scrutin de cette année sur la politique migratoire (deuxième initiative du Parti populaire suisse UDC). D’abord prévu en mai, puis annulé pour cause de crise sanitaire. Le vote sera probablement programmé en septembre prochain.
Il s’agit d’abord d’envisager le scénario du pire, hautement improbable : de quoi la Suisse se priverait au juste si elle ne participait plus du tout à ces programmes de recherche? De pas grand-chose apparemment sur le plan quantitatif. Les subventions européennes obtenues des programmes-cadres en échange de la contribution suisse forfaitaire ne représentent que 1,5% environ des investissements dans la R&D en Suisse.
Option à peine plus réaliste : la Suisse serait reléguée parmi les « Etats tiers », participant aux programmes-cadres sur la base d’accords particuliers de coopération scientifique (Canada, Australie, Corée, etc).
Avec un sérieux problème politique toutefois : la Suisse se retrouverait ainsi grossièrement discriminée par rapport à treize Etats périphériques de l’UE, relevant pour certains de la “simple” Politique européenne de voisinage (PEV). Ces Etats n’ont-ils pas tous conclu, dans la recherche, les même accords d’association que ceux dont la Suisse bénéficie depuis 2004 ?
La Suisse est en fait déjà défavorisée par rapport à ces Etats voisins (Serbie, Albanie, Israël, Tunisie, Arménie, Géorgie, etc.). Ils n’ont en effet aucun accord de libre circulation avec l’UE. Ni le moindre accord équivalent de ceux que l’on trouve dans les Bilatérales I, en principe considérées comme un ensemble équilibré d’avantages et de contreparties.
Scénario dès lors le plus probable : la Suisse se retrouverait théoriquement sur le même plan que le Royaume-Uni (sans libre circulation des personnes). Les deux Etats négocieraient parallèlement (ou ensemble) un nouvel accord d’association les plaçant eux-mêmes au même niveau de coopération scientifique que ces treize Etats partenaires de l’Union Européenne à l’est et au sud.
Pour faire bonne mesure et donner l’impression d’avancer, une libre circulation des chercheurs serait instaurée entre l’UE et les Etats associés. Cette disposition est explicitement prévue depuis 2000 dans le cadre de l’Espace européen de la recherche (EER), mais elle n’a jamais été vraiment appliquée.
En tout état de cause, le financement public de la R&D en Suisse n’a aucun intérêt à dépendre plus longtemps de contingences aussi exogènes et imprévisibles que la politique migratoire. Cette subordination ne représente-t-elle pas d’ailleurs un avatar complètement obsolète de la politique européenne de la Suisse au siècle dernier ? Le découplage obtenu avec la fin de la libre circulation des personnes aurait au moins un effet vertueux: stabiliser la participation suisse aux programmes-cadres européens de recherche.
Ce qui revient à formuler l’évidence suivante: le plus sûr moyen pour la Suisse d’assurer durablement son statut d’association aux programmes-cadres de recherche, c’est de ne plus faire partie de la politique européenne d’élargissement, mais de relever de la politique de voisinage (PEV).

1 – Historique
Les programmes-cadres européens de recherche remontent à 1984. L’impulsion est venue du président François Mitterrand, soucieux de faire de l’UE le premier pôle mondial de technologies de l’information (IT). Le projet s’était intitulé « Esprit ». Du nom de la prestigieuse revue intellectuelle française, dont l’ambition est encore aujourd’hui « de penser autrement les liens entre l’esprit européen, les valeurs occidentales et le reste du monde ».
Le projet et ses étapes successives de réalisation, jusqu’à aujourd’hui, sont imprégnés d’ouverture sur le monde. La finalité est aussi d’attirer en Europe des chercheurs, des entités et des projets de recherche gravitant tendanciellement autour des Etats-Unis (et d’Asie actuellement). D’où la multiplication d’accords de coopération et d’association (y compris avec les Etats-Unis et la Chine).
On ne peut pas dire rétrospectivement que cet objectif de leadership ait été atteint. L’industrie européenne, dans le IT en particulier, a même connu un véritable décrochage technologique. Au point de donner l’impression de ne plus pouvoir, ni même vouloir revenir au premier plan.
Lorsqu’un white paper de la Commission Européenne précisait en février dernier les ambitions de l’UE en matière de numérique et d’intelligence artificielle, c’était surtout de suprématie régulatoire, juridique et sécuritaire dont il était question.
Tout se passe en fait aujourd’hui comme si la finalité était en premier lieu de protéger les Européens contre la domination asiatique et américaine dans certains secteurs-clés. Au sens plus prosaïque du protectionnisme économique non tarifaire également, dont l’Europe n’a évidemment pas l’exclusivité.
Depuis les années 1980, la technostructure européenne de recherche s’est élargie, centralisée et lourdement complexifiée. Dans les domaines des sciences exactes, humaines, sociales ou encore environnementales. La matière couverte par l’institutionnel communautaire s’est développée et approfondie en passant essentiellement par le réseau académique. L’exigence de pureté de la science par rapport aux risques de corruption par des intérêts privés est en effet sensiblement plus élevée en Europe que dans le reste du monde.
L’intégration européenne la plus avancée
La Suisse a très tôt intégré ce vaste dessein géostratégique sur la base d’un accord prévoyant explicitement sa participation aux programmes-cadres européens de recherche (1986). Le traité est toujours en vigueur aujourd’hui. L’Accord sur la recherche de 1999, constitutif des Accords bilatéraux I et appliqué depuis janvier 2004, y ajoute la notion d’association.
La Confédération ne finance plus directement, ni au cas par cas les participations suisses à des projets européens de recherche. Elle verse un forfait dans le budget communautaire, calculé sur la base du produit intérieur brut rapport à celui de l’Union. Les participations suisses sont ensuite financées par cette centrale d’attribution.
Accès, participation, association – On peut dire en ce sens que le financement public de la recherche est la forme la plus aboutie d’intégration suisse dans l’Union Européenne. Ce qui ne manque pas de subtilité institutionnelle lorsque l’on compare avec l’environnement juridique des Accords bilatéraux I.
Avant ces accords sectoriels, comprenant le libre accès aux marchés du travail (libre circulation des personnes), la Suisse accédait partiellement au marché européen. Aujourd’hui, elle y accède toujours partiellement, mais elle y participe aussi. Ce qui signifie en gros qu’elle adopte les règles de circulation des ressources humaines, des capitaux, des biens et des services. Sans être associée toutefois aux décisions législatives et réglementaires, ni être forcément présente en tant qu’observatrice.
Dans le domaine de la recherche en revanche, les Accords bilatéraux I ont fait passer la Suisse de participante à pleinement associée. Avec présence possible d’observateurs à tous les échelons de décision, sauf la conception elle-même des programmes-cadres. Ce qui signifie qu’elle dispose probablement d’un certain pouvoir d’influence.

2 – Sources
A parcourir le web dans tous les sens, on ne peut pas dire que l’association ou non de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche ait suscité jusqu’ici un grand intérêt de la part des analystes et commentateurs en Europe. En Suisse, à la demande du Parlement, ce thème a toutefois fait l’objet de rapports périodiques du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Ces documents sont traduits en français et accessibles sur le site de la Confédération. Ce sont les premières sources d’un champ d’investigation fort peu documenté par ailleurs, se contentant en général d’explications superficielles et lourdement répétitives.
Haut degré de transparence – Un rapport « faits et chiffres » de 100 pages est ainsi paru en 2018. Un rapport d’impact (effets de la participation suisse) a suivi un an plus tard (75 pages). Ces deux textes très techniques permettent de se faire une idée précise et relativement concrète des enjeux.
Des six Accords bilatéraux I hors libre accès aux marchés du travail (libre circulation), le traité sur la recherche est d’ailleurs certainement le plus transparent. C’est aussi, et de loin, le plus équilibré. Il bénéficie à peu près autant à la Suisse qu’à l’UE sur le plan matériel. Les conséquences de son éventuelle abrogation sont aussi les plus faciles à mesurer.
Les rapports du SEFRI regorgent de chiffres et de graphiques. Ils sont surtout destinés à montrer que le traité sur la recherche est équitable sur le plan des contributions suisses et des retours européens. Ils convainquent également avec aisance que la Suisse est une fort bonne compétitrice dans la captation de subventions et de coordinations de projets publics.
Le terrain de jeu s’avère bouillonnant. Tous les mouvements sont traçables et analysables dans le détail. Le propos manque en revanche singulièrement de perspective, ce qui ne surprend pas venant d’un Secrétariat d’Etat soumis à des devoirs de réserve. Les rapports n’entrent pas en matière sur d’autres approches possibles ou nécessaires. En particulier celle consistant à situer la participation aux programmes-cadres européens dans l’investissement global de la R&D en Suisse (lire plus bas).
Ces rapports sont peu explicites également sur les enjeux immédiats ou plus durables des échéances de politique intérieure s’agissant de participation aux programmes-cadres européens. Vouloir s’en faire une idée passe par des recoupements à partir de différentes sections des sites de la Confédération et de l’Union Européenne, des médias, de revues spécialisées et de contacts personnels.

3 – La course aux subventions
Il n’est pas étonnant que le Parlement attende du SEFRI des rapports approfondis et rassurants s’agissant de recherche. Sans rien demander de comparable sur les autres Accords bilatéraux I, sauf peut-être la libre circulation des personnes de manière plus diffuse. Ne s’agit-il pas d’utilisation de fonds publics ? On peut également deviner sur le plan sociologique, avec les précautions d’usage, que l’affinité entre parlementaires, fonctionnaires et microcosme de recherche est relativement élevée. Davantage qu’en matière de transports routiers, de marchés publics dans la construction, ou encore d’agriculture.
Le paradoxe, par rapport à cette transparence, c’est que le public lui-même n’a pas l’air de bien se rendre compte que l’accord menacé sur la recherche porte essentiellement sur les sciences exactes et humaines dans le champ étroit du subventionnement public.
L’opinion a au contraire tendance à penser que c’est l’ensemble des activités de recherche et développement qui est en cause. Dont il connaît intuitivement l’importance vitale pour l’industrie, les services et la prospérité du pays. Il y aurait effectivement de quoi s’inquiéter si c’était le cas.
Le rapport de 2018 décrit une véritable compétition pour la “captation” de subventions. Un peu à la manière de ce qui se passe avec le Fonds national suisse (FNS, anciennement Fonds national de la recherche scientifique). On peut aussi voir l’association aux programmes européens comme une modeste extension européenne des financements publics du FNS.
Le Fonds national suisse a alloué près de 1,2 milliard de francs en 2018 à quelque 3000 dossiers bénéficiaires (sur 6000 requêtes). Fin 2017, la contribution annuelle moyenne de la Suisse au programme-cadre Horizon 2020 s’est élevée de son côté à 180 millions de francs seulement. Le nombre moyen de participations à des projets a été de 500 par année. Dont une centaine coordonnées depuis la Suisse.
Les institutions de loin les plus concernées par Horizon 2020, jusqu’en 2018, ont été les Ecoles polytechniques fédérales et les universités cantonales. A hauteur de 60% environ des fonds rétrocédés à la Suisse projet par projet en moyenne annuelle.
Les hautes écoles spécialisées (HES) captent quant à elles 3,5% seulement de la manne. L’industrie et les associations sans but lucratif s’octroient une part de 35% environ, beaucoup plus élevée dans Horizon 2020 qu’auparavant. Les subsides publics y sont en général complémentaires d’investissements privés (partenariats public-privé, bien que le terme ne soit jamais employé dans les rapports du SEFRI).
Le niveau moyen de financement public par participation de petites ou micro-entreprises privées est de 100 000 francs (start-up comprises), alors qu’il est de près de 590 000 francs toutes catégories confondues (écoles et grandes industries). Les entreprises sont encouragées à concourir, un bon taux de participation de leur part étant considéré par la Confédération et l’UE comme un succès en soi. Ce qui montre aussi que les entreprises ne sont pas attirées spontanément. L’offre d’Horizon 2020 a d’ailleurs développé des programmes spécifiques et attractifs destinés à les convaincre.
Impact honorable mais sans levier
Le rapport d’impact de 2019 se base sur un sondage de satisfaction auprès de participants suisses aux programmes européens depuis 2003. 4400 questionnaires ont été envoyés, pour quelque 900 répondants.
Les effets sont en général et sans surprise jugés satisfaisants de la part des hautes écoles. Les participations génèrent en moyenne un emploi dans chaque cas (permanent ou temporaire). Comme l’on pouvait également s’y attendre, le secteur privé est plus critique. 30% seulement des entreprises ou indépendants annoncent que leur participation a conduit à des réalisations commerciales.
La proportion descend à 10% s’agissant de grandes entreprises. 10% également des sondés dans l’industrie et les services mentionnent toutefois la création d’une nouvelle entreprise. Près de 50% précisent que leur participation a tout de même favorisé la mise au point de nouveaux produits ou services. 50% des participations du privé ont généré un brevet (dont les éventuelles applications industrielles ne sont pas précisées).
L’impact macro-économique paraît assez décevant en termes de levier: les subventions se “contentent” de financer des emplois, en général sans multiplicateur avéré. Le rapport insiste donc plutôt sur l’importance des programmes-cadres européens dans la constitution et la pérennité de réseaux personnels. Ces maillages se constituent beaucoup autour des consortiums de recherche.
A en croire les questionnaires, ce sont surtout les HES et les entreprises qui y voient un intérêt spécifique. Les écoles polytechniques et les universités ont une plus grande ancienneté à l’international. Obtenir des subventions passe pour elles avant le networking. On peut supposer que les entreprises suisses, qui ne manquent en général pas d’ouverture sur le monde, voient quand même dans les relations suivies avec des partenaires plus étroitement européens l’occasion d’élargir et de diversifier leurs contacts.
A noter, pour mieux se représenter ce dont on parle, que le programme-cadre Horizon 2020 portait en premier lieu sur les « défis sociétaux » : 30 milliards d’euros pour la recherche « fondée sur les priorités politiques de la stratégie» à l’échelle européenne. Dans l’ordre : santé, transports, énergie, alimentation (avec agriculture et recherche aquatique), climat et environnement, sociétés sûres et sociétés inclusives. Vient ensuite la recherche fondamentale dans tous les domaines (25 milliards), infrastructures numériques européennes en premier lieu.
La « primauté industrielle » n’arrive qu’en troisième position (IT, biotechs, nanotechs, matériaux, systèmes de production, chaînes d’innovation dans les défis sociétaux jusqu’à la commercialisation non comprise) : 17 milliards d’euros, dont 600 millions seulement pour l’innovation dans les petites entreprises. La recherche nucléaire mobilise encore 5 milliards, et divers « piliers » secondaires se partagent les 6 milliards restants.

4 – Ce que représentent les programmes européens dans la R&D en Suisse
L’hypothèse d’une mise à l’écart de la Suisse des programmes-cadres européens de recherche en cas de « mauvaise » décision populaire sur la politique migratoire de la Confédération n’est absolument pas nécessaire. La fin de la voie bilatérale vers l’intégration signifierait au pire que la Suisse redeviendrait une simple participante aux PCR (Etat tiers). C’est-à-dire que le Secrétariat d’Etat à la recherche financerait directement les diverses participations, au lieu de passer par la hiérarchie européenne d’octroi des subventions et subsides.
Cela dit, il n’est pas inutile de vérifier que ce scénario maximal et invraisemblable d’éviction pure et simple ne plongerait nullement la Suisse dans le néant. Selon divers inventaires, les évaluations globales des différents types d’investissements réalisés en Suisse dans la R&D (privés et publics) tournent autour des 23 milliards de francs par an. C’est le chiffre retenu par le SEFRI dans une note non datée du site de la Confédération. L’investissement annuel dans le pot commun et public européen, avec le retour sur investissement, ne représente donc que 1,5% environ de l’ « effort national » d’innovation.*
A noter à ce sujet que le classement périodique d’août 2017 du réseau international de conseil Ernst & Young plaçait la Suisse en tête dans l’intensité de la R&D dans les entreprises : 6.6% du chiffre d’affaires (devant les Etats-Unis). Par rapport au produit intérieur (PIB), la Suisse vient en quatrième position dans le monde après la Corée, Israël et la Suède (privé et public cumulés). Avec un biais toutefois : l’industrie pharmaceutique pèse à elle seule 35% des investissements privés en Suisse.
* Le chiffre officiel disponible le plus récent de la contribution suisse à Horizon 2020 est celui du rapport de 2018 : 724 millions de francs pour la période 2014-2017. Soit 181 millions en moyenne annuelle, ce qui représente précisément 0,78% des investissements dans la R&D en Suisse. Cette période est toutefois faussée par les deux années d’association partielle (2014-2016), pendant lesquelles la contribution suisse a été plus basse que d’ordinaire (voir point 7 ). Nous avons compté très largement en multipliant 0,78% par deux pour cette raison.
 5 – Ce que renoncer au statut d’association voudrait dire
5 – Ce que renoncer au statut d’association voudrait dire
Sans statut d’association, la Suisse devrait donc financer directement ses participations. Avec des incidences certainement négatives sur les coûts de gestion. Les projets et consortiums ne seraient acceptés que s’ils présentaient un intérêt pour l’UE (pour autant que ce ne soit pas le cas aujourd’hui). Les Suisses n’auraient plus d’observateurs dans les instances dirigeantes ni les comités de pilotage. Leur niveau d’information s’en ressentirait.
Les remarquables performances des partenaires suisses dans la captation de subventions en seraient affectées. Il n’est pas sûr que les chercheurs suisses continueraient de détenir le record des meilleurs taux de succès des projets proposés. (Encore que les chercheurs américains et asiatiques non associés semblent faire légèrement mieux à 17,8%.) Est-ce bien nécessaire toutefois de figurer parmi les légendes européennes de la captation de subventions ? Sachant en plus qu’elles sont indirectement financées par la Suisse ? Ce n’est pas la question en l’occurrence. Nul ne sait d’ailleurs ce qu’en penserait le corps électoral si elle lui était posée de cette manière.
Les chercheurs et entités suisses de recherche pourraient en principe continuer de coordonner la réalisation de programmes, comme ils le font actuellement (une centaine dans Horizon 2020). Avec certainement, comme nous l’avons vu, quelques difficultés supplémentaires. Les hautes écoles ne pourraient plus en revanche envisager de piloter de grands projets européens. Les fameux et très disputés « Flagships », toujours bien présents sur le terrain médiatique. Cette déficience induirait une certaine déperdition en termes de prestige académique.
Il n’est pas inutile cependant de relativiser ce qui serait sans doute ressenti dans le microcosme de la recherche comme une humiliante relégation. Conçus au début des années 2010, les Flagships sont des mégaprojets à plus d’un milliard d’euros de budget sur dix ans. Mais ils sont rares.
Horizon 2020 n’en a connu que trois (initiés quelques années auparavant) : Graphene, Human Brain Project et Quantum. Horizon Europe (2027) a envisagé d’en lancer six autres, dont un suisse (le controversé Time Machine à Lausanne). Mais le concept lui-même a finalement été abandonné : trop grand, trop long, trop lourd. Les consortiums européens de recherche sont souvent des usines à gaz. Ceux-là atteignent des niveaux de complexité démesurés dans la gouvernance et la gestion.
Comme chacun sait, le programme Human Brain (qui court jusqu’en 2023) est coordonné à Genève par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Cette expérience regroupe 800 chercheurs en Europe et Israël, et plus de 130 grandes institutions partenaires. Elle n’a cessé d’être confrontée à des tensions centrifuges sur le plan des objectifs, des doctrines, des ambitions, des égos, des moyens, des appareils et mentalités administratives. Orientée vers la réplication numérique des fonctionnements cognitifs, la culture d’ingénierie de l’EPFL s’est en particulier heurtée aux critiques et désistements des réseaux de recherche fondamentale en neurosciences.
La localisation en Suisse de Human Brain s’est en plus avérée problématique face aux trois grandes puissances de recherche que sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. En burn out, le directeur Chris Ebell démissionnait en 2018. Son équipe reconnaissait alors qu’il était peut-être temps de partager une coordination devenue ingérable. C’est une des raisons pour lesquelles le prochain et neuvième programme-cadre se contentera de « grands projets » plus modestes et moins centralisés.
L’université de Genève assume déjà une coordination partagée dans le flagship Quantum. Il n’est pas certain qu’un statut d’association durablement partielle rende à l’avenir impossible l’accès de la Suisse à ce genre de méga-gouvernance redimensionnée. D’autant moins que le futur statut de la Grande-Bretagne, qui reste entièrement à établir à quelques mois de la mise en route théorique d’Horizon Europe, est susceptible de faire évoluer la rigidité institutionnelle de l’Union. Dans un domaine qui se prête peu au dogmatisme politique.

6 – La Suisse grossièrement discriminée
Complexe et peu transparent lorsque l’on sort des rapports officiels, le dossier du traité bilatéral de 1999 sur la recherche (constitutif des Accords bilatéraux I) devient surréaliste lorsque l’on examine la question des statuts sous l’angle comparatif.
Comme évoqué plus haut, divers Etats dans le monde, jusqu’en Asie et en Amérique (Etats-Unis, Canada, Japon, Corée, Chine, Brésil, Argentine, etc), ont de « simples » accords de partenariat et coopération scientifiques avec l’UE. Ce qui signifie qu’ils n’ont pas accès à tous les grands domaines des programmes-cadres de subventionnement. Ils n’ont pas non plus d’observateurs en principe dans les instances dirigeantes et de pilotage.
La Norvège, l’Islande et la Suisse, relevant depuis les années 1990 de la politique d’élargissement de l’UE, avec objectif d’adhésion abandonné en cours de route, sont au contraire censés avoir le « privilège » d’un accord anticipé de pleine association.
C’est toutefois le cas aujourd’hui de treize autres Etats également, relevant d’une politiques européenne d’élargissement plus tardive, ou d’une simple politique de voisinage (voir Annexe I): Israël, Turquie, Serbie, Arménie, Géorgie, Ukraine, Tunisie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Montenegro, Moldavie, Macédoine du Nord et Iles Féroé.
Selon l’expression consacrée, on peut dire que ces Etats ont obtenu le beurre et l’argent par rapport à la Suisse. L’UE leur a accordé un statut de plein associé sans contrepartie exogène. Alors qu’elle ne l’a concédé à la Suisse qu’en échange du libre accès à son marché du travail dans le cadre des Accords bilatéraux I, liés juridiquement par un principe de parallélisme (clause guillotine).
En cas de résiliation de l’Accord sur la recherche de 1999, pour cause de rejet de la libre circulation et de clause guillotine, la Suisse serait donc menacée d’être moins bien lotie que ces treize Etats périphériques. Comme ce fut le cas après le vote de février 2014, et jusqu’à fin 2016, elle se retrouverait sur le même plan institutionnel que les Etats « tiers » d’Amérique et d’Asie.
Cette discrimination serait bien entendu complètement absurde (sans même parler d’inéquité). Comme elle l’a d’ailleurs été entre 2014 et 2016. Mais le cas du Royaume-Uni, poids lourd de la R&D en Europe, pourrait là aussi rebattre certaines cartes. Sans libre circulation des personnes, la Grande-Bretagne ne devrait-elle pas relever quand même, et au minimum, de la politique ordinaire de voisinage de l’UE en matière de recherche ? C’est-à-dire au même niveau d’association que, disons… l’Albanie (par ordre alphabétique) ? Et si c’était de toute évidence le cas, on ne verrait pas très bien pourquoi la Suisse ne pourrait pas obtenir d’égalité de traitement.

7 – Le trou de 2014-2016
L’Accord d’association de la Suisse à Horizon 2020 n’était pas encore complètement finalisé lorsque le vote populaire contre la libre circulation des personnes du 9 février 2014 a soudainement déstabilisé les Accords bilatéraux I par effet de parallélisme (clause guillotine).
S’en prendre sur le champ aux cinq autres accords n’a apparemment guère été envisagé du côté de Bruxelles (transports aériens, terrestres, marchés publics, agriculture, reconnaissance des normes techniques). On peut comprendre cette réserve: l’application de ces traités depuis les années 2000 s’est avérée très à l’avantage des Européens. L’occasion de réagir s’est en revanche présentée dans la recherche, beaucoup plus équilibrée, avec en plus des négociations en cours. La procédure fut aussitôt suspendue.
La perspective d’une relégation pure et simple de la Suisse parmi les Etats tiers asiatiques et américains semblait en même temps inconcevable. La Commission européenne n’avait-elle pas conclu, ou n’était-elle pas en train de négocier en parallèle des accords de pleine association avec treize Etats périphériques ? Sans libre accès réciproque aux marchés du travail (libre circulation), ni aucun accord de partenariat comparable à ce qui imbrique la Suisse dans l’Union Européenne ?
Marginaliser ainsi la Suisse, référence en matière de R&D, de manière aussi irrationnelle, eût été difficilement assumable politiquement. Les menaces et rapports de force bruts recèlent parfois des limites lorsqu’il s’agit de passer à l’acte. Le radicalisme d’un tel bannissement eût en plus été clairement dommageable pour la recherche en Europe.
Il était en même temps important pour la Commission européenne que des représailles soient réellement exercées. De manière à tenir parole et à faire prendre conscience aux Suisses égarés qu’ils devaient rapidement revenir à de meilleures dispositions. Il fut donc convenu de négocier une sorte de compromis octroyant à la Suisse un statut singulier, suffisamment vexatoire mais néanmoins provisoire d’Etat « partiellement associé ».
Schématiquement : la pleine participation à la recherche fondamentale était maintenue (peut-être par solidarité académique bien comprise). Les subventions européennes destinées à des projets venant de l’industrie n’étaient en revanche plus garanties, la Confédération s’empressant néanmoins de les compenser au cas par cas.
L’important domaine des « défis sociétaux » était lui aussi précarisé. Il se retrouvait également à la charge d’un Secrétariat d’Etat que les questionnaires du rapport d’impact allaient qualifier plus tard de très performant dans l’octroi de subventions de substitution (santé, alimentation, énergies, climat, environnement, etc).
Dans la pratique et dans bien des cas, les diverses instances européennes de décision ont certainement sur-réagi. Les conséquences de ne plus pouvoir « participer » aux programmes-cadres européens de recherche avaient été abondamment évoquées lors de la tumultueuse campagne politique qui avait précédé le scrutin de février 2014. Avec une résonnance un peu confuse dans le microcosme académique en Europe. Parfois assez subtiles, les différences entre «participation en tant qu’Etat tiers », «association » et « association partielle » ne furent pas toujours bien comprises dans des milieux scientifiques continentaux peu réceptifs aux brutales finesses de la politique européenne d’élargissement.
Un lourd climat d’incertitude s’est alors installé, doublé d’une certaine méfiance par rapport à des partenaires suisses perçus tout d’un coup comme peu fiables. Le fait de les pénaliser le plus durement possible n’allait-il pas d’ailleurs les obliger à se mobiliser davantage pour faire rentrer l’opinion publique suisse dans le rang ?
Le nombre de participations suisses validées par les instances européennes s’est tout de suite mis à reculer massivement et de manière désordonnée. En particulier dans les coordinations de projets. A en croire le rapport de 2008 du SEFRI, la Commission européenne elle-même a dû parfois intervenir pour soutenir envers et contre tout certaines participations suisses. Ce n’est qu’en 2017 que la situation a commencé de se normaliser. Lorsque le Parlement a décidé de renoncer à la résiliation de la libre circulation malgré la décision populaire. Et que le droit d’accès à une activité économique en Suisse a pu être étendu à la Croatie.
 8 – Horizon Europe (2027) et Espace européen de recherche.
8 – Horizon Europe (2027) et Espace européen de recherche.
Sept ans plus tard, l’histoire donne un peu l’impression de se répéter. Le scrutin sur la deuxième initiative de l’UDC a été reporté au second semestre 2020 pour cause de crise sanitaire. Si le projet d’article constitutionnel était de nouveau accepté, l’ « accident » se produirait avant que les négociations pour l’association de la Suisse à Horizon Europe (2021-2027) aient été finalisées.
Avec le Brexit, c’est d’ailleurs tout le processus de mise en place de ce programme-cadre qui a pris du retard. Nul ne sait encore quel sera le statut du Royaume-Uni, deuxième puissance européenne de R&D derrière l’Allemagne et devant la France. Sa relégation pure et simple parmi les Etats tiers, derrière les treize Etats périphériques associés, semble cependant aussi peu vraisemblable que celle de la Suisse.
Il n’est pas certain que Britanniques et Européens attendent d’avoir conclu un accord de partenariat général avant que des négociations s’engagent en vue d’une éventuelle association dans la recherche. C’est d’ailleurs ce qu’anticipait le SEFRI dans une information du 31 janvier dernier, au moment de l’entrée en vigueur du Brexit : «Comme la Suisse, le Royaume-Uni doit négocier avec l’UE une éventuelle association à Horizon Europe.»
Il n’y a toutefois pas encore de mandat de négociation côté suisse, bien que le background politique à régler semble bien plus léger qu’avec la Grande-Bretagne. Problématique et retardé lui aussi pour cause de crise sanitaire, l’Accord-cadre institutionnel Suisse-UE en suspens n’aurait pas d’effet sur la recherche à en croire certains commentaires plus ou moins officiels à Berne (la recherche n’étant pas considérée comme un marché). La future association dans Horizon Europe ne serait donc déstabilisée que par la fin de la libre circulation des personnes (voir Annexe II).
S’agissant du Royaume-Uni en revanche, il paraît évident qu’une association ne serait pas conditionnée par un accord de libre circulation des personnes (les Britanniques n’en veulent plus). En cas d’acceptation de la deuxième initiative de l’UDC, la Suisse se retrouverait donc théoriquement dans une situation très comparable à celle de la Grande-Bretagne. Il deviendrait difficile pour les Européens de négocier avec l’un sans se référer à l’autre s’agissant de recherche.
La différence entre l’un et l’autre serait surtout juridique : la Suisse devrait encore s’extraire du parallélisme des Accords bilatéraux I et de la voie bilatérale vers l’intégration. Alors que le Royaume-Uni, après plus de trois ans de contorsions pour y échapper malgré le référendum de 2016, a déjà réalisé formellement son Brexit.
Ces nouvelles circonstances pour la recherche en Europe pourraient être l’occasion de relancer l’Espace européen de la recherche (EER). Initié à Lisbonne en 2000, cet European Research Area (ERA) est un ensemble de principes à cultiver sous une Direction générale de la recherche et de l’innovation.
L’EER a évidemment ajouté une couche institutionnelle à la gestion des programmes-cadres, qui n’en manquait pas. Mais il comprend aussi la double volonté de favoriser davantage l’ouverture vers l’extérieur. Avec mobilité des chercheurs et projets à l’intérieur de l’espace élargi aux partenaires associés.
Appliqué partiellement dans les 6ème, 7ème et 8ème programmes-cadres, l’EER a apparemment négligé cette dimension personnelle de la mobilité. L’occasion semble se présenter pour le Royaume-Uni et la Suisse de proposer une libre circulation des chercheurs en remplacement de la libre circulation générale des ressources humaines sur les marchés nationaux du travail. Couvrant quarante-quatre Etats, cette nouvelle liberté aurait au moins l’avantage de l’unité de matière.

Annexe I
A propos de Club des Treize
Seize Etats non-membres de l’UE sont (comme la Suisse) pleinement associés aux programmes-cadres européens de recherche :
– les deux Etats membres de l’Espace économique européens (EEE) : Norvège et Islande (depuis 1994). Leur association à chaque programme-cadre fait cependant l’objet de négociations particulières (comme avec la Suisse) ;
– la Suisse depuis 2004, avec son statut général de substitution à l’EEE (voie bilatérale vers l’intégration avec libre circulation des personnes et Accords bilatéraux I) ;
– six Etats candidats à l’adhésion à l’UE, relevant de la Politique européenne d’élargissement : la Turquie (depuis 2003), la Serbie, l’Albanie, la Macédoine, le Montenegro, la Bosnie-Herzégovine (première association dans les années 2000 également) ;
– six Etats non-candidats relevant de la « simple » Politique européenne de voisinage (PEV) : Israël (depuis 1996), Ukraine, Moldavie, Géorgie, Arménie (dans le programme-cadre 2007-2013 déjà) et Tunisie (2016) ;
– les Iles Feroë enfin, qui ont un statut général d’association avec l’UE depuis les années 1970.
Treize Etats hors Espace économique EEE ont donc obtenu le même statut que la Suisse, sans le fatras de conditions liées juridiquement dans les Accords bilatéraux I (dont la libre circulation des personnes).
A noter sur le plan chronologique : la Suisse, dans les années 1990, encore considérée à l’époque comme candidate à l’adhésion (jusqu’en juillet 2016), mettait dans la balance des Accords bilatéraux I son futur statut d’associée aux programmes-cadres de recherche (en négociation). Or, Israël avait déjà obtenu ce statut sans aucune des conditions exogènes imposées à la Suisse (exogènes, c’est-à-dire n’ayant rien à voir avec la recherche scientifique et son financement).
Quinze ans plus tard, l’UE retirait à la Suisse son statut d’associée aux programmes-cadres suite au vote populaire de février 2014 sur la libre circulation des personnes. Or, Bruxelles était à ce moment-là en pleine négociation avec les 13 autres Etats non membres pour une association à Horizon 2020, rétroactive au 1er janvier 2014 (2016 dans le cas de l’Arménie, de la Géorgie et de la Tunisie, et août 2015 dans le cas de l’Ukraine). Sans libre circulation des personnes encore une fois.
A noter encore, pour être complet, que ces treize Etats bénéficient vraiment du même statut d’association que la Suisse, sur les mêmes bases de financement : un calcul incluant le PIB du pays par rapport au PIB de l’UE, en fonction de l’importance de la participation prévisible.
Dans le 7ème programme-cadre (2007-2013), les participants turcs avaient obtenu quelque 200 millions d’euros de subventions pour 950 projets. En janvier 2017, Israël célébrait ses vingt ans d’association en annonçant 1,4 milliard d’euros de contributions cumulées pour 1,7 milliard de retours enregistrés.
Les niveaux d’association sont évidemment plus modestes pour des Etats comme la Serbie (53 millions d’euros de retours pour 307 projets dans le 7ème programme-cadre), la Macédoine (12 millions), le Montenegro (4 millions), la Moldavie (4 millions), la Bosnie-Herzégovine (3 millions) ou l’Albanie (2,5 millions).
L’UE accorde parfois des « rabais » de contribution forfaitaire, ou des facilités de paiement dans le cadre de sa politique de développement. Avec l’appui dans certains cas de la Banque européenne d’investissement. L’UE peut aussi exiger des réformes dans la politique de recherche scientifique des nouveaux associés, avec revue périodique des pairs.

Annexe II
Clause guillotine et flou juridique
Le traité de coopération scientifique et technique de 1986 entre la Suisse et les Communautés européennes (CE) a une portée élevée et générale qui en fait rétrospectivement une sorte de déclaration d’intention (un peu plus concrète toutefois sur la recherche nucléaire, sujet central à l’époque). Entre autres dispositions, l’accord rendait possible la participation de la Suisse aux futurs programmes-cadres européens de recherche. D’éventuelles associations devaient toutefois faire l’objet d’accords spécifiques portant sur chacun d’eux.
Les cinq premiers programmes-cadres ont intégré les hautes écoles et institutions suisses sous forme de participations projet par projet. Chaque projet étant financé par la Confédération. Dans le cadre des Accords bilatéraux I finalisés en 1999, la Suisse a obtenu dès 2004 le statut d’associée au 6ème programme-cadre (2002-2006) : contribution forfaitaire au budget européen, puis financement européen des projets suisses. Avec observateurs suisses dans les instances européennes de subventionnement.
Ce statut d’associé a été renouvelé dans un autre accord bilatéral de coopération scientifique portant sur le 7ème programme cadre. Et ainsi de suite. Il a fallu un autre accord bilatéral encore pour sceller l’association au 8ème programme (2014-2020). Il en faudra encore un autre pour associer la Suisse au programme Horizon Europe (2021-2027).
Cette contrainte de renouvellement périodique est absente des six autres Accords bilatéraux I. Ce qui fait parfois dire que la recherche n’est pas vraiment soumise au parallélisme de ces accords liés juridiquement (clause guillotine).
Selon cette interprétation : si l’accord sur le droit d’accès des Européens à une activité économique en Suisse était résilié par la Suisse (libre circulation), la clause guillotine ne s’appliquerait pas à la recherche. Temporaires, les accords d’association aux programmes-cadres ne sont-ils pas forcément d’une autre nature ?
C’est bien ce que l’on affirme également par ailleurs en proclamant qu’ils ne sont pas des accords d’accès au marché. Qu’ils ne sont donc pas concernés par le projet d’Accord-cadre institutionnel Suisse-UE en suspens (voir plus haut).
Il n’y a en réalité guère de raisons de penser que le lien juridique, imposé par les Européens pour sanctuariser la libre circulation et sécuriser la voie bilatérale vers l’intégration, n’annulerait pas formellement l’actuel, ni les futurs accords d’association dans la recherche. Rien ne s’y oppose apparemment. Le niveau de détail de ces considérations semble en plus d’une pertinence très relative dans un domaine régi par deux ordres législatifs différents.
Il est vrai cependant que ces accords d’association sur la recherche ont un caractère juridique particulier dans les Bilatérales I. Tant les Suisses que les Européens ont explicitement prévu que leur résiliation par les uns ou les autres n’impliquerait pas automatiquement, ni dans les six mois, une annulation globale du paquet d’accords. Il y aurait bien une sorte de clause guillotine, mais sans automaticité.
Dans son message du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, le Conseil fédéral précisait d’ailleurs que la clause guillotine « ne s’appliquait ni en cas d’expiration ordinaire de l’Accord de coopération scientifique, ni en cas de dénonciation de cet accord par la Suisse à la suite d’une modification par les CE des programmes-cadres auxquels la Suisse est associée. »
Tant les Européens que les Suisses peuvent en revanche décider unilatéralement que la rupture des accords d’association aux programmes-cadres mettrait fin aux Accords bilatéraux I. Ce scénario n’est pourtant guère réaliste : ni la Suisse, ni l’Union Européenne n’ont le moindre intérêt à saborder ces accords d’association dans la recherche. C’est plutôt dans le sens l’inverse que le problème se pose : l’Union européenne a tendance à utiliser la recherche comme objet de chantage et de représailles à propos de libre circulation.
Dans un avis de droit de 2013, Christine Kaddous, professeure à l’Université de Genève et directrice du Centre d’études juridiques européennes, précisait encore que «l’accord sur la coopération scientifique et technique de 2007 pourrait aussi être concerné, même s’il n’est pas stricto sensu rattaché à la clause guillotine, compte tenu de la décision du Conseil et de la Commission de 2008, laquelle prévoit que cet accord ne serait pas prorogé en cas de non-reconduction ou de dénonciation des accords bilatéraux I. Le risque existe donc également pour cet accord, même s’il ne contient pas formellement une disposition telle que celle de l’article 25, paragraphe 4, de l’Accord sur la libre circulation des personnes. »
Cet avis a parfois été sur-interprété lui aussi, comme s’il suggérait que la clause guillotine ne s’appliquait pas à la recherche. Il fait seulement ressortir en réalité que c’est le délai de résiliation de six mois des Accords bilatéraux I en cas de guillotine qui ne s’appliquerait pas à l’accord d’association en cours (2007-2013 à l’époque). L’association durerait jusqu’à la fin du programme-cadre, mais elle ne serait pas reconduite lors du programme suivant.





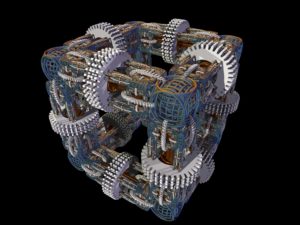












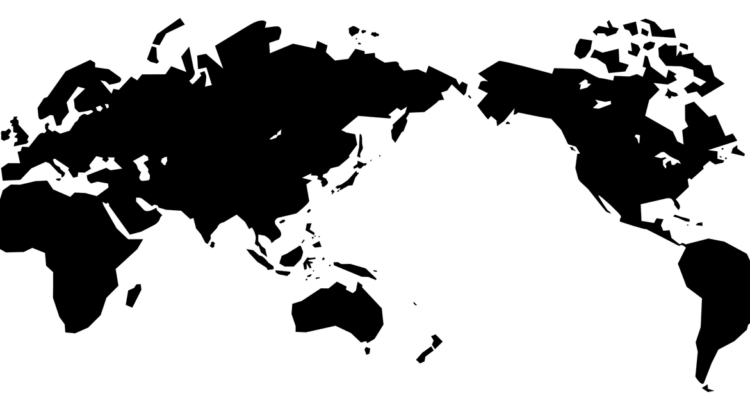
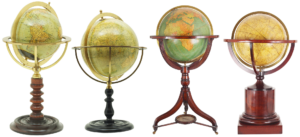








 Ce n’est peut-être qu’une vague start-up financière de quelques personnes, localisée dans un espace de coworking sur le Quai de l’Ile à Genève, mais la libra concentre un maximum d’attention au plus haut niveau dans le monde. Rien à voir avec les techno-pignoufleries spéculatives du bitcoin.
Ce n’est peut-être qu’une vague start-up financière de quelques personnes, localisée dans un espace de coworking sur le Quai de l’Ile à Genève, mais la libra concentre un maximum d’attention au plus haut niveau dans le monde. Rien à voir avec les techno-pignoufleries spéculatives du bitcoin.


















