Lorsque nous étions enfants, la grille télévisée des fêtes nous rassurait avec son rituel immuable de films, dont L’homme au masque de fer, qui nous effrayait ce qu’il fallait. Paul Sonnino a livré en 2016 l’une des plus récentes interprétations historiques de ce fait poussé au mythe [1]. Le masque aurait été plutôt de velours, porté en intermittence, mais quoi qu’il en soit, l’effet du récit et de toutes ses variantes dit bien notre angoisse culturelle liée au fait de ne plus pouvoir montrer son visage.
Ce sentiment est ravivé aujourd’hui à chaque fois que nous contemplons des images de prisionniers torturés sous d’autres latitudes que les nôtres, souvent les visages recouverts ou masqués. Réfléchir au visage, à sa place dans notre culture, c’est bien sûr aussi faire mémoire de la pensée du philosophe Emmanuel Lévinas qui estimait notamment que « l’épiphanie du visage suscite cette possibilité de mesurer l’infini de la tentation du meurtre, non pas seulement comme une tentation de destruction totale, mais comme impossibilité – purement éthique – de cette tentation et tentative » [2]. Martin Grandjean, doctorant en histoire à l’Université de Lausanne, a fait une analyse synthétique de la pensée de Lévinas sur ce thème dans un billet de blog de 2013.
Impossible donc de penser à la burqa, au visage caché, sans que ne reviennent en mémoire ces souvenirs culturels, cette matrice culturelle, du masque de fer à Lévinas. Et cela sans même encore avoir abordé la question du statut de la femme. A mon sens, cacher un visage touche à des fondamentaux qui englobent certes la question féminine, mais la dépasse en exprimant aussi notre rapport à la sécurité, à la menace, à l’altérité, comme le montrent les exemples ci-dessus. Devant la complexité de la thématique, qui touche toute une société et ne peut se satisfaire de la réponse de quelques-uns, je ne peux que me réjouir de voir le Conseil Fédéral proposer un contre-projet indirect à l’initiative visant à interdire la burqa. Mais si ce premier pas était indispensable, il reste encore un énorme travail à faire de concertation politique et sociale sur cette thématique.
C’est pourquoi on écoutera à profit les propos clairs de la conseillère nationale Géraldine Savary, dans le journal télévisé de la RTS du 20 décembre dernier. Elle y affirme que « c’est une évidence qu’on doit s’opposer à la burqua, c’est une première chose, mais il faut élargir le débat ». Ce débat doit porter sur « le respect des femmes, des inégalités, de la sécurité publique. Tous ces domaines-là sont à discuter peu ou prou dans un contre-projet indirect », ponctue-t-elle. Il s’agit là d’un travail concernant toute notre société, tous les partis et opinions, tant il est fondamental.
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder cette vidéo de l’action I’m here, « Un selfie pour un innocent », d’Amnesty International, lancée début décembre. Elle propose d’aider à libérer un prisionnier en téléchargeant un selfie, avec cette injonction : « accomplissez quelque chose d’incroyable avec votre visage ».
Espérons que 2018 offrira aux acteurs politiques nationaux et cantonaux l’espace nécessaire à ce débat fondamental.
En mémoire de Raimondo Natalino, mon grand-père né un jour de Noël, postier et chef du parti socialiste de Cagliari sous Mussolini, à visage découvert.
[1] Paul Sonnions, The Search for the Man in Iron Mask, Rowman & Littlefield Publishers, 2016.
[2] Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, Livre de Poche, Paris, 2006, p. 217.




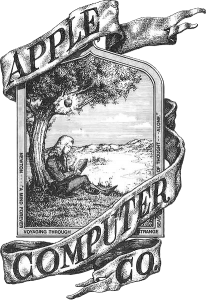


 sormais le «livre» en version tablette, audiolivre, MP3 ou CD… et papier tout de même. Mais la percée est là: l’écriture, désormais, s’écoute. A quand les versions audio performées des oeuvres littéraires, vendues avec leur version livresque? C’est une Odyssée qui s’annonce: écouter ces mots qui, précisément, ont été mûrement mesurés, avant qu’ils ne parviennent à nos oreilles. Ecouter le mot mesuré, et qui sait, apprendre en miroir à mesurer les nôtres.
sormais le «livre» en version tablette, audiolivre, MP3 ou CD… et papier tout de même. Mais la percée est là: l’écriture, désormais, s’écoute. A quand les versions audio performées des oeuvres littéraires, vendues avec leur version livresque? C’est une Odyssée qui s’annonce: écouter ces mots qui, précisément, ont été mûrement mesurés, avant qu’ils ne parviennent à nos oreilles. Ecouter le mot mesuré, et qui sait, apprendre en miroir à mesurer les nôtres.

