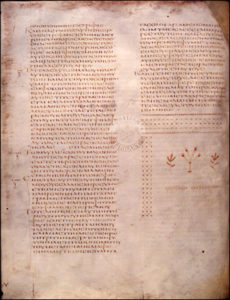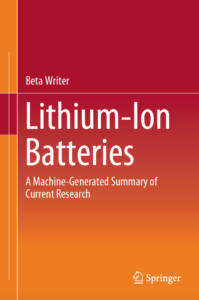Déjà le Tessin apprend, tout comme l’Italie et la France, à distinguer entre biens de consommation essentiels et non essentiels. Gageons que les Suisses Romands pourraient se mettre prochainement à cet apprentissage. Tout comme l’eau, l’air, le riz et les pâtes, la démocratie appartient de fait et de droit à nos biens les plus essentiels, sans lesquels tout s’arrête, au sens propre du terme.
Le journal radio suisse la 1ère annonçait ce matin qu’à Genève, «le parlement ne siégera plus jusqu’à nouvel avis» (min. 1.12-1.14), sans que cette décision ne soit annoncée comme accompagnée d’une réflexion sur des mesures transitoires à mettre en place. Au contraire, c’est avec fermeté et clarté qu’Isabelle Moret, présidente du Conseil National, expliquait ce matin dans ce même journal radio pourquoi la session parlementaire aura lieu demain : «Le parlement n’est pas une manifestation, nous sommes un lieu de travail. Les parlementaires vont à Berne pour travailler, et nous avons la possibilité, dans ce grand palais fédéral, de respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé»; et la politicienne d’expliquer que le parlement ne serait réuni physiquement dans son entier que pour de brefs moments de vote (min. 1.18-2.22).

Il est capital que l’entier des partis politiques réalisent le bien-fondé de ce choix de la présidente. Le parlement serait sans doute également bien inspiré de réfléchir, pendant qu’il est encore réuni physiquement, à la mise en place d’une procédure intérimaire de débat et de vote virtuels, au cas où la situation d’urgence COVID-19 se prolongerait. La journaliste a conclu en son sujet en signalant que les votations du 17 mai étaient maintenues, précisant «pour l’instant, en tous cas» (min. 2.23-2.27). Considérer la démocratie comme un bien essentiel devrait impérativement nous conduire à tout mettre en oeuvre afin d’éviter un éventuel blocage de notre fonctionnement démocratique. Il repose en effet sur un rythme régulier et un débat constant.
Beaucoup d’entre nous relisent ces jours La peste d’Albert Camus : comme Soshana Felman l’avait si magistralement souligné en 1992, ce roman utilise la métaphore de la maladie et des attitudes de chacun/e pour illustrer la situation politique de la deuxième guerre mondiale [1]. Notre résistance au COVID-19 ne l’emportera qu’appuyée par un fonctionnement démocratique stable, qui sait s’adapter aux contraintes du présent, quoi qu’il advienne. Les paroles d’Albert Camus, citoyen Nobel, lors de son discours à Uppsala en 1957, résonnent de manière plus percutante que jamais : «Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse».
[1] Shoshana Felman, “Camus’ The Plague, or a Monument to Witnessing”, dans Reading the Past: Literature and History, Tamsin Spargo (éd.), Houndmills: Palgrave, 2000, p. 127-146 [réédition d’un texte publié en 1992 dans S. Felman – D. Laub, Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York / Londres: Routledge, 1992, p. 93-119].